mercredi, 17 avril 2013
Guy Debord als Gesellschaftskritiker
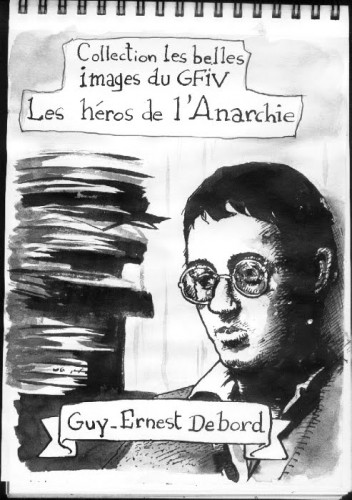
Guy Debord als Gesellschaftskritiker
von Stephan Grigat
Ex: http://www.contextxxi.at/
Guy Debord und die Situationistische Internationale erfahren in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum vermehrte Aufmerksamkeit. Zum einen wurde Debords Hauptwerk, "Die Gesellschaft des Spektakels", erneut aufgelegt. Zum anderen wurde das Augenmerk einer größeren Öffentlichkeit durch Ausstellungen wie beispielsweise jene in Wien Anfang 1998 auf die Aktivitäten der Situationisten gelenkt. In der Regel ging diese verstärkte Rezeption mit einer Reduzierung der Anliegen Debords und anderer Situationisten auf kunst-, kultur- oder auch medientheoretische Fragestellungen einher. Was Greil Marcus bereits für den Anfang der achtziger Jahre konstatiert, trifft um so mehr auf die leise Rennaissance der situationistischen Schriften Ende der neunziger Jahre zu: Das Spektakel ist "zu einer modischen Platitüde der Kritik geworden, zu einem unscharfen, inhaltsleeren Begriff. Er bedeutet nur, daß das Bild einer Sache die Sache selbst überlagerte. Kritiker benutzten dieses Klischee nicht, um nachzudenken oder sich etwas vorzustellen, sondern um sich zu beklagen."1 Je größer die Begeisterung und das Interesse für die kunst- und kulturkritischen Schriften Debords wird, desto weniger Beachtung findet die radikale Gesellschaftskritik, die Debords Kunst- und Kulturkritik zugrunde liegt. Debord selbst hat darauf hingewiesen, daß die Ersetzung seines Begriffs "Spektakel" durch weitläufige Betrachtungen zum Mediensektor seinen Intentionen nicht mehr entspricht, da dadurch die eigentliche Grundlage des Spektakels, die kapitalistische Warenproduktion, affirmiert wird.
Mit wenigen Ausnahmen wird heute versucht, den Kritiker des modernen Warenspektakels selbst zum kritischen Bestandteil des Spektakels zu machen. Exemplarisch für solch eine Art der Beschäftigung mit Debord sei hier nur Sebastian Reinfeld genannt, der über die Lektüre von Louis Althusser und Nicos Poulantzas zielsicher bei den Grünen gelandet ist und sich heute für die "wunderschönen Texte" der Situationisten begeistert,2 ohne den in ihnen propagierten radikalen Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaft ernst zu nehmen.
Debords Kritik sträubt sich weitgehend gegen Vereinnahmungen. In der Linken machte er sich vor allem dadurch unbeliebt, daß er sich entgegen aller Moden weigerte, positiv auf irgendein existierendes staatssozialistisches Modell Bezug zu nehmen, gleichzeitig aber auch sämtliche Kritiker und Kritikerinnen der Staatssozialismen auf’s Korn nahm, sobald diese dem realen Sozialismus einen idealen als Identitätsersatz entgegensetzten. Debord gehörte schon früh zu den wenigen, die es schafften, sich sowohl gegen Stalin als auch gegen Trotzki und Lenin zu wenden. Er kritisierte früh das maoistische China wie auch die europäischen Maoisten und Maoistinnen. Aber auch am Anarchismus oder dem Strukturalismus hatte er genügend auszusetzen. Auch jene Theoretiker, auf die er sich mitunter bezieht, und deren Einfluß auf sein Denken in seinen Schriften recht deutlich wird, sind, wie beispielsweise Georg Lukács, Gegenstand kritischer Auseinandersetzung. So zeigte sich dann auch die deutschsprachige Linke weitgehend desinteressiert an der Kritik und den praktischen Experimenten der Gruppe von situationistischen Theoretikern und Antipolitikern, "die keine der zahlreichen linken Ikonen anerkannte, die Revolution neu erfinden wollte und jede populistische Verwässerung ihrer Kritik zurückwies."3
Bei den universitären Theorieverwaltern und -verwalterinnen machte er sich durch seine konsequente Kritik an der akademischen Wissensproduktion nachhaltig unbeliebt. So wie Marx seine Kritik schon früh von der interesselosen Wissenschaft klar abgegrenzt hat, indem er postulierte, daß die Kritik in ihrem Gegenstand ihren Feind erblickt, den sie "nicht widerlegen, sondern vernichten will",4 so war sich Debord, der sich nachdrücklich gegen die Einteilung des Denkens in Wissenschaftsdisziplinen aussprach, über die zwangsläufige Unwissenschaftlichkeit seines beabsichtigten praktischen Unterfangens im klaren: "Das Projekt, die Wirtschaft zu überwinden, von der Geschichte Besitz zu ergreifen, kann nicht selbst wissenschaftlich sein, auch wenn es die Wissenschaft der Gesellschaft kennen — und zu sich zurückführen — muß."5 Die modernen Sozialwissenschaften betreiben nur mehr eine "spektakuläre Kritik des Spektakels". (168) Das akademische Denken des Spektakels hat sich dadurch zu einer "allgemeinen Wissenschaft des falschen Bewußtseins" (167) herausgebildet. Vor dem Hintergrund dieser Akademismus- und Wissenschaftskritik gelangt Debord zu einem Wahrheitsbegriff, der im eklatanten Widerspruch zu jedem übergesellschaftlichen und überhistorischen Wahrheits- und Erkenntnisbegriff steht: "Die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als die Negation dieser Gesellschaft." (178) Diese Kritik am bürgerlichen Wahrheits- und Rationalitätsbegriff findet sich auch bei Autoren aus dem Umfeld der Situationisten wieder. Emile Marenssin wendet sich in seiner Schrift aus dem Jahr 1972 nachdrücklich gegen einen Vernunftbegriff, der losgelöst von der eigenen kritisch-praktischen Intention existiert: "Vom Standpunkt des Kapitals aus betrachtet, wird der Kommunismus die Gesellschaft des Irrationalen sein, die Gesellschaft der Verrückten. (...) Die Rationalität des Kommunismus wird die Irrationalität des Kapitalismus sein."6
Setzt sich das Feuilleton oder die Sozialwissenschaft heute mit Debord auseinander, wird er vor allem als weitsichtiger Kritiker des Medienzeitalters rezipiert. Dagegen soll der Vordenker der Situationisten hier als früher Fetischkritiker präsentiert werden, der sich explizit auf die Kategorien der Marxschen Werttheorie bezogen hat.7
Henri Lefebvre als Stichwortgeber
Debords Thesen zum Zustand der Warengesellschaft im Jahre 1967 sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Zum einen sind sie vor dem Hintergrund der sich bereits ankündigenden Ereignisse des Jahres 1968 zu verstehen. Zum anderen stehen sie in einer bestimmten Theorietradition, die von Debord selbst deutlich dokumentiert wurde. Stark geprägt wurde er sowohl durch die Lektüre von Lukács als auch durch die Schriften Henri Lefebvres. Anfänglich standen die Situationisten in engem Kontakt mit Lefebvre. Später wurde er Ziel wüster Polemiken von Debord und von anderen Mitgliedern der Situationistischen Internationale. Lefebvre orientierte sich stark an den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" von Marx. Dementsprechend hat er in seinem Hauptwerk den Entfremdungsbegriff ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt. Lefebvre versucht aber, die Entfremdung immer wieder auf den Fetischismus zu beziehen. Bei Lefebvre finden sich Ansätze, die Kritik des Fetischismus über die Analyse des Waren-, Geld- und Kapitalfetischs auszudehnen. So spricht er beispielsweise vom "Fetischismus des Staates".8 Er führt aus, daß gewisse "menschliche Produkte gegenüber der menschlichen Wirklichkeit als eine undurchdringliche, nicht beherrschte Natur (funktionieren), die von außen auf sein Bewußtsein und seinen Willen wirkt." Das sei in der Regel zwar nur scheinbar so, aber dieser Schein ist zugleich immer auch Realität. Nicht nur die Ware, das Geld und das Kapital, sondern auch "der Staat, die Rechtsinstitutionen, die ökonomischen und politischen Apparate, die Ideologien, (...) funktionieren als Wirklichkeiten, die außerhalb des Menschen sind."9 Sie stehen den Menschen als eigengesetzliche Wirklichkeiten gegenüber, obwohl sie nur Produkte der Menschen sind.
Durch die zentrale Stellung, die die Begriffe Entfremdung und Fetischismus in Lefebvres "Kritik des Alltagslebens" einnehmen, kann der nach dem 2. Weltkrieg aus der französischen KP ausgeschlossene Philosophieprofessor als einer der wichtigsten Stichwortgeber von Debord gelten. Seine Orientierung am jungen Marx, seine teilweise widersprüchliche Begriffsverwendung wie auch seine Betonung der Unerlässlichkeit der Kategorie der Totalität, dürften Debord nachhaltig beeinflußt haben.
Auch Lefebvres Hauptanliegen, die Orientierung auf den Alltag, wird von Debord fortgesetzt. Beide betrachten den konkreten Alltag als jene Sphäre, in der die Veränderung ansetzen muß. In der Alltäglichkeit des Lebens der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft materialisiert sich der Fetischismus der objektiven Gedankenformen aus der Ökonomie. Daher soll er auch dort, im Alltagsleben der bürgerlichen Subjekte, nach Lefebvre und Debord durchbrochen werden.
Vollendeter Fetischismus
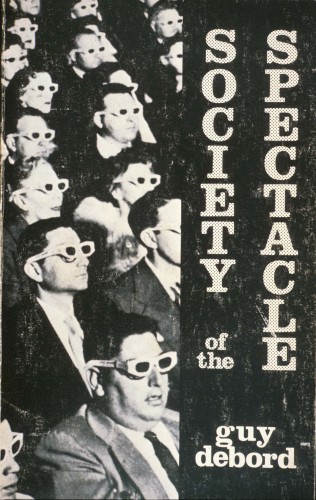 Debords Beschreibung der Totalität des Fetischismus und der Ware beginnt in unmittelbarer Anlehnung an das Marxsche "Kapital", dessen ersten Satz er paraphrasiert: "Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln." (13) Eine explizit feststehende Definition des Begriffs Spektakel gibt Debord in seiner Schrift von 1967 nicht. Er umkreist ihn vielmehr und beschreibt ihn in seinen realen Erscheinungen und ex negativo. Im Begriff des Spektakels ist bei Debord der Begriff des Kapitals, wenn auch gegenüber der Marxschen Herleitung in vereinfachter Form, und der des Fetischismus aufgehoben: "Das Spektakel ist das Kapital in einem solchen Grad der Akkumulation, daß es zum Bild wird." (27) Er begreift das Spektakel als gesteigerte Form des Fetischismus: "Das Prinzip des Warenfetischismus ist es, (...), das sich absolut im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen." (31f.) Marx hat die Verwandlung menschlicher Beziehungen in die Beziehungen von Dingen beschrieben. Debord greift dies auf und beschreibt die Verwandlung der menschlichen Beziehungen in die Beziehung zwischen Bildern,10 die den Menschen noch äußerlicher erscheinen als die Dinge. Anders als in einigen postmodernen Diskursen hingegen, die dazu tendieren, alles in Bilder aufgelöst zu sehen, und die daher keine Realität mehr kennen, die in ihrer Gesamtheit kritisiert werden könnte, bleibt das Bild bei Debord auf die gesellschaftliche fetischistische Totalität, auf die materielle Realität rückbezogen.
Debords Beschreibung der Totalität des Fetischismus und der Ware beginnt in unmittelbarer Anlehnung an das Marxsche "Kapital", dessen ersten Satz er paraphrasiert: "Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln." (13) Eine explizit feststehende Definition des Begriffs Spektakel gibt Debord in seiner Schrift von 1967 nicht. Er umkreist ihn vielmehr und beschreibt ihn in seinen realen Erscheinungen und ex negativo. Im Begriff des Spektakels ist bei Debord der Begriff des Kapitals, wenn auch gegenüber der Marxschen Herleitung in vereinfachter Form, und der des Fetischismus aufgehoben: "Das Spektakel ist das Kapital in einem solchen Grad der Akkumulation, daß es zum Bild wird." (27) Er begreift das Spektakel als gesteigerte Form des Fetischismus: "Das Prinzip des Warenfetischismus ist es, (...), das sich absolut im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen." (31f.) Marx hat die Verwandlung menschlicher Beziehungen in die Beziehungen von Dingen beschrieben. Debord greift dies auf und beschreibt die Verwandlung der menschlichen Beziehungen in die Beziehung zwischen Bildern,10 die den Menschen noch äußerlicher erscheinen als die Dinge. Anders als in einigen postmodernen Diskursen hingegen, die dazu tendieren, alles in Bilder aufgelöst zu sehen, und die daher keine Realität mehr kennen, die in ihrer Gesamtheit kritisiert werden könnte, bleibt das Bild bei Debord auf die gesellschaftliche fetischistische Totalität, auf die materielle Realität rückbezogen.
Eine Formulierung, die als zusammenfassende Definition des modernen Spektakels gelesen werden kann, findet sich erst in Debords Text "Kommentare zur Gesellschaft des Spektakels", der aus dem Jahr 1988 stammt, also 21 Jahre nach der Erstveröffentlichung von "Die Gesellschaft des Spektakels" erschienen ist und in die deutsche Neuauflage von Debords Hauptwerk übernommen wurde. Dort faßt Debord zusammen, was unter dem Begriff des Spektakels zu verstehen sei: "Die Selbstherrschaft der zu einem Status unverantwortlicher Souveränität gelangten Warenwirtschaft und die Gesamtheit der neuen Regierungstechniken, die mit dieser Herrschaft einhergehen." (194) Ein Grundmoment des Marxschen Warenfetischs, die Substituierung menschlicher Beziehungen durch die reale wie scheinhafte Beziehung von Dingen, ist bei Debord, auch wenn er die diffizile Marxsche Analyse dieser Substituierung weder referiert noch explizit reflektiert, konstitutiver Bestandteil des Spektakels: "Der fetischistische Schein reiner Objektivität in den spektakulären Beziehungen verbirgt deren Charakter als Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen: eine zweite Natur scheint unsere Umwelt mit ihren unvermeidlichen Gesetzen zu beherrschen." (22) So wie Georg Lukács die rein kontemplative, die nur betrachtende, anschauende Sichtweise des bürgerlichen Denkens beschrieben und kritisiert hat, sieht Debord die Menschen im Spektakel auf die Rolle von Zuschauern reduziert.
Debords Orientierung an den Marxschen Kategorien ist eindeutig. Das Kapital ist bei Debord nicht primär als selbstbewußte Macht, sondern als automatisches Subjekt gegenwärtig, als "sich selbst bewegende Wirtschaft". (27) Im Spektakel ist die selbe irre machende Gleichzeitigkeit von Wirklichkeit und verkehrtem Schein gegenwärtig, wie sie Marx bereits in der einfachen Warenform aufgezeigt hat: "Das Spektakel, das das Wirkliche verkehrt, wird wirklich erzeugt." (16) Die Parallele zur Realabstraktion des Werts ist hier offensichtlich. Anselm Jappe hat zu recht darauf hingewiesen, daß bei Debord das Spektakel "nicht nur eine Folge der Denkabstraktion, sondern vor allem der ‘Realabstraktion’ ist, auch wenn Debord diesen Unterschied nicht ausdrücklich macht."11 Während im Wert von jeder Gesellschaftlichkeit abstrahiert wird, obwohl er nichts anderes als Ausdruck bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse ist, abstrahieren die Bilder des Spektakels von allem Lebendigen, das Debord als positiven Gegenpol zur spektakulären Herrschaft betrachtet. Dadurch, daß im Lebendigen der positive Gegenpol zur toten, unmenschlichen Abstraktion gesehen wird, droht Debord allerdings — ähnlich wie andere Situationisten, insbesondere Raoul Vaneigem12 — zeitweise in Vitalismus, Anthropologie und Lebensphilosophie abzugleiten.13
Debord konstatiert, daß "in der wirklich verkehrten Welt das Wahre ein Moment des Falschen (ist)." (16) Basiert die Gesellschaft auf einem falschen, weil verkehrenden Prinzip, und ist dieses Prinzip in dem Sinne total, daß es alle Bereiche der Gesellschaft tendenziell durchdringt und strukturiert, so ist jede positiv gefaßte Aussage über diese Gesellschaft insofern immer falsch, als ihr die Affirmation des falschen, verkehrenden Grundprinzips der Wertform zugrundeliegt. Selbst der emanzipative Impuls verkehrt sich dadurch, ist er sich über die gesellschaftliche Struktur, von der es sich gilt zu emanzipieren, nicht bewußt, in Affirmation: "Als Revolutionär war Debord Mathematiker; er bestand darauf, daß sich im Spektakel alle Dinge in ihr Gegenteil verkehrten".14
Das Spektakel ist die materielle Wiederkehr des Vorgängers des Warenfetischs, der "materielle Wiederaufbau der religiösen Illusion." (28) Mit seinen selbstgeschaffenen Verfahrensformen ist es ein "Pseudo-Heiliges". (23) Debord konstatiert Gemeinsamkeiten zwischen Religion und Warenfetischismus, tendiert dabei aber dazu, den Warenfetischismus nicht mehr im streng Marxschen Sinne zu verstehen, sondern zu einem Begriff zu machen, in dem sich vor allem die fast libidinöse Beziehung von Menschen zu den in Warenform existierenden Dingen zeigt: "Wie bei dem krampfhaften Taumeln oder den Wunderheilungen der Schwärmer des alten religiösen Fetischismus gelangt auch der Warenfetischismus zu Momenten schwärmerischer Erregung." (54)
Das keynesianische Akkumulationsmodell mit seiner Bindung an den Massenkonsum fungiert bei Debord als Grundlage für die Ausdehnung der fetischistischen Warenherrschaft von der Produktion in die Sphäre der Konsumtion. Anders als große Teile der kommunistischen und sozialistischen Linken in Frankreich und auch in anderen Ländern, sah Debord im keynesianischen Wohlfahrtsstaat nichts zu Verteidigendes. In der sozialstaatlichen Alimentierung des Proletariats sah er vielmehr einen integralen Bestandteil des modernen Spektakels. Neben die Entfremdung in der Produktion trete "der entfremdete Konsum" als "eine zusätzliche Pflicht für die Massen." (35) Der produzierte Überschuß an Waren erfordert von den ihn Produzierenden "einen Überschuß an Kollaboration." (36)
Bei Debord lassen sich Hinweise darauf finden, wie eine Forschung, welche die Fetischisierung einzelner Waren untersucht, in Verbindung gebracht werden kann mit einer allgemeinen Kritik des Fetischismus. In der Regel führt die Kritik an der Überbewertung einer bestimmten Ware zur Affirmation des Warendaseins der Dinge überhaupt. Die Rede vom "Fetisch Auto" etwa rührt in keiner Weise an den Produktionsbedingungen, unter denen Autos als Waren hergestellt und dadurch mit Radiergummis, Eisbechern und Topfpflanzen vergleichbar werden. Wenn Debord hingegen vom "Spektakel der Automobile" (53) spricht, zeigt er anhand einer bestimmten, in der kapitalistischen Gesellschaft zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgesprochen wichtigen Ware, die zerstörerische Kraft von Warenherrschaft im allgemeinen auf.
Aber auch wenn Debord die Kritik an einzelnen Waren und dem jeweiligen Verlangen nach ihnen immer in eine allgemeine Kritik an der Warenförmigkeit der Dinge bettet, bleibt seine Selbstverständlichkeit, mit der er von der "Künstlichkeit" (37) bestimmter Bedürfnisse spricht, problematisch. Mit seiner Abqualifizierung von "Pseudobedürfnissen" (40) suggeriert er, die eigentliche Bedürfnisstruktur menschlicher Individuen zu kennen. Mit der Kritik angeblich falscher Bedürfnisse geht eine unkritische Bezugnahme auf den Gebrauchswert einher. Debord sieht den Gebrauchswert mit der fortschreitenden Entwicklung der Warengesellschaft zusehendes verkümmern. Dem "tendenziellen Fall des Gebrauchswerts" (38) auf der einen Seite, von dem auch Marenssin mehrfach spricht, stehen bei Debord die bereits vorhandenen Bedingungen für die autonome Herrschaft des Tauschwerts gegenüber, der nur zu seiner Durchsetzung des Gebrauchswerts bedarft habe. Der Gebrauchswert als immer schon und immer noch konstituierender Bestandteil der Ware gerät bei Debord aus dem Blick.
In einem merkwürdigen Widerspruch zu Debords Ausführungen zum Spektakel als nochmals gesteigerter Form der Mystifikation, als potenzierten oder vollendeten Fetischismus, der die Menschen zu Zuschauern degradiert, steht seine Bezugnahme auf die Marxschen Ausführungen aus dem "Manifest der Kommunistischen Partei". Debord schreibt, eine Formulierung aus dem "Manifest" direkt übernehmend: "Indem sie in die Geschichte geworfen sind, indem sie an der Arbeit und an den Kämpfen, aus denen diese Geschichte besteht, teilnehmen müssen, sind die Menschen gezwungen, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen." (61) Gleichzeitigt beschreibt er ausführlich und eindrucksvoll, wie die Augen der Menschen nur mehr auf das sich scheinbar völlig unabhängig von ihnen abspielende Spektakel gerichtet sind. Während bei Marx die Formulierungen des "Manifests" bezüglich der angeblichen Klarsichtigkeit der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft daraus erklärbar sind, daß er zu dieser Zeit seine Werttheorie und die in ihr enthaltene Kritik des Fetischismus noch nicht entwickelt hatte, bedient sich Debord, der die Fetischkritik aus dem "Kapital" kennt, je nach Erfordernis beim frühen oder beim späten Marx — was an sich noch nicht zu kritisieren wäre, aber dann problematisch wird, wenn sich die jeweiligen Textstellen inhaltlich widersprechen.
Spektakel und Staat
Debord denkt die Darstellung der Totalität der fetischistischen Warenwelt im Spektakel immer im Zusammenhang mit der politischen Gewalt, mit dem staatlichen Souverän: "Die verallgemeinerte Entzweiung des Spektakels ist untrennbar vom modernen Staat". (22) Debord konstatiert zwar eine Verselbständigung der Ökonomie vom bewußten Handeln der Menschen, aber eben keine Verselbständigung der Wirtschaft vom Staat in dem Sinne, daß der Staat wieder als positiv eingreifender Regulator angerufen werden könnte. Die spektakuläre Gesellschaft basiert zwar auf Verselbständigungen, aber gerade über diese Verselbständigungen konstituiert sie ihre Einheit. Debord reflektiert die notwendige Trennung der politischen Gewalt von der Ökonomie, die sie zu garantieren hat, ohne diese Gewalt positiv aufzuladen oder für völlig autonom zu erklären: "Wie die moderne Gesellschaft ist das Spektakel zugleich geeint und geteilt. Wie sie baut es seine Einheit auf der Zerrissenheit auf." Gegen das im staatsfetischistischen Marxismus gängige Ausspielen vom freien Markt gegen den Staat richtet sich Debord mit dem Verweis auf die gegenseitige Abhängigkeit der beiden, die gesellschaftliche Totalität in der bürgerlichen Gesellschaft konstituierenden Instanzen: "Von jeder der beiden läßt sich sagen, daß sie die andere in der Gewalt hat. Sie einander gegenüberzustellen, zu unterscheiden, worin sie vernünftig und worin sie unvernünftig sind, ist absurd." (284)
Debords Staatskritik geht einher mit einer Kritik der Politik. Politik müßte sich auf Widersprüche in der spektakulären Gesellschaft beziehen. Debord leugnet auch nicht, daß diese Widersprüche existieren, aber er desavouiert den Glauben an die systemtransformierende Kraft dieser Widersprüche: "Aber wenn der Widerspruch im Spektakel auftaucht, wird ihm seinerseits durch eine Umkehrung seines Sinnes widersprochen." (45) Die Totalität ist bei Debord zwar widersprüchlich, aber die Widersprüche sind der Totalität immanent. Daher ist auch die Politik, die der Widersprüche bedarf, selbst dem Spektakel immanent und weist nicht über es hinaus.
Das Proletariat im Spektakel
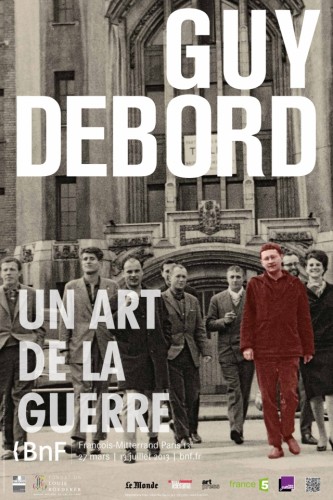 Die Praxis des Proletariats als revolutionäre Klasse kann für Debord "nicht weniger sein als das geschichtliche Bewußtsein, das auf die Totalität seiner Welt wirkt." (64) Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob das Proletariat als real existierende und zunächst nicht besonders revolutionäre Klasse dieses geschichtliche Bewußtsein auch hat. Dennoch bleibt für Debord — zumindest noch in "Die Gesellschaft des Spektakels" — das Proletariat jene Menschengruppe, die als Klasse die Emanzipation zu verwirklichen, den Fetischismus zu durchbrechen und aufzuheben hat. Subjektiv sei das Proletariat "noch von seinem praktischen Klassenbewußtsein entfernt (...)." (102) Wenn aber das Proletariat entdeckt, "daß seine geäußerte eigene Kraft zur fortwährenden Verstärkung der kapitalistischen Gesellschaft beiträgt, (...) entdeckt es auch durch die konkrete geschichtliche Erfahrung, daß es die Klasse ist, die jeder erstarrten Äußerung und jeder Spezialisierung der Macht total feind ist." (102f.) Debord ist Ende der 60er Jahre kritisch gegenüber dem gegenwärtigen Proletariat, aber durchaus zuversichtlich für die Zukunft. Die Emanzipation wird bei ihm noch mit dem Selbstbewußtsein des Proletariats zusammengedacht. Das Proletariat erschien Debord kurz vor den Ereignissen des Pariser Mai von 1968 als "einzige(r) Bewerber um das geschichtliche Leben". (72) Erst später, in den 90er Jahren, erkannte er, auch wenn er sich von der Vorstellung vom Proletariat als Vollender der Emanzipation nicht gänzlich verabschiedete, daß die Klassenherrschaft, wie er in der Vorrede zur dritten französischen Ausgabe von "Die Gesellschaft des Spektakels" formuliert, "mit einer Versöhnung geendet hat" (8), daß also das Proletariat, statt die Feindschaft zu Staat und Kapital zu entwickeln, auf die volle Integration in das fetischistische Warenspektakel gesetzt hat und die falsche Totalität der Gesellschaft nunmehr ohne Negation, ohne Einspruch existiert. In den "Kommentaren" ist jener kritische Pessimismus, der auch die Texte anderer Gesellschaftskritiker seit dem Nationalsozialismus prägte, in potenzierter Form und mit den in solchen Zusammenhängen offensichtlich obligatorischen Übertreibungen anwesend: "Zum ersten Mal im modernen Europa versucht keine Partei oder Splittergruppe auch bloß vorzugeben, sie wolle es wagen, etwas von Belang zu ändern. (...) Es ist ein für alle Mal geschehen um jene beunruhigende Konzeption, die mehr als zweihundert Jahre vorgeherrscht hat und derzufolge man eine Gesellschaft kritisieren oder ändern, sie reformieren oder revolutionieren kann." (213)
Die Praxis des Proletariats als revolutionäre Klasse kann für Debord "nicht weniger sein als das geschichtliche Bewußtsein, das auf die Totalität seiner Welt wirkt." (64) Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob das Proletariat als real existierende und zunächst nicht besonders revolutionäre Klasse dieses geschichtliche Bewußtsein auch hat. Dennoch bleibt für Debord — zumindest noch in "Die Gesellschaft des Spektakels" — das Proletariat jene Menschengruppe, die als Klasse die Emanzipation zu verwirklichen, den Fetischismus zu durchbrechen und aufzuheben hat. Subjektiv sei das Proletariat "noch von seinem praktischen Klassenbewußtsein entfernt (...)." (102) Wenn aber das Proletariat entdeckt, "daß seine geäußerte eigene Kraft zur fortwährenden Verstärkung der kapitalistischen Gesellschaft beiträgt, (...) entdeckt es auch durch die konkrete geschichtliche Erfahrung, daß es die Klasse ist, die jeder erstarrten Äußerung und jeder Spezialisierung der Macht total feind ist." (102f.) Debord ist Ende der 60er Jahre kritisch gegenüber dem gegenwärtigen Proletariat, aber durchaus zuversichtlich für die Zukunft. Die Emanzipation wird bei ihm noch mit dem Selbstbewußtsein des Proletariats zusammengedacht. Das Proletariat erschien Debord kurz vor den Ereignissen des Pariser Mai von 1968 als "einzige(r) Bewerber um das geschichtliche Leben". (72) Erst später, in den 90er Jahren, erkannte er, auch wenn er sich von der Vorstellung vom Proletariat als Vollender der Emanzipation nicht gänzlich verabschiedete, daß die Klassenherrschaft, wie er in der Vorrede zur dritten französischen Ausgabe von "Die Gesellschaft des Spektakels" formuliert, "mit einer Versöhnung geendet hat" (8), daß also das Proletariat, statt die Feindschaft zu Staat und Kapital zu entwickeln, auf die volle Integration in das fetischistische Warenspektakel gesetzt hat und die falsche Totalität der Gesellschaft nunmehr ohne Negation, ohne Einspruch existiert. In den "Kommentaren" ist jener kritische Pessimismus, der auch die Texte anderer Gesellschaftskritiker seit dem Nationalsozialismus prägte, in potenzierter Form und mit den in solchen Zusammenhängen offensichtlich obligatorischen Übertreibungen anwesend: "Zum ersten Mal im modernen Europa versucht keine Partei oder Splittergruppe auch bloß vorzugeben, sie wolle es wagen, etwas von Belang zu ändern. (...) Es ist ein für alle Mal geschehen um jene beunruhigende Konzeption, die mehr als zweihundert Jahre vorgeherrscht hat und derzufolge man eine Gesellschaft kritisieren oder ändern, sie reformieren oder revolutionieren kann." (213)
Die Vorstellung Debords, wie das Proletariat zu einem systemtransformierenden Bewußtsein gelangen kann, war aber schon in den 60er Jahren beachtlich. So sehr er ein Freund der Spontanität war, so sehr war ihm doch bewußt, daß ein unmittelbar und unreflektiert artikuliertes Unbehagen keineswegs von sich aus über das Spektakel hinausweist. Er war sich im klaren darüber, "daß die Unzufriedenheit selbst zu einer Ware geworden ist." (48) Debord war seiner Zeit einerseits verhaftet, da er sich die Emanzipation nur als proletarische Revolution vorstellen konnte. Andererseits war er seiner Zeit voraus, da er die einzige Möglichkeit, daß die Revolution doch einmal Wirklichkeit werden könnte, in der massenhaften Aneignung kritischer Gesellschaftstheorie sah: "Die proletarische Revolution hängt gänzlich von der Notwendigkeit ab, daß die Massen zum ersten Mal die Theorie als Verständnis der menschlichen Praxis anerkennen und erleben müssen. Sie fordert, daß die Arbeiter zu Dialektikern werden und daß sie in die Praxis ihr Denken einschreiben". (107)
Noch wenige Jahre zuvor war die Begeisterung für spontane Protest- und Widerstandsaktionen bei den Situationisten sehr viel ausgeprägter. Nach der ordnungsapologetischen und staatsfetischistischen Kritik fast aller linken Strömungen an den Krawallen in Watts 1965 schwang sich die Situationistische Internationale in der zehnten Nummer ihrer gleichnamigen Zeitschrift zu einer vehementen Verteidigung der Riots auf. Sie nahm die Aufständischen aber nicht nur einfach gegen die Angriffe der reformistischen und mit der Herrschaft fraternisierenden Linken in Schutz, sondern deklarierte die ganze Angelegenheit zu einer "Revolte gegen die Ware" und bescheinigte den Plündernden, daß sie den "Tauschwert und die Warenwirklichkeit"15 ablehnen. Den scheinbaren Subjektstatus der Ware sahen sie im Riot aufgehoben: "Der Mensch, der die Waren zerstört, zeigt dadurch seine Überlegenheit gegenüber den Waren."16 Diebstahl erscheint den Situationisten als antikapitalistischer, den Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft aufhebender Akt: "Sobald die Warenproduktion nicht mehr gekauft wird, wird sie kritisierbar (...). Nur wenn sie mit Geld (...) bezahlt wird, wird sie wie ein bewundernswerter Fetisch respektiert."17 Die Problematik und die Ambivalenzen, die in jedem spontanen Widerstand gegen die fetischistische Warenherrschaft, der sich über Struktur und Funktionsweise von Ökonomie und Politik nicht bewußt ist, enthalten sind, wird nicht thematisiert. Die richtige Verteidigung der Respektlosigkeit gegenüber den Eigentumsverhältnissen wird hier zur falschen Annahme, diese Respektlosigkeit impliziere von sich aus eine Kritik am Eigentum überhaupt. Der Dieb kritisiert aber nicht die Ware, sondern eignet sie sich an — eine Erkenntnis, die in den siebziger Jahren auch im Umfeld der Situationisten zu vernehmen war: "Der Diebstahl, auch wenn ihm die Verteilung folgt, stellt den Kapitalismus überhaupt nicht in Frage; er ist im Gegenteil eine seiner Ausdrucksformen."18
Verschwörung statt subjektloser Herrschaft
In den neunziger Jahren sah Debord nochmals eine Steigerung der Mystifikation. Aber gerade in seinen späteren Texten bleibt es stets merkwürdig unklar, ob der Mystizismus und Fetischismus der Warengesellschaft, ob die spektakuläre Gewalt nun in erster Linie einer subjektlosen Herrschaft geschuldet ist, oder permanent durch bewußte Manipulation hergestellt wird. In den "Kommentaren" wird immer unklarer, was mit dem "generalisierte(n) Geheimnis" (204), das hinter dem Spektakel steht, genau gemeint ist. Es scheint zunehmend so, als ob in den "Kommentaren" mit dem Geheimnis des Spektakels nicht mehr ein Geheimnis im Sinne des Fetischcharakters der Ware gemeint ist, sondern ein von Geheimdiensten gehütetes spezielles Herrschaftswissen. Debord droht in seinen späteren Texten von seiner aktualisierten, die Transformationen der Gesellschaft im 20. Jahrhundert zumindest partiell reflektierenden Fetischkritik aus der "Gesellschaft des Spektakels" zunehmend in Verschwörungstheorien abzugleiten: "Die Kritik der gesellschaftlichen Totalität des modernen Kapitalismus tritt zugunsten einer traditionellen Manipulationstheorie in den Hintergrund."19 Diese Manipulations- und Verschwörungstheorie läßt sich auch nicht dadurch rechtfertigen, daß es selbstverständlich Manipulation und Verschwörung real gibt. Es käme gerade darauf an, diese in Beziehung zur fetischistischen Grundlage der Gesellschaft zu analysieren, was Debord nur noch in Ansätzen versucht.
Der größte Mangel von Debord jedoch besteht — neben seiner unkritischen Bezugnahme auf das Marxsche Frühwerk bei gleichzeitiger weitgehender Ausblendung der Implikationen der Marxschen Wertformanalyse und ihrer Implikationen für einen Begriff des Kapitals — in seiner Ignoranz gegenüber dem Nationalsozialismus und seinem spezifischen Vernichtungsantisemitismus. Er erörtert zwar in knappen Worten den Beitrag des Faschismus zur Herausbildung des modernen Spektakels, kann ihn aber nur mit einem totalitarismustheoretisches Vokabular beschreiben. Die gleichzeitige Kritik an faschistischer und stalinistischer Herrschaft zeigt zwar eine Parallele beispielsweise zu Theodor W. Adorno und Max Horkheimer auf, aber die Ausblendung des spezifisch nationalsozialistischen Antisemitismus markiert in diesem Zusammenhang eine der deutlichsten Differenzen der Situationisten zur Kritischen Theorie. In Debords Hauptwerk, das "immerhin das Wesen der Gegenwart auf den Begriff zu bringen verspricht, findet sich kein Wort über Antisemitismus, Nazismus, Massenvernichtung."20
Dennoch: Debord hat mit seinem Versuch, die Marxsche Kritik des Fetischismus und an ihr orientierter Theorien aufzugreifen, weiterzuentwickeln und zu einer zeitgemäßen Kritik fetischistischer, sich spektakulär darstellender Warenherrschaft zu verdichten neben der Kritischen Theorie eine der wichtigsten Kritiken der bürgerlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert geliefert und in Frankreich früh eine fetischkritische Tradition begründet, die heute beispielsweise von Gruppen wie "Encyclopédie des Nuisances"21 fortzuführen versucht wird.
1 Marcus, Greil: Lipstick traces. Von dada bis Punk. Eine geheime Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Reinbek 1996, S. 102
2 Planet, Nr.4, 1998, S. 14
3 Benl, Andreas: Eine Situation schaffen, die jede Umkehr unmöglich macht. Guy Debord und die Situationistische Internationale. in: jour-fixe-initiative berlin (Hg.): Kritische Theorie und Poststrukturalismus. Theoretische Lockerungsübungen. Berlin — Hamburg 1999, S. 63. Zur Rezeption der Situationisten in der westdeutschen Linken vgl. auch Orth, Roberto: Das 20. Jahrhundert verlassen. in: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg 1995, S. 7 ff.
4 Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. in: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin 1988 (1844), S. 380, Herv. i. Orig.
5 Debord, Guy: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin 1996 (1967), S. 67, Herv. i. Orig. Die Seitenangaben im Text beziehen sich auf diese Ausgabe. Alle Hervorhebungen im Original.
6 Marenssin, Emile: Stadtguerilla und soziale Revolution. Über den bewaffneten Kampf und die Rote Armee Fraktion. Freiburg i. Br. 1998 (1972), S. 110
7 Zur Fetischkritik bei Marx vgl. Grigat, Stephan: Zur Kritik des Fetischismus. in: Streifzüge, Nr. 4/1997, S. 1 ff.
8 Lefebvre, Henri: Kritik des Alltagslebens. Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit. Frankfurt/m 1987 (1947), S. 441
9 Ebd., S. 173
10 Vgl. Jappe, Anselm: Sic transit gloria artis. Theorien über das Ende der Kunst bei Theodor W. Adorno und Guy Debord. in: Krisis, Nr. 15, 1995, S. 146
11 Jappe, Anselm: Politik des Spektakels — Spektakel der Politik. Zur Aktualität der Theorie von Guy Debord. in: Krisis, Nr. 20, 1998, S. 109
12 Vgl. Vaneigem, Raoul: An die Lebenden! Eine Streitschrift gegen die Welt der Ökonomie. Hamburg 1997
13 Vgl. dazu Bruhn, Joachim: Der Untergang der Roten Armee Fraktion. Eine Erinnerung für die Revolution. in: Marenssin, a. a. O., S. 25. Auch Jappe weist auf die "existenzialistisch-vitalistischen Einschläge" bei Debord hin. Jappe: Politik des Spektakels, a. a. O., S. 120
14 Marcus, a. a. O., S. 135
15 Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie. in: Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg 1995, S. 176. Herv. i. Orig.
16 Ebd., S. 177
17 Ebd.
18 Marenssin, a. a. O., S. 132
19 Benl, a. a. O., S. 75
20 Bruhn, a. a. O., S. 24. Vgl. auch Benl, a. a. O., S. 73 ff.
21 Vgl. Encyclopédie des Nuisances: Bemerkungen über die Lähmung vom Dezember 1995. in: Bahamas, Nr. 22, 1997, S. 10 ff.
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy debord, henri lefebvre, situationnisme, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 avril 2013
Othmar Spann: Vom klerikalfaschistischen Ständestaat und seinen Kontinuitäten
| | |
|
Othmar Spann: Vom klerikalfaschistischen Ständestaat und seinen Kontinuitäten von Heide Hammer Ex: http://www.contextxxi.at/
Othmar Spann inthronisierte sich in einem hierarchischen Ständemodell - an der Spitze - und war als Lehrer geistiges Zentrum der von ihm Erwählten. In seinem 1921 erstmals veröffentlichten Werk Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft ordnet er "Stände nach ihren geistigen Grundlagen"1 und ficht gegen Demokratie, Liberalismus und vor allem marxistischen Sozialismus. Ordnendes Prinzip sei: "daß jeder niedere Stand geistig vom jeweils höheren geführt wird (im Original gesperrt), nach dem geistigen Lebensgesetz aller Gemeinschaft und Gemeinschaftsverbindung 'Unterordnung des Niedern unter das Höhere'" (Der wahre Staat, S.176). Die Figur des Kreises Auch er hatte zumindest einen Koch dabei - um "Vollstand" also "handelnd" (Ebd., S. 176) zu werden - diese sind durchaus zahlreich, er führt seine Schüler in Privatseminaren (Sonntag Vormittag bei sich zuhause) in die Grundlagen seiner Gesellschaftslehre ein.2 Primus wird - mit überaus langem Atem in seinem Wirken - Walter Heinrich. Er promoviert 1925 bei Spann, wird 1927 sein Assistent, habilitiert sich 1928 und erhält 1933 an der Wiener Hochschule für Welthandel einen Lehrstuhl für Nationalökonomie. Viele Jahre später zeichnet er in der Zeitschrift für Ganzheitsforschung ein Bild wunderbarer Harmonie dieser Lehrer-Schüler-Beziehung, ein Arbeitszusammenhang, der sehr auf politischen Einfluss zielte, hingegen in der Erinnerung jeweils von der konkreten historischen Situation abstrahiert und metaphysische Distanz beansprucht. Der Meister einer elitären Verbindung provoziert den Terminus "Genie", Kritik wird folglich zu einer inadäquaten Form der Auseinandersetzung, lediglich Analogien zu genialen Personen auf anderen Gebieten (Mozart) erleichtern die Übersetzung jener "Größe", die nunmehr in der Erzählung wirkt:3 "Eine ... tiefer schürfende Erklärung für seine [Spanns] Wirksamkeit liegt sicherlich in der geschlossenen Einheit von Leben und Lehre, von Persönlichkeit und geistigem Werk. Hier war das Eroshafte und das Logoshafte, freundschaftliche Nähe und Geisteskraft in seltener Einheit zusammengewachsen und haben vermöge dieser schöpferischen Verbindung einen Gründungsakt eingeleitet, der weiterwirkt. Vom ersten Geistesblitz der Gründung bis zur Entfaltung des Werkes ... der Wurzelgrund der Lehre wurde niemals verlassen. Dieser Wurzelgrund ... ist der Befund, daß Geist nur am anderen Geist werden kann, also gliedhaft; und die Erkenntnis: wo Glied, da Ganzheit. Damit ist eine neue Eroslehre begründet, eine neue Gemeinschaftslehre, eine neue Gesellschaftslehre." J. Hanns Pichler, ein später Apologet und heute Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftstheorie und -politik an der WU-Wien, übernimmt u.a. die Aufgabe, in gegebenen Abständen auch an den Schüler zu erinnern, an Geburtstagen, später posthum4 oder die Erinnerung an Spann und Heinrich zu verbinden3. Daneben oder danach protegiert Spann Jakob Baxa, der Rechtswissenschaften studiert hatte; von Spann zum Dank für seine intensive und wertvolle Auseinandersetzung mit der Romantik im Fach Gesellschaftslehre habilitiert (Siegfried, S. 72). Wilhelm Andrae wechselt ebenso unter dem Einfluss Spanns von der klassischen Philologie, mit der er an der Berliner Universität nicht reüssieren konnte, zur Nationalökonomie; er erhält 1927 in Graz einen Lehrstuhl für Politische Ökonomie (Ebd.). Seine Übersetzung von Platons Staat, woran Spann gerne seine Überlegungen knüpft, wird hier als Habilitationsschrift anerkannt. Hans Riehl promoviert 1923 bei Spann, die Habilitation 1928 kann bereits bei seinem Freund Wilhelm Andrae in Graz erfolgen (Ebd., S. 73). Ernst von Salomon5, selbst in jenem Kräftefeld aktiv, das in der Weimarer Republik von Konservativen Revolutionären gebildet wird (u.a. an der Ermordung von Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922 beteiligt und verurteilt), hielt sich auf Einladung Spanns in Wien auf und beschreibt in seinem Bestseller, Der Fragebogen6 das alltägliche politische Verhalten der Spann-Schüler (Zit. nach Siegfried, S. 71): "Die 'Spannianer' bildeten auf der Universität eine besondere Gruppe, die größte Gruppe von allen, und, wie ich wohl behaupten darf, auch die geistig lebendigste. In jeder Verschwörerenklave auf den Gängen, in den Hallen und vor den Toren waren Spannianer, mit dem Ziel einer kleinen Extraverschwörung, wie ich vermute, - die beiden Spannsöhne vermochten schon gar nicht anders durch die Universität zu schlendern, wo sie gar nichts zu suchen hatten, ohne ununterbrochen nach allen Seiten vertrauensvoll zu blinzeln. Jeder einzelne von den Spannschülern mußte das Bewußtsein haben, an etwas selber mitzuarbeiten, was mit seiner Wahrheit mächtig genug war, die Welt zu erfüllen, jedes Vakuum auszugleichen, an einem System, so rund, so glatt, so kristallinisch in seinem inneren Aufbau, daß jedermann hoffen durfte, in gar nicht allzulanger Zeit den fertigen Stein der Weisen in der Hand zu haben."7 Die Protagonisten dieser Art Universalismus richten ihre Aktivitäten nach verschiedenen Polen, um in der zeitweiligen Konkurrenz von Nationalsozialismus, Faschismus und Ständestaat ebenso ein Netz zu bilden, wie in den Kontinuitäten der 2. Republik. Ein Blick auf die umfangreiche Publikationsliste J. Hanns Pichlers, des nunmehrigen Vorstands der Gesellschaft für Ganzheitsforschung, dokumentiert eine der Traditionslinien. Sein Bemühen gilt den Klein- und Mittelbetrieben, dem Kleinbürgertum, eine mögliche ideologische Parallele zu Othmar Spann, und - entsprechend seiner Funktion - den Anwendungsgebieten des ganzheitlichen Denkens.8 Dass er im gegebenen politischen Kräftefeld die Publikationsmöglichkeit im Organ der Freiheitlichen Akademie, Freiheit und Verantwortung wahrnimmt, verwundert kaum.9 Gerne bespricht er in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift für Ganzheitsforschung Übersetzungen oder Neuauflagen der Schriften Julius Evolas10, jenes faschistischen Philosophen und Mystikers, der Mussolini von seiner Philosophie überzeugen wollte, die SS liebte und heute Inspiration vieler rechter AktivistInnen ist. Evolas 'Cavalcare la tigre' (Den Tiger reiten) sieht Pichler "ungemein aufrüttelnd und zeitgemäß zugleich", der beliebte Plot 'Untergang des Abendlandes' wird diesmal durch die "Auflösung im Bereich des Gemeinschaftslebens" gegeben und Pichler konkretisiert, "von Staat und Parteien, einer weithin endemisch gewordenen Krise des Patriotismus, von Ehe und Familie bis hin zu den Beziehungen der Geschlechter untereinander" (Zeitschrift für Ganzheitsforschung 4 (1999), S. 209). Denn, so die Diagnose Pichlers in einer Rezension des von Caspar von Schrenck-Notzing herausgegebenen Lexikon des Konservativismus (Zeitschrift für Ganzheitsforschung 2 (1998), S. 93), "in einer pluralistisch zerrissenen und 'unkonservativen' Zeit" dürfen dahingehend mutige Leistungen (das vorliegende Lexikon) nicht geschmälert werden - obgleich er die "notorische und offenbar nicht auszumerzende[!] Fehlinterpretation" der inneren Ordnung der Werke Spanns bedauert -, den Wirren der Zeit werden der ganzheitlichen "Geistestradition verpflichtete Autoren" vor- und gegenübergestellt, allen voran immer wieder Spann. Fragen der politischen Funktion, der Adressaten und Verbündeten der universalistischen Staatslehre werden insoweit unterschiedlich beantwortet, als AutorInnen wie Meyer11, Schneller12 oder Resele13 einen Zusammenhang des ideologischen KSpanns und der sozialen Interessen der kleinbürgerlichen Mittelschicht betonen, während Siegfried darauf beharrt, dass sich dahingehend keine eindeutige Beziehung feststellen ließe, die konkreten Bündnispartner (Heimwehr, Stahlhelm) vielmehr Oberklassen repräsentierten (Vgl. Siegfried, S. 14). Spann wirkt im Zeichen eines "dritten Weges", ein Motiv, das im Kontext der Konservativen Revolution14 an unterschiedlichen Positionen deutlich wird und später gerne von VertreterInnen einer vermeintlich "Neuen Rechten" (Nouvelle Droite)15 affirmiert wird. Das Ständestaatskonzept bietet in seinem Kampf gegen den Historischen Materialismus und die politische Organisation der ArbeiterInnenbewegung eine vorgeblich konsensuale Alternative, die als Wirtschaftsordnung "... jeden, Arbeiter wie Unternehmer, aus seiner Vereinzelung herausreißt und ihm jene Eingliederung in eine Ganzheit gewährt, welche Aufgehobenheit und Beruhigung bedeutet statt vernichtenden Wettbewerb, statt der hastigen Unruhe und Erregung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung" (Der wahre Staat, S. 234). In Anlehnung an die Gesellschafts- und Staatslehre der politischen Romantik (Adam Müller) war Spann bemüht, soziale Antagonismen, Phänomene des Klassenkampfes in einem geistigen Gesamtzusammenhang aufzulösen (Vgl. Siegfried, S. 32-34) und das Glück der Unterordnung, der freudigen Hingabe an die subalterne Funktion im hierarchischen Gefüge in unglaublichen Variationen und Auflagen zu verbreiten. In den Anfängen seiner akademischen Karriere, Spann habilitiert sich 1907 an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn, positioniert er sich in den nationalistischen Auseinandersetzungen der Germanisierungspolitik in der österreichischen Monarchie (Zit. nach Siegfried, S. 43): Heimwehrkontakte Als nach dem Eingreifen der Polizei 86 Tote die Empörung der ArbeiterInnen - kumuliert im Brand des Justizpalastes - kennzeichnen, erzwingt die Heimwehr den Abbruch der sozialdemokratischen Kampfmaßnahmen und erfreut sich daraufhin der Zuwendung heterogener reaktionärer Kräfte, die Heimwehr wird (besonders bäuerliche) Massenbewegung (Siegfried, S. 81). In dieser zweiten Legislaturperiode der Regierung Seipel dominiert Spanns universalistische Lehre die Wiener Universität, sein Kreis hatte sich kontinuierlich vergrößert, nun kommt es zu intensiven Kontakten zwischen dem Führer der Christlichsozialen Partei, der Heimwehr-Führung und Mitgliedern des Spann-Kreises. Im Sommer 1929 wird Walter Heinrich Generalsekretär der Bundesführung des österreichischen Heimatschutzes, im Oktober übernimmt Hans Riehl die Leitung der Propagandaabteilung der Selbstschutzverbände (Siegfried, S. 84). Die Spannungen innerhalb der Heimwehren, unterschiedlicher Flügel, wie sie z.T. für die ÖVP charakteristisch sind, sollten durch ein Gelöbnis (Korneuburger Eid, 18. Mai 1930) beseitigt werden, dessen Text wesentlich von Walter Heinrich formuliert wurde. Der Versuch der Beschwörung der Einheit misslingt, Aristokraten siegen über kleinbürgerliche Repräsentanten der Heimwehren und beenden die Tätigkeit des Spann-Kreises in der Organisation (Siegfried, S. 100). Versuche in Italien Seit 1929 wenden sich Vertreter der universalistischen Lehre dem Faschismus zu, die italienische Regierung bedachte im übrigen die Heimwehren mit bedeutenden Geld- und Waffenlieferungen, den Mangel eines konkreten politischen Programms will Spann kompensieren (Zit. nach Siegfried, S. 102): Austrofaschismus In Österreich war die Transformation der parlamentarischen Demokratie zu einem klerikalfaschistischen Ständestaat durch die Ausschaltung von Parlament und Verfassungsgerichtshof gelungen. Spann verweist auf seine "organisch universalistische Gesellschafts- und Wirtschaftslehre" und betont deren Unvereinbarkeit mit demokratischen Formen der Repräsentation (Zit. nach Siegfried, S. 139): Spanns Ausführungen gelten der Ablehnung liberaldemokratischer Verfassungen, seine Argumentation richtet sich gegen das zentrale Element der Forderung nach Gleichheit. Diese sei "die Herrschaft der Mittleren, Schlechteren, der den Schwächsten zu sich herauf, den Stärkeren herabzieht. Sofern dabei durchgängig die große Menge die Höheren herabzieht und beherrscht, in der großen Menge jedoch abermals der Abschaum zur Herrschaft drängt, drängt Gleichheit zuletzt gar auf Herrschaft des Lumpenproletariats hin" (Der wahre Staat, S. 44). In der weiteren Illustration der Modi des allgemeinen Wahlrechts muss das "politisch gänzlich unbelehrte ländliche Dienstmädchen" die männliche Qualität der "politisch wenigstens teilweise unterrichteten Staatsbürger", Handwerker oder "gehobene Arbeiter" zwangsläufig mindern, "die Stimme des akademisch Gebildeten, des politischen Führers,..." wird entwertet (ebd.). Nationalsozialismus 1929 beginnt Spann Kontakte zu nationalsozialistischen Organisationen zu pflegen, er unterstützt die von Alfred Rosenberg 1927 gegründete Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur, deren Aufgabe die Begeisterung akademisch Gebildeter für die Bewegung sein soll (Siegfried, S. 153). Spann gilt in der Analyse der Arbeiterzeitung bereits 1925 als der intellektuelle Führer des Hakenkreuzlertums an der Wiener Universität, er tritt der NSDAP bei und erhält eine geheime, nicht nummerierte Mitgliedskarte (ebd.). Die Schulungsabende des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes finden in den Räumen seines Seminars statt, der Unterricht wird vom Spann-Schüler Franz Seuchter gestaltet (Siegfried, S. 153f.). In einem 1933 veröffentlichten Aufsatz bietet Spann nun dem Nationalsozialismus seine universalistische Gesellschaftslehre als ideologische Grundlage des notwendigen ständischen Aufbaus dar (Zit. nach Siegfried, S. 156f.): Sein Bemühen wird von Repräsentanten der Schwerindustrie, besonders Thyssen, honoriert, der die Idee die Vertretungen der ArbeiterInnen in die Industrieverbände einzugliedern reizvoll findet und für die dahingehende Überzeugungsarbeit die Gründung eines Instituts für Ständewesen (in Düsseldorf) unterstützt. Die wissenschaftliche Leitung des am 23. Juni 1933 feierlich eröffneten Instituts übernimmt Walter Heinrich, weitere Vertreter des Spann-Kreises (Andrae, Riehl, Paul Karrenbrock) werden aktiv (Siegfried, S. 175f). Der wiederholte Ruf nach "ständischer Selbstverwaltung" läuft den Interessen und Machtpositionen der Stahlindustriellen zuwider, Unterstützungen für die Zeitschrift Ständisches Leben werden 1935 eingestellt, eine Kontroverse mit der Führung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) führt 1936 zum Ende der Propagandatätigkeit des Spann-Kreises am Institut für Ständewesen (Siegfried, S. 186f. und 195). Spanns Ablehnung der NS-Rassentheorie trug neben seinen politischen Fehleinschätzungen zu den Disharmonien bei. Der Begriff der Nation wird in der universalistischen Gesellschaftslehre kulturell definiert, eine "geistige Gemeinschaft", die antisemitische Diskriminierung ermöglicht, nicht erfordert (Siegfried, S. 201f). Ab 1935 werden die Antagonismen der beiden faschistischen Konzeptionen in zahlreichen Zeitungsbeiträgen offensiv ausgetragen, nach der Annexion Österreichs werden Othmar Spann, Rafael Spann und Walter Heinrich verhaftet. Das daraus gebildete Konstrukt einer vorzeitigen Abkehr konservativer Kräfte vom Nationalsozialismus ohne jegliche Reflexion ihrer Funktion in der Phase der Konstituierung eröffnet rechten Parteien und Einzelpersonen die Verherrlichung bewunderter und geliebter Meister und in diesem Sinne die Relativierung des Nazisystems. Die Lehre von der Ganzheit diente der Zerschlagung demokratisch verfasster Gesellschaften, dass sie zum Dienst und nicht zur Herrschaft gelangte, liegt an den realen Kräfteverhältnissen und auch am dürftigen Angebot, das Zufriedenheit in Unterdrückungsverhältnissen fordert im Tausch gegen "Beruhigung". Die perpetuierte Distribution des Modells liegt gleichsam am Puls der Zeit, ebenso wie ein Dollfußportrait im Parlamentsbüro Khols, Wirtschafts- und Arbeitsminister Bartenstein, die ÖVP Frauenpolitik und Schwester Herbert. 1 Spann, Othmar [1931]: Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft. Jena: Fischer, S. 175. → zurück 2 Vgl., Siegfried, Klaus-Jörg [1974]: Universalismus und Faschismus. Das Gesellschaftsbild Othmar Spanns. Wien: Europa Verlag, S. 72. → zurück 3 Zit. nach Pichler, J. H. (Hrsg.)[1988]: Othmar Spann oder die Welt als Ganzes. Wien/Köln/Graz: Böhlau, S. 26ff. Dieses Werk ist Walter Heinrich posthum zugeeignet. → zurück 4 Vgl., Pichler, J. H. [1992]: Betrachtungen zum Vaterunser. Im Gedenken des 90. Geburtstages von Walter Heinrich. Zeitschrift für Ganzheitsforschung, 36. Jg., IV/1992. → zurück 5 http://motlc.wiesenthal.com/text/x29/xm2933.html → zurück 6 Roman in autobiographischer Form, in welchem er die 131 Fragen der Entnazifizierungsbehörden dokumentieren und ad absurdum führen möchte. 1951 publiziert wurde das 800 Seiten Werk zum ersten Bestseller der BRD. → zurück 7 von Salomon, Ernst [1969]: Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, S. 172. → zurück 8 Vgl. Pichler, J. Hanns [1990]: Woran könnte der Osten sich halten? Ganzheitliche Staatsidee und Wirtschaftsordnung als ein Programm der Mitte. Wiss. Arbeitskreis, Institut für Gewerbeforschung, Wien (Vortrag). ders., [1993]: Ganzheitliches Verfahren in seinem universalistisch überhöhenden Anspruch. In: Klein, H. D./Reikersdorfer, J. (Hrsg.): Philosophia perennis. Erich Heintel zum 80. Geburtstag, Teil 1, Frankfurt/Main, Berlin, Bern, New-York, Wien. → zurück 9 ders., [1999]: Europa und das Europäische. Auf der Suchen nach seiner 'Begrifflichkeit' von der Antike bis zur Neuzeit. In: Berchthold, J./Simhandl, F. (Hrsg.) [1999]: Freiheit und Verantwortung. Europa an der Jahrtausendwende. Jahrbuch für politische Erneuerung. Wien: Freiheitliche Akademie. → zurück 10 Vgl. http://www.trend.partisan.net/trd1298/t351298.html → zurück 11 Vgl. Meyer, Thomas [1997]: Stand und Klasse. Kontinuitätsgeschichte korporativer Staatskonzeptionen im deutschen Konservativismus. Opladen: Westdeutscher Verlag. → zurück 12 Vgl. Schneller, Martin [1970]: Zwischen Romantik und Faschismus. Der Beitrag Othmar Spanns zum Konservativismus in der Weimarer Republik. Stuttgart: Klett. → zurück 13 Resele, Gertraud [2001]: Othmar Spanns Ständestaatskonzeption und politisches Wirken. Wien (Diplomarbeit). → zurück 14 Vgl. Fischer, Kurt R./Wimmer, Franz M. (Hrsg.) [1993]: Der geistige Anschluß. Philosophie und Politik an der Universität Wien 1930-1950. Wien: WUV. Heiß, Gernot/Mattl, Siegfried/Meissl, Sebastian/Sauer, Edith, Stuhlpfarrer, Karl (Hrsg.Innen) [1989]: Willfährige Wissenschaft. Die Universität Wien 1938-1945. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik. → zurück 15 Einer der deutschsprachigen Epigonen ist der eifrige Rezensent der Zeitschrift für Ganzheitsforschung Gerd-Klaus Kaltenbrunner, der ebenso im rechtsextremen Criticon (hrsg. von Caspar von Schrenck-Notzing), Sieg oder Aula, Publikation der "Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Akademikerverbände Österreichs" publiziert. Ein weiterer regelmäßiger Autor der Zeitschrift für Ganzheitsforschung ist der katholische Antisemit Friedrich Romig, früher Europa-Beauftragter Kurt Krenns (Vgl. www.doew.at Neues von ganz rechts - April 2000), der seine antidemokratische Überzeugung gerne hinter ökologischen Bedenken verbirgt (Vgl. Zeitschrift für Ganzheitsforschung 2 (1997), S. 71-86). → zurück |
00:05 Publié dans Droit / Constitutions, Economie, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, mitteleuropa, europe centrale, économie, droit, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, révolution conservatrice, othmar spann |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 avril 2013
La presencia de René Guénon en Mircea Eliade y Carl Schmitt

La presencia de René Guénon en Mircea Eliade y Carl Schmitt
por Francisco García Bazán (Universidad A.J.F. Kennedy-CONICET)
Ex: http://culturatransversal.wordpress.com/
Al final de mi libro en colaboración René Guénon y la tradición viviente (1985), apuntaba algunos rasgos sobre la influencia de René Guénon en una diversidad de estudiosos contemporáneos. Allí escribí:
«El mundo de habla española, por su parte, se abre velozmente en los últimos decenios a la gravitación guenoniana. Hemos de reconocer que la Argentina, en este sentido, no sólo ha jugado un papel preponderante, sino que incluso fue oportunamente una verdadera precursora de este florecimiento del pensamiento de Guénon [en la geografía hispana].
Ya en 1945 se publicó en Buenos Aires la Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes y la crítica periodística porteña recibió favorablemente la novedad de [la presencia] de un credo de inspiración tradicionalista [en la cultura francesa]. A esta traducción siguieron en años sucesivos: El teosofismo (1954), con varias ediciones, La crisis del mundo moderno (1967), Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada (1969 y El esoterismo de Dante (1976). Mucho más reciente, [por el contrario], es el interés de los españoles por nuestro autor. Pero aunque la traducción de la primera de las obras citadas es de la década del 40, la evidencia de una lectura y conocimiento del autor francés ya se reflejó con anterioridad en individuos y grupos de intelectuales argentinos.
Los primeros que demostraron interés por el pensamiento de R. Guénon en nuestro país fueron pensadores del campo católico, hondamente preocupados por la esencia y el futuro de la nación. Se agruparon en Buenos Aires y Córdoba, en torno a las revistas Número y Sol y Luna, y Arx y Arkhé, respectivamente. Entre estos [escritores] por la influencia y uso que hicieron de las obras de Guénon sobresalen: César Pico, José María de Estrada y, muy probablemente, el poeta Leopoldo Marechal –todos ellos en Buenos Aires y vinculados a los Cursos de Cultura Católica-. En la Provincia mediterránea, Fray Mario Pinto y Rodolfo Martínez Espinosa, autor [este último] del primer artículo escrito en la Argentina sobre nuestro pensador [tradicional] y su corresponsal [con un intercambio de correspondencia entre los años 1929 y 1934], cuando Guénon residía en El Cairo. [Las dos cartas del autor franco-egipcio son del 24 de agosto de 1930 y del 23 de febrero de 1934. La última es una larga misiva de ocho carillas, en la que a las dudas expuestas por Martínez Espinosa responde Guénon condensando en ella la doctrina tradicional y anticipando incluso soluciones sobre las diversas vías espirituales, que posteriormente hará públicas. Estas cartas fueron primeramente publicadas por mí traducidas al castellano el domingo 13 de julio de 1980 en el Suplemento Literario de “La Nación”, cuando era dirigido por Jorge Emilio Gallardo, posteriormente fueron publicadas en edición bilingüe en el libro al que nos estamos refiriendo y poco después aparecieron en Francia en Les Dossier H René Guénon, dirigido por Pierre-Marie Sigaud, editado por L’Age d’Homme, Lausana, 1984, 286-289, gracias al contacto del que tomó la iniciativa André Coyné]…El ilustre filósofo de la ciencia, Armando Asti Vera, ofreció al público hispanohablante en 1969 una elegante y correcta primicia sobre la vida, obra y filosofía de Guénon de amplísima difusión. La casi totalidad de su obra escrita y de dirección docente llevan el sello indeleble del pensamiento guenoniano que frecuentaba desde su madura juventud» (pp. 171-172 y notas).
Lo dicho se refiere a nuestro país y medio cultural, pero en ese mismo libro, páginas más adelante, hacíamos referencia a la influencia de René Guénon en investigadores franceses, judíos e indios, sobre todo en el gran especialista en Shankara, T.M.P. Mahadevan, en cuya tesis sobre Gaudapâda. A Study in Early Advaita (University of Madras, 1975), el tradicionalista nacido en Blois está a menudo citado y es altamente reconocido por su profunda comprensión del Vedânta advaita o no dual. En esa ocasión, sin embargo, apenas nos habíamos referido a Mircea Eliade. Pero, posteriormente, y después de haber leído el artículo del profesor rumano, «Some Notes on Theosophia perennis» publicado en la revista de la Universidad de Chicago History of Religions (1979), pp. 167-176, nuestra opinión cambió y admitimos la influencia de Guénon en su obra como historiador de las religiones. Posteriormente hemos comprobado que un investigador particularmente calificado en el conocimiento de la vida y obra de Guénon, como lo es Jean-Pierre Laurant, de L’ École Pratique des Hautes Études. Section Sciences des Religions, escribe en el Diccionario Crítico del Esoterismo, dirigido por Jean Servier, publicado en 1998 por P.U.F. y recientemente traducido por la Ed. AKAL al castellano, en la entrada correspondiente a “René Guénon”, que firma: «También desempeñó [Guénon] un papel muy importante [lo subrayamos] en la formación del pensamiento de Mircea Eliade e influyó sobre el conjunto de la renovación de la historia de las religiones, hasta tal punto que Gaétan Picón lo integra dentro de su Panorama des idées contemporaines (1954). Su influjo [en esta dirección] se prolonga, hasta nuestros días, a través de una renovada reflexión sobre el simbolismo, la “Tradición” y las tradiciones en los trabajos de J. Borella en Francia, R. Martínez Espinosa y F. García Bazán en Argentina o, en Estados Unidos, en los de Joseph E. Brown sobre los indios» ( Vol. I, p. 754). [Permítaseme hacer la aclaración en paralelo que respecto del cultivo de los estudios sobre Guénon en nuestro medio y la recepción de su pensamiento, también Piero Di Vona, profesor de la Universidad de Nápoles y autor de un respetable libro sobre Evola e Guénon. Tradizione e civiltà (1985), en su ponencia sobre “René Guénon e il pensiero de destra”, presentada en la Università degli Studi di Urbino, a fines de los 80’, ya reconocía asimismo en confrontación con el desarrollo de la teología de la liberación sudamericana, que frente a ella: «Tutte queste osservazioni rivestono almeno per noi una grande importanza perché nell’attuale cultura sudamericana Guénon è oggetto di attento studio in ambienti qualificati. (Rimandiamo al libro di F. García Bazán, René Guénon y la tradición viviente, etc.)»].
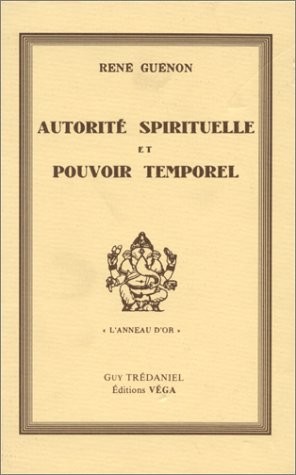 Pero más recientemente todavía y con motivo de la publicación consecutiva de las Memorias de Eliade, la perspectiva sobre la irradiación guenoniana se ha ampliado y así hemos tenido la oportunidad de leer un erudito artículo del estudioso italiano Cristiano Grottanelli, bajo el acápite de «Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942», en la Revue de l’Histoire des Religions Tome 219, fascículo 3, julio-septiembre 2002, pp. 325-356, que arroja nuevas luces y sombras sobre la cuestión claramente anticipada en el título y que amplia el panorama con la mención del gran jurista y experto en derecho internacional, Carl Schmitt, tan apreciado en los comienzos de los años 30 por el régimen nacionalsocialista, como posteriormente repudiado tanto por la SS y el nazismo que representaban, como por sus vencedores aliados.
Pero más recientemente todavía y con motivo de la publicación consecutiva de las Memorias de Eliade, la perspectiva sobre la irradiación guenoniana se ha ampliado y así hemos tenido la oportunidad de leer un erudito artículo del estudioso italiano Cristiano Grottanelli, bajo el acápite de «Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942», en la Revue de l’Histoire des Religions Tome 219, fascículo 3, julio-septiembre 2002, pp. 325-356, que arroja nuevas luces y sombras sobre la cuestión claramente anticipada en el título y que amplia el panorama con la mención del gran jurista y experto en derecho internacional, Carl Schmitt, tan apreciado en los comienzos de los años 30 por el régimen nacionalsocialista, como posteriormente repudiado tanto por la SS y el nazismo que representaban, como por sus vencedores aliados.
El período más difícil de determinar en la vida de Eliade es el que va de los años 1934, cuando ya ha residido tres años en la India (1929-1931) dirigido por el eminente profesor de filosofía hindú Surendranath Dasgupta, y ha cumplido prácticas de Yoga en Rishikesh, en el Himalaya, en Svargashram con Swami Shivananda. Vuelto a Bucarest ha publicado la novela Maitreyi de gran éxito de ventas (1934) y ha presentado hacia fines de año su tesis de doctorado sobre la filosofía y prácticas de liberación yóguicas como una perspectiva dentro del pensamiento indio, siendo nombrado asistente de Naë Ionesco, profesor de Lógica y Metafísica en la Universidad de Bucarest. Desde esa fecha hasta fines de 1944 en que fallece su esposa Nina Mares y en que al año siguiente (1945) establece relaciones culturales y esporádicamente docentes en París como exiliado con el apoyo de la colonia rumana y colegas y amigos como Georges Dumézil, su biografía es bastante movida y es también durante ese período en el que apoyado en su formación de indólogo incipiente, se cimentó asimismo su método e ideas como teórico de las religiones. Después que obtiene la adjuntía de cátedra a través de su titular Ionesco traba relación estrecha con los cuadros de la Legión del Arcángel San Miguel o Guardia de Hierro, formación política de extrema derecha y de ideología nacionalista, agrega sus actividades de escritor a sus responsabilidades universitarias regulares con el dictado de seminarios: “Sobre el problema del mal en la filosofía india”, “Sobre la Docta ignorancia de Nicolás de Cusa”, “Sobre el libro X de la Metafísica de Aristóteles”, “Las Upanishads y el budismo”, etc.; publica el libro Yoga. Ensayo sobre los orígenes de la mística india, con pie de imprenta París-Bucarest, por lo editores Paul Geuthner/Fundación Real Carol I y aparecen tres números de la revista de historia de las religiones con colaboradores internacionales y de muy buen nivel que dirige, Zalmoxis. En l940 es nombrado agregado cultural de la Embajada Real de Rumania en Londres y al año siguiente Consejero de la Embajada Real de Rumania en Lisboa, aquí reside hasta 1945, cuando concluida la segunda guerra europea, le sobreviene la condición de exiliado. Durante este período que estamos teniendo en cuenta de gran fecundidad intelectual y de estabilidad político-laboral, se da el acontecimiento que registra el autor en el II volumen de las Memorias, Las promesas del soltiscio:
«Nos detuvimos durante dos días en Berlín. Uno de los agregados de prensa, Goruneanu, me llevó hasta Dahlem, a la casa de Carl Schmitt. Éste acababa de concluir en ese tiempo su librito sobre la Tierra y el mar y quería hacerme algunas preguntas sobre Portugal y las civilizaciones marítimas. Le hablé de Camoens y en particular del simbolismo acuático –Goruneanu le había ofrecido el volumen segundo de Zalmoxis en donde habían aparecido las “Notas sobre el simbolismo acuático”-. En la perspectiva de Carl Schmitt, Moby Dick constituía la mayor creación del espíritu marítimo después de la Odisea. No parecía entusiasmado por Los Lusiadas, que había leído en una traducción alemana. Conversamos durante tres horas. Nos acompañó hasta el subterráneo y, mientras caminábamos, nos explicó por qué consideraba la aviación como un símbolo terrestre….».
El encuentro tuvo lugar en julio de 1942, según precisa Mac Linscott Rioketts en su extensa y bien documentada biografía de Eliade.
Ahora bien, Ernst Jünger, gran amigo de Schmitt, que por esas fechas era oficial del Ejército alemán, estaba en Berlín con permiso y fue llamado a París para hacerse cargo de sus obligaciones militares. El 12 de noviembre fue a visitar a Dahlem a su amigo Schmitt a modo de despedida, estando con él del 12 al 17. El 15 estaba Jünger en casa del amigo y escribe lo siguiente en su Diario:
«Lectura de la revista Zalmoxis, cuyo título procede de un Hércules escita citado por Heródoto. He leído dos ensayos de ella, uno dedicado a los ritos de la extracción y uso de la mandrágora y el otro trataba del Simbolismo acuático, y de las relaciones entre la luna, las mujeres y el mar. Ambos de Mircea Eliade, el director de la revista. C.S. me proporcionó informaciones detalladas sobre él y sobre su maestro René Guénon. Las relaciones etimológicas entre las conchas marinas y el órgano genital de la mujer son particularmente significativas, como se ve en la palabra latina conc[h]a y en la danesa Kudefisk, en donde kude tiene el mismo sentido que vulva.
La mentalidad que se dibuja en esta revista es muy prometedora; en lugar de una escritura lógica, se trata de una escritura figurada. Son estas las cosas que me hacen el efecto del caviar, de las huevas de peces, se siente la fecundidad en cada frase».
 En vísperas de Navidad del mismo año Eliade recibió Tierra y mar de parte de Schmitt, y Goruneanu le informa que el número 3 de Zalmoxis que había enviado a Schmitt lo acompañaba a Jünger en su mochila. Y esta triple relación de personas, directa, en un caso, e indirecta en el otro – por medio de la revista Zalmoxis-, se repite en 1944 y posteriormente. El primer caso se concretó por un nuevo encuentro de Schmitt -quien consideraba a Guénon: “El hombre más interesante de su tiempo” según señala Eliade en Fragmentos de Diario- con éste en Lisboa. En la visita de 1942, conjetura Grottanelli, de acuerdo con los testimonios de una simpatía recíproca de ambos personajes sobre Guénon, conversarían sobre él posiblemente no sólo como maestro sino también como teórico de la Tradición. El segundo encuentro a que nos hemos referido de Jürgen y Eliade y que nos interesa menos en este trabajo, llevó a que un tiempo después Jünger y Eliade dirigieran la revista Antaios.
En vísperas de Navidad del mismo año Eliade recibió Tierra y mar de parte de Schmitt, y Goruneanu le informa que el número 3 de Zalmoxis que había enviado a Schmitt lo acompañaba a Jünger en su mochila. Y esta triple relación de personas, directa, en un caso, e indirecta en el otro – por medio de la revista Zalmoxis-, se repite en 1944 y posteriormente. El primer caso se concretó por un nuevo encuentro de Schmitt -quien consideraba a Guénon: “El hombre más interesante de su tiempo” según señala Eliade en Fragmentos de Diario- con éste en Lisboa. En la visita de 1942, conjetura Grottanelli, de acuerdo con los testimonios de una simpatía recíproca de ambos personajes sobre Guénon, conversarían sobre él posiblemente no sólo como maestro sino también como teórico de la Tradición. El segundo encuentro a que nos hemos referido de Jürgen y Eliade y que nos interesa menos en este trabajo, llevó a que un tiempo después Jünger y Eliade dirigieran la revista Antaios.
Pues bien, de la mutua admiración que Schmitt y Eliade confesaban a mediados del año 1942, en plena guerra europea, por Guénon, el caso de C. Schmitt es documentalmente más accesible y claro, puesto que éste en un notable y bien conocido libro de 1938, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politisches Symbols (El Leviatán en la teoría del estado de Thomas Hobbes. Sentido y fracaso de un símbolo político), entendía la componente esotérica como central en su composición, ya que Hobbes, exaltado por él dos años antes como el “gran inventor de la época moderna”, aparecía ahora en una nueva dimensión como quien había utilizado por error un símbolo en su tesis de política, el del monstruo marino de ascendencia religioso-cultural judía, que lo superaba en sus intenciones y se le imponía por su misma fuerza simbólica interna, poniéndolo bajo su control y manejándolo como un aprendiz de brujo. Y ahí mismo en el libro, en la nota 28, Schmitt recordaba a René Guénon, quien en la Crisis del mundo moderno de 1927, afirmaba la noción paralela y clave para la interpretación simbólica de que: «La rapidez con la que toda la civilización medieval sucumbió al ataque del siglo XVII es inconcebible sin la hipótesis de una misteriosa voluntad directriz que queda en la sombra y de una idea preconcebida». La ambivalencia del símbolo que tanto señala a la permanencia oculta de la Tradición como a los ataques aparentemente invisibles que asimismo recibe de la antitradicón y de la contratradición, y que puede aplicarse como un modo de justificación de la teoría política del complot o la conjuración político-social basada en la metafísica de la historia, es lo que le interesaba hacer notar a Schmitt, quien había sufrido dos años antes siendo Presidente de la Asociación de Juristas Alemanes y Consejero de Estado un ataque contra él en la revista de los SS Das Schwarze Korps, viéndose obligado a renunciar a todas sus funciones públicas. El empleo de la capacidad velada del símbolo para mostrar y ocultar por su poder esotérico de comunicación, es lo que veía Schmitt en Leviatán, serpiente marina guardiana del tesoro a veces para la enseñanza semítica y en otros momentos monstruo destructivo que proviene del mar, en el caso concreto aplicado su dimensión oscura y demoledora a la civilización cristiana y occidental más que milenaria. En este sentido igualmente el personaje que el libro encubría como destructor era Himmler y no Hitler.
Pero resultaba que si en este momento el libro de Guénon citado es La crisis del mundo moderno, Schmitt conocía mucho más del autor francés lo que explica el entusiasmo por él, según registra Eliade, pues en correspondencia entrecruzada unos años después con Armin Moler quien prepara su tesis sobre el jurista, al que le envía una carta el 19 de octubre de 1948 y que es respondida por Schmitt el 4 de diciembre. En las cartas cruzadas tenemos los siguientes datos:
«A la noche, después de haber trabajado en la tesis, siempre leo sus escritos, incluso los que aún no conozco. Os lo he referido ya que después de la visita que le hecho en Plettemberg, todo me parece más claro, con la sola excepción del Leviatán. Esta obra me sigue desorientando, y no sólo allí en donde, como al final del segundo capítulo, se hace alusión a un tema absolutamente nuevo [...]. La aparición de Guénon me ha sorprendido. ¿Conoce usted los escritos de este hombre singular? Siegfried Lang, uno de nuestros poetas más inspirados, me ha introducido hace algún tiempo en el estudio de su pensamiento».
Y esta es la contestación de C. Schmitt:
«Respecto del Leviatán, ya le he dicho que se trata de una obra totalmente esotérica; recuerde la “nota del autor” y las consideraciones del final del Prefacio, incluso si se trata de fórmulas evasivas. He leído mucho de Guénon, pero no la totalidad [de lo que ha escrito], lamentablemente. Nunca le he encontrado personalmente, pero he conocido a dos de sus amigos. Os interesará saber que el barón Julius Evola ha sido uno de sus fieles discípulos, pero no sé si Guénon vive todavía; según las últimas noticias que he recibido, pero que son de algunos años, vivía en el Cairo, con amigos musulmanes» (ver Grottanelli, 739).
Se advierte, por lo tanto, más allá del respeto intelectual y estimulante para la comprensión de los hechos histórico-políticos que Guénon inspiraba al jurista y filósofo político alemán, el uso aplicado que hacia del esoterismo, basado en el esoterismo riguroso de Guénon y Evola.
Está llegando el momento de dejar a C. Schmitt, porque estas jornadas están más centradas en Eliade y Guénon, pero para terminar con él, en confirmación de lo dicho vienen otras manifestaciones del autor, que la traducción española de la Ed. Trotta de Tierra y Mar ha incluido en una “Nota Final” debida a Franco Volpi. En ella se escribe, por medio de Nicolás Sombart, el hijo del famoso sociólogo e historiador de la economía, en referencia a Schmitt, que él se auto percibía como el guardián de un misterio, como un “iniciado”, al punto de que arcanum era una de las palabras que más repetía. Así Sombart cuenta esta anécdota en su relación con C. Schmitt, que:
«Un día [el mismo] Nicolaus preparaba una ponencia sobre la crítica teatral hebrea… Y consultado el profesor Schmitt, éste le repuso, no sabes en dónde te estás metiendo ¿Conoces la cuestión judía de C. Marx?, ¿Y a Disraeli?: Ni siquiera conoces a Disraeli y pretendes ocuparte de los judíos…Así puso en sus manos su novela Tancredo o la nueva cruzada, final de la trilogía que Benjamín Disraeli había publicado en 1847. Allí el gran político inglés, como buen esotérico, había encerrado en una obra literaria sus convicciones políticas más profundas. De este modo, en un pasaje borrado en la segunda edición de Tierra y mar lo llama Schmitt: “un iniciado, un sabio de Sión” y en Dahlen no tenía el jurista colgado un retrato de Hitler, sino de Disraeli. Y Schmitt asimismo le apunta a Nicolaus cual es la frase decisiva del libro, la que dice que: “El cristianismo es judaísmo para el pueblo”. Es la frase que da vuelta a dos mil años de historia. El conflicto entre judaísmo y catolicismo sobre la interpretación del sentido de la historia obsesionaba a Schmitt y la Modernidad era el campo de batalla del enfrentamiento…Los grandes pensadores hebreos del siglo XIX habían entendido que para llegar a la victoria en el plano de la historia universal necesitaban romper con el antiguo orden cristiano del mundo y acelerar la secularización y la disgregación de ese orden. El más temible teórico habría sido Disraeli, pues según su frase el cristianismo sería la estrategia urdida por los judíos para conquistar el sentido de la historia universal…La escatología estaba a punto de imponerse sobre el mesianismo…un orden universal en el que la “Nueva Jerusalén” colocada en el más acá es buscada por la élite judía…La Revolución Francesa aceleró el camino y la visión judía de dominio universal y la potencia marítima inglesa se fundieron en una simbiosis como un inmenso proyecto para la humanidad…El concepto de “retención” (katékhon) del cristianismo es ineficaz para poder guiar a la humanidad. Todo ello, remarca Schmitt, porque los judíos manejan el arte secreto de tratar con el Leviatán, saben domesticarlo para en el momento oportuno descuartizarlo. Era necesario descubrir las técnicas ocultas para penetrar en los arcana imperii y salir sin daños definitivos de la lucha, una lucha por el simbolismo y su tradición, frente a los intentos destructivos de sus dominadores profanos e inmanentes».
Resulta transparente que de esta convicción y familiaridad con los diversos niveles de sentido del símbolo y del contacto con el fondo subyacente que circula ocultamente en el tiempo histórico, había extraído Schmitt confianza y serenidad para profundizar la comprensión teórica y sobrellevar la existencia práctica. Así lo demostró al haber aceptado voluntariamente ser juzgado por el Tribunal de Núremberg, denunciado por un ex colega de la Universidad de Berlín docente ahora en una universidad estadounidense, Karl Loewenstein y legal adviser del Jurado. La defensa personal que llevó a cabo Schmitt le exige trazar una sutil, pero precisa frontera, entre su pensamiento y la ideología nacionalsocialista y de este modo afirma que de ninguna manera podría haber influido en la política de los grandes espacios del III Reich, ni a preparar la guerra de agresión con sus consecuencias criminales, ni a gravitar en cualquier tipo de decisiones de los funcionarios de alto rango. Por ejemplo, defendió que su concepto de Grossraum (gran espacio) se basaba en el derecho internacional y no en el sentido nacionalista que le dio el régimen. A la categoría moderna de estado, válida desde Hobbes a Hegel, él contrapone la de “gran espacio”, que no es simplemente “espacio terrestre”, sino también “espacio imperial”. Aquí es en donde se juega el nuevo ordenamiento político-jurídico del planeta. Esta categoría no depende de la concepción biológico-racista del “espacio vital” (Lebensraum) ni de la categoría nacionalista (völkisch) nacionalsocialistas, para entender su concepción del “gran espacio”; sino que mejor, este último concepto se aproxima más a la doctrina Monroe norteamericana del principio de no injerencia de una potencia extranjera en un gran espacio terrestre ajeno, organizado según un orden jurídico-político propio. Un gran espacio imperial se forma cuando un estado desarrolla una potencia que excede sus propios límites y tiende a agregar en torno a sí a otros estados y es esta conveniencia de formar grandes bloques continentales la que puede generar un nuevo escenario de organización internacional, rompiendo la impotencia de las Naciones Unidas de Ginebra y conteniendo el ascenso de una superpotencia individual. Justamente el pequeño libro Tierra y mar si de entrada parecía aportarle complicaciones, explicado en su doctrina, le trajo la definitiva absolución en mayo de 1947, con curiosos diálogos durante el interrogatorio como el siguiente: «”En aquel tiempo me sentía superior. Quería dar un sentido propio a la palabra nacionalsocialismo”. “Por tanto, ¿Hitler tenía un nacionalsocialismo y usted otro distinto?”. “Yo me sentía superior”. “¿Superior a Hitler?” “Desde el punto de vista intelectual, infinitamente”.
Mircea Eliade, sin embargo, más joven y perteneciente a un país de cultura minoritaria, Rumania, si bien padeció el exilio y los severos obstáculos de un intelectual emigrado en París, no tuvo que enfrentarse con tan grandes dificultades. Las bases guenonianas de la organización de sus ideas, aunque menos conocidas por estar escritas en rumano y hechas conocer en publicaciones locales y muy poco difundidas, igualmente están registradas. Escribe así por primera vez M. Eliade en la revista Azi en abril de 1932, refiriéndose a Guénon, en una cita que se refiere al Teosofismo: historia de una falsa religión:
«Remito al lector al libro de Guénon, quien es un ocultista muy importante y muy bien informado, con una mentalidad sólida y que, al menos, sabe de lo que habla [a diferencia de Elena Blavatsky]» (Grottanelli, p. 346).
En 1937 escribe un artículo sobre Ananda Coomaraswamy en la Revista Fundaitilior Regale, republicado en 1943, y allí expresa que «es de lamentar que los escritos de Guénon, como Oriente y Occidente (1924) y La crisis del mundo moderno (1927), no hayan tenido sino una difusión limitada, ya que ellos mostraban que el tradicionalismo religioso no tenía nada que temer en Europa a la influencia de la metafísica oriental, contrariamente a lo que pensaban algunos escritores católicos» (Grottanelli, 346). Es razonable deducir, sin embargo, pese a las lamentaciones de Eliade y si se piensa en Schmitt y Evola, que el libro de Guénon La crisis del mundo moderno había tenido al menos repercusión propia en la derecha europea, como también lo tuvo en la Argentina, como hemos dicho, poco después de ser publicado.
En otro artículo aparecido en Vremea el l° de mayo de 1938, nuevamente Eliade se queja de la falta de difusión de la obra de Guénon y que sea tan poco conocida como la de Evola y Coomaraswamy . Hace igualmente aquí un curioso elogio de la personalidad de René Guénon como testigo de la tradición, «que era capaz de mostrar un desprecio absoluto y olímpico por el mundo moderno en su conjunto. Un menosprecio sin cólera, sin irritación y sin melancolía. Un desdén que alejaba a este pensador de los hombres de su tiempo y de su obsesión por la historia. Una actitud heroica, comparable, aunque preferible, a aquella de que hablaba André Malraux en su libro Le temps du mépris, que era el tema del ensayo de Eliade” (Grottanelli, 347).
Eliade en estos tiempos en los inicios de sus treinta años, cuando está forjando su personalidad de teórico e investigador considera a Guénon como un auténtico maestro en el campo de las ideas tradicionales, lo que incluso ratifica a su juicio la serena posición de desapego ante las corrientes de ideas modernas, aunque no emite el mismo juicio favorable en el campo de la investigación, como también lo ha expresado en el artículo dedicado a Coomaraswamy. A éste sí lo considera lingüística y filológicamente competente, mientras que para Guénon y Evola, en este campo, se le escapa la baja calificación de “dilettantes”. La evaluación en este último caso de M. Eliade es compleja, porque incluye aproximación y simpatía respecto de las ideas de fondo, pero alejamiento en el método de llegar a ellas, un fenómeno que vamos enseguida a comentar, pero antes debemos facilitar también otra ratificación que es de la misma época, y que se contiene en el libro Comentarii la legenda Mesterului Manole, que se refiere a las leyendas rumanas y balcánicas de los sacrificios de niños durante la construcción de edificios, en particular de monasterios y de puentes, que es publicado en Lisboa siete años después, en marzo de 1943, y en donde el autor confirma en el prefacio:
«Esta obra se publica con una demora de al menos seis años. En uno de los cursos de historia y de filosofía de las religiones que habíamos profesado en la Facultad de Letras de Bucarest (1936-1937, en reemplazo del curso de metafísica del Prof. Nae Ionescu), tuvimos la oportunidad de exponer en sus grandes líneas, el contenido y los resultados de este libro. Una versión técnica de estas lecciones, provista de todo el aparato científico necesario, se preparó hace ya bastante tiempo – bajo el título de Manole et les rites de cosntruction – para la revista Zalmoxis. Pero las circunstancias, y sobre todo la larga residencia del editor en el extranjero, han impedido la aparición regular de Zalmoxis, de modo que antes de publicar la versión técnica, hemos considerado que no estaría desprovisto de interés publicar los presentes Comentarios». Y prosigue el prólogo aportando esclarecimientos críticos y justificativos del mayor interés:
«Evidentemente es indispensable reunir, clasificar e interpretar los documentos etnográficos, pero esto no puede revelar mucho sobre la espiritualidad arcaica. Es necesario ante todo un conocimiento satisfactorio de la historia de las religiones y de la teoría metafísica implícita en los ritos, los símbolos, las cosmogonías y los mitos. La mayor parte de la bibliografía internacional que trata del folclore y de la etnografía es valiosa en la medida en que presenta el material auténtico de la espiritualidad popular, pero deja mucho que desear cuando trata de explicar este material, por medio de “leyes” al uso, a la moda del tiempo de Taylor, Mannhardt o Frazer. No es este el lugar de entablar un examen crítico de los diferentes métodos de interpretación de los documentos de la espiritualidad arcaica. Cada uno de estos métodos ha tenido, en su tiempo, determinados méritos. Pero casi todos se han ajustado a la historia (correcta o incorrectamente comprendida) de este o aquel documento folclórico o etnográfico, con preferencia a tratar de descubrir el sentido espiritual que ha tenido y restaurar su consistencia íntima. La reacción contra estos métodos positivistas no ha tardado en hacerse sentir y es especialmente expresada por un Olivier Leroy, entre los etnólogos, por un René Guénon y un Julius Evola, entre los filósofos, por un Ananda Coomaraswamy entre los arqueólogos, etcétera. Ella ha ido tan lejos que a veces ha negado la evidencia de la historia e ignorado en su totalidad los hechos recogidos por los investigadores» (Grottanelli, 350-351).
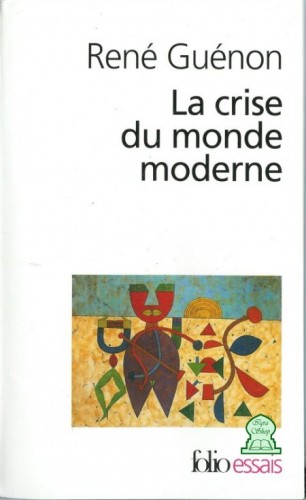 Nuevamente en este texto transparente están reunidas por Eliade las dos puntas de su posición de aceptación y crítica en relación con Guénon y otros autores vecinos por las ideas: simbolismo e ideas tradicionales garantizadores de la universalidad de las creencias sagradas como fondo organizador, pero a partir de la investigación científica. El reunir y avecinar documentos no es erudición positivista ni vacía, sino que en el allegamiento surgen ante la mente sensible y perspicaz a los fenómenos aproximadamente las ideas y principios transcendentes que subyacen. Las hierofanías, como manifestaciones de lo sagrado, revelan uniones o integraciones mediadoras que ligan a los contrarios –lo profano y lo sagrado- con equilibrio, lo organizan en sistemas estructurales en el lenguaje del símbolo y del mito, y permiten al alma religiosa arcaica y actual ascender a los orígenes constitutivos. No hay una diferencia insalvable acerca del reconocimiento del fondo espiritual entre Eliade y Guénon, sí lo hay en cuanto al método de acceso. Firmeza de la tradición y de la iniciación en cuanto a Guénon, ingreso por el reconocimiento de los fenómenos sagrados reflejados en la conciencia que cada vez exigen mayor comprensión, para Mircea Eliade. Guénon aspira a romper con lo profano para tener acceso no reflejo, sino directo a lo sagrado; Eliade, se sumerge en la dialéctica de lo sagrado y lo profano que acompaña a la vida del cosmos y la sociedad. Lo primero da una existencia digna de iniciados; lo segundo, de hombres en el mundo vitalmente sacro, que eligen diferentes destinos.
Nuevamente en este texto transparente están reunidas por Eliade las dos puntas de su posición de aceptación y crítica en relación con Guénon y otros autores vecinos por las ideas: simbolismo e ideas tradicionales garantizadores de la universalidad de las creencias sagradas como fondo organizador, pero a partir de la investigación científica. El reunir y avecinar documentos no es erudición positivista ni vacía, sino que en el allegamiento surgen ante la mente sensible y perspicaz a los fenómenos aproximadamente las ideas y principios transcendentes que subyacen. Las hierofanías, como manifestaciones de lo sagrado, revelan uniones o integraciones mediadoras que ligan a los contrarios –lo profano y lo sagrado- con equilibrio, lo organizan en sistemas estructurales en el lenguaje del símbolo y del mito, y permiten al alma religiosa arcaica y actual ascender a los orígenes constitutivos. No hay una diferencia insalvable acerca del reconocimiento del fondo espiritual entre Eliade y Guénon, sí lo hay en cuanto al método de acceso. Firmeza de la tradición y de la iniciación en cuanto a Guénon, ingreso por el reconocimiento de los fenómenos sagrados reflejados en la conciencia que cada vez exigen mayor comprensión, para Mircea Eliade. Guénon aspira a romper con lo profano para tener acceso no reflejo, sino directo a lo sagrado; Eliade, se sumerge en la dialéctica de lo sagrado y lo profano que acompaña a la vida del cosmos y la sociedad. Lo primero da una existencia digna de iniciados; lo segundo, de hombres en el mundo vitalmente sacro, que eligen diferentes destinos.
Esta diferencia de posiciones explica las relaciones entre ambos autores, que parecen incluir fuertes contrastes. Guénon desde 1940 en adelante comenta libros y artículos de Mircea Eliade en la revista Études Traditionelle, reconociendo sus aciertos de exposición e interpretación por momentos, así como desautorizándole agriamente en otras, abrogándose la postura de señor indiscutido del campo tradicional que le compete (Técnicas del Yoga, el tomo II de Zalmoxis, «Le “dieu lieur” et le symbolisme des noeuds» -RHR y referencia positiva en “Ligaduras y nudos”É.T., marzo 1950-, Le mythe de l’éternel retour, y otros escritos incluidos en Compte Rendus), una especie de rictus del tradicionalista francés que también ha dado origen a lo que podemos considerar lo más alejado de su magisterio, la “ideología guenoniana”. Mircea Eliade, por su parte, cuando comienza a publicar su difundida obra de especialista en Historia de la religiones a partir del Tratado de historia de las religiones que le publica Payot en l947, en donde recoge materiales anteriormente redactados y otros nuevos, apenas tiene en cuenta en la bibliografía del último capítulo sobre “La estructura de los símbolos”, un escrito de Guénon, Le symbolisme de la croix. Ni siquiera aparece el magisterio expressis verbis del maestro Guénon en los capítulos V (“Las aguas y el simbolismo acuático”) del Tratado y el IV de Imágenes y símbolos (1955), que reedita el primitivo artículo del número 2 de Zalmoxis que tanto le había interesado a Ernst Jünger. Sin embargo, en Le Voile d’Isis (Octubre de 1931) hay un artículo sobre Shet con una referencia a Behemot -en plural- del Libro de Job, como una designación general para todos los grandes cuadrúpedos, lo que es ampliado en el número de agosto-septiembre de 1938 en Études Traditionnelle en una colaboración sobre “Los misterios de la letra nun” (ambos artículos están recogidos más tarde por Michel Valsan –otro rumano- en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada) en donde Guénon se refiere al aspecto benéfico y maléfico de la ballena, con su doble significado de muerte y resurrección, y su vinculación con el Leviatán hebreo y Behemot, como “los hijos de la ballena”. Este trabajo está dentro de la línea de símbolos desarrollados por C. Schmitt en Tierra y mar –Behemot, Leviatán, Grifo- y puede haber sido conocido por el autor alemán.
Mircea Eliade, sin embargo, en su fecunda y subsiguiente producción hace silencio sobre Guénon. Recién en escritos de la década del setenta, el artículo que hemos citado antes sobre la “Theosophia oculta” se refiere a él con elogios y en Ocultismo, brujería y modas culturales, publicado por la Universidad de Chicago en la segunda mitad de los 70, le dedica dos referencias elogiosas a su postura intransigente y bien fundada frente al ocultismo acrítico y optimista de la segunda mitad del siglo XX y algo más de tres páginas para presentarlo como el renovador del esoterismo contemporáneo. Por otra parte, su interpretación de la doctrina cíclica del autor como pesimista y catastrófica en esas páginas demuestra no haber comprendido la concepción guenoniana de los ciclos cósmicos fundada en el Vedânta no dualista de Shankara que incluye ciclos internos espiralados contenidos en el ciclo mayor de un kalpa o “día de Brahman”, con sus manvantaras y yugas, identificando esta visión hindú con la mítico-greca de los pueblos arcaicos, una ligereza de interpretación que el mismo Guénon le había reprochado en la reseña que le dedicó al Mito del eterno retorno. Los silencios y lagunas de comprensión de Eliade sobre R. Guénon, al que reconocía como maestro y orientador en su juventud son sospechosos y el haberlo acantonado a ser “el representante más prominente del esoterismo moderno” sin rastros de su influencia docente sobre él mismo, tal vez despunte una solución en la opinión enseguida proferida en el escrito al que nos estamos refiriendo: «Durante su vida Guénon fue más bien un autor impopular. Tuvo admiradores fanáticos, pero muy pocos. Sólo después de su muerte, y en especial en los diez o doce años últimos, sus libros fueron reeditados y traducidos, difundiendo ampliamente sus ideas» (p. 107).
Casi contemporáneamente en los diálogos sostenidos con Claude-Henri Rocquet y que se han publicado en español bajo el título de La prueba del laberinto (1980) respondiendo a una pregunta del entrevistador, torna a hacer Eliade declaraciones sobre Guénon, pero en este caso resultan incluso más desconcertantes para el lector, por ser contradictorias con lo que hasta ahora se ha podido demostrar. Porque afirma primero el estudioso rumano: «Leí a René Guénon muy tarde y algunos de sus libros me han interesado mucho, concretamente L’Homme et son devenir selon le Vedanta, que me ha parecido bellísimo, inteligente y profundo». A continuación vienen expresadas algunas reservas del autor acerca de lo que no le agrada del escritor francés: su lado exageradamente polémico, un cierto tic de superioridad y un balance de repulsa de toda la cultura occidental -incluida la universitaria- y el respaldo persistente en un concepto complejo y carente de univocidad como es el que pretende sostener sobre la tradición. Este último análisis es bastante discutible, porque Eliade no demuestra poder facilitar un concepto rigurosamente diáfano de tradición, pero sobre todo, creemos que hay que llamar la atención sobre la aclaración de que «leyó a René Guénon muy tarde», puesto que los datos recopilados de su historia de juventud confirman lo contrario. Parece ser que el libro que era el estandarte de la cruzada en la que participaba con otros jóvenes intelectuales en los años treinta en Bucarest, La crisis del mundo moderno, era un obstáculo difícil de salvar para un exitoso profesor que se movía con facilidad en el ambiente universitario estadounidense.
Conclusiones sobre René Guénon y su influencia sobre Eliade y Schmitt.
La atmósfera cultural de la posguerra en París en la que un estudioso rumano de las religiones próximo a los cuarenta años o ya entrados en ellos, hubo de abrirse camino en la Sorbona y los círculos de investigación que la rodeaban, debieron gravitar pesadamente sobre el refugiado político Mircea Eliade. Se sabe de los problemas que tuvo Guénon para que le fuera admitida como tesis universitaria la Introducción general a las doctrinas hindúes, la que finalmente le fue rechazada, y su reacción de abandono del medio universitario. Si el refugiado Eliade, no obstante el apoyo que le prodigaron especialistas franceses como H.Ch. Puech, G. Dumézil, M. Masson-Oursel, L. Renou y otros, tuvo muy serias dificultades para insertarse en el entorno universitario parisino e incluso que en ciertos momentos las dificultades provinieron de la presión política con que lo asediaba el aparato de la inteligencia policial de su país de origen, el silenciar los contactos doctrinales con Guénon cuando era integrante de la Guardia de Hierro durante parte de los años 30 y los primeros del cuarenta, miembro activo de sus avatares políticos y publicaba en sus órganos de prensa y, además, la previsión de no irritar a sus benefactores parisinos inmediatos rompiendo “la conspiración del silencio” que pesaba sobre Guénon en los grupos universitarios oficiales franceses, era cuestión de vida o muerte en aquella etapa para la existencia académica y de investigación del notable universitario que llegó a ser el exiliado rumano. Posteriormente insertado sólidamente en el contexto de la vida universitaria de occidente, el prejuicio lo persiguió como un fantasma. En el fondo, del entramado teórico de sus trabajos quedaba, sin embargo, la influencia teórica subyacente con la que gracias al estímulo doctrinal de Guénon organizó sus aspiraciones de transcendencia al definir la naturaleza religiosa, simbólica y mítica del hombre arcaico y de su desarrollo cósmico.
El caso de Carl Schmitt, sin embargo, fue diverso y transparente, puesto que cuando tiene casi concluido Tierra y mar y está obsesionado por su contenido y recibe a un joven funcionario de Embajada rumano -el que había llevado un mensaje privado a Antunesco, el hombre fuerte del régimen militar de Bucarest del par portugués Salazar-, tiene 54 años. Alemania está en plena guerra europea y el jurista prestigioso se encuentra enfrentado con parte del entorno nacionalsocialista. Las lecturas que había realizado de Guénon estimulaban sus creencias católicas firmes y le permitían utilizar el simbolismo para la interpretación transcendente y velada de los acontecimientos histórico-políticos. Ningún riesgo de fondo corría, al contrario, con este tipo de incursiones culturales profundas, según su mejor inclinación, le era posible ampliar su figura de gran jurista del derecho internacional y afirmarse como filósofo e intérprete político-jurídico del difícil momento del proceso bélico alemán.
El tiempo transcurrido desde entonces hasta hoy parece darnos la razón. Y al ver confluir las tres poderosas personalidades sobre un mismo tema, el de la interpretación de los fenómenos visibles y próximos de la religión, la política y la historia, permite dar asimismo una pincelada de profundidad a lo que hoy día se está mostrando incontrolable y difícil de silenciar en la esfera de la política práctica y de la teoría política: que no es posible pensar en los hechos actuales si no nos liberamos de ellos elevándonos al plano de la metapolítica, bien sea desde la teología o desde la metafísica. La teología política de Jacobo Taubes y de Jian Assmann así lo están reclamando en los centros de estudio internacionales, pero las dos figuras que hemos tratado inspiradas por René Guénon, confirman que la necesidad de implantar el llamado “modelo dualista”, que no es ni simplemente teocrático ni representativo individualista, ofrece matices y recursos para que el ciudadano de los comienzos del siglo XXI se ponga a pensar seriamente que la marcha de los pueblos y sus ordenamientos políticos, jurídicos y económicos son inseparables de algún modo de trascendencia sagrada y tradicional.
Bibliografía
C. Bori, «Théologie politique et Islam. À propos d’Ibn Taymiyya (m. 728/1328) et du sultanat mamelouk», en RHR, 224 (207), 1, 5-46.
A. Désilets, René Guénon. Index-Bibliographie, Les Presses de L’Université Laval, Québec, 1977.
P. Di Vona, «René Guénon e il pensiero di destra», en La destra como categoria, Hermeneutica, Istituto di Scienze Religiose dell’Università degli Studi di Urbino, 1988, 59-85.
M. Eliade, Tratado de historia de las religiones, Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1954.
M. Eliade, Imágenes y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso, Taurus, Madrid, 1955.
M. Eliade, «El ocultismo y el mundo moderno», en Ocultismo, brujería y modas culturales, Marymar, Buenos Aires, 1977, 79-108.
M. Eliade, La prueba del laberinto, Cristiandad, Madrid, 1980.
M. Eliade, Memoria I. 1907-1937. Las promesas del equinoccio, Taurus, Madrid, 1982.
M. Eliade, De Zalmoxis a Gengis-Khan. Religiones y folklore de Dacia y de la Europa Oriental, Cristiandad, Madrid, 1985.
M. Eliade, Diario. 1945-1969, Kairós, Barcelona, 2000.
F. García Bazán y otros, René Guénon o la tradición viviente, Hastinapura, Buenos Aires, 1985.
F. García Bazán, René Guénon y el ocaso de la metafísica, Obelisco, Barcelona, 1990.
C. Grottanelli, «Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942», en Revue de l’Histoire des Religions, tome 219, 3 (2002), 325-356.
J.-P. Laurant, «Guénon, René», en J. Servier (dir.), Diccionario AKAL crítico de esoterismo, 2 vols., Akal, Madrid, 2006, A-H, 753-756.
T.M.P. Mahadevan, Guadapâda. A Study in Early Advaita, University of Madras, 1975.
C. Schmitt, Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal con un prólogo de Ramón Campderrich y un epílogo de Franco Volpi, Trotta, Madrid, 2007.
J. Taubes, La teología política de Pablo, Trotta, Madrid, 2007
Fuente: Centro de Estudios Evoliano
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : carl schmitt, mircea eliade, rené guénon, allemagne, france, roumanie, philosophie, tradition, traditionalisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 avril 2013
Vilfredo Pareto: A Non-Marxist Sociologist
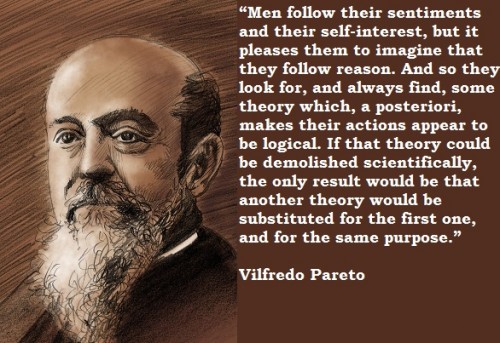
Vilfredo Pareto: A Non-Marxist Sociologist
He was first an economist known for two economic concepts named after him: Pareto Optimality and Pareto’s Law of Income Distribution. Pareto Optimality refers to the optimal allocation of resources when it is only possible to make someone better off by making someone else worse off. Pareto’s Law of Income Distribution was derived from British data on income. and showed a hierarchical relationship between each income level and the number of people at the next income level. He found similar results for Prussia, Saxony, Paris, and some Italian cities. Pareto thought his law should be “provisionally accepted as universal” but realised that exceptions were possible. Since then many exceptions have been found. He later changed from economics to sociology, and then became involved with Mussolini due to the political situation of the time.
His work on elites is of great interest and presents a more concrete view than Marxism, drawing from human nature rather than abstract ideology. His idea of the "circulation of elites” examines differences in the temper and style of different aspects of the ruling class, something he explores with his concept of Lions and Foxes. These categories give insight into how we are ruled or misruled. Rather than vague and dated abstractions about class behaviour, they are grounded in how people actually behave.
Why do things not stay the same?
Modernist art critic Herbert Read wrote in Form in Modern Poetry (1932) that the nature of man had changed from character to personality, with character being permanent and having solid traits, while personality was more fluid and changeable.
Why are we decadent and no longer capable of defending ourselves? According to Pareto, the ruling elite is not a stable ruling class but is subject to change, namely the "circulation of elites." He thought this circulation occurs because each of the two categories capable of leadership has inherent weaknesses. Whilst the Lions' act forcefully. they lack imagination and cunning; conversely, the Foxes possess cunning but fail to act coercively.
Pareto disputed that democracy was a progressive form of government; it was, he said, just another form of elite rule. A topical insight was that Foxes often ignore invasions until it is too late. We should know. We are living through one now!
Those who rise to positions of power promote their own kind and demote those who are different until finally one of the two types dominates. A professed support for the dominant ideology is necessary to retain one's social position, and transgressions are usually rewarded with demotion and infamy. Ideological correctness is crucial to whether individuals have influence or are removed from power. I call this dominant group an “ideological caste.”
Pareto believed that in all societies, including democracies, there is a class that rules and a class that is ruled. On weak rulers he wrote:
"Any elite which is not prepared to join in battle to defend its position is in full decadence, and all that is left to it is to give way to another elite having the virile qualities it lacks. It is pure day-dreaming to imagine that the humanitarian principles it may have proclaimed will be applied to it: its vanquishers will stun it with the implacable cry, 'Vae Victis.' ['Woe to the vanquished.'] The knife of the guillotine was being sharpened in the shadows when, at the end of the eighteenth century, the ruling classes in France were engrossed in developing their 'sensibility.' This idle and frivolous society, living like a parasite off the country, discoursed at its elegant supper parties of delivering the world from superstition and of crushing 'l'Infâme,' all unsuspecting that it was itself going to be crushed."
It is similar now with the girly-men running Western countries.
Lions and Foxes
His idea of “Lions and Foxes” originated in Machiavelli’s The Prince, a work that sought to formulate a rational plan of “how to rule” for new rulers who had no tradition to guide them. He advised the new ruler to be half beast and half man:
“So, as a Prince is forced to know how to act like a beast, he should learn from the fox and the lion; because the lion is defenceless against traps and a fox is defenceless against wolves. Therefore one must be a fox in order to recognise traps, and a lion to frighten off wolves.”
The Lions have what Pareto termed class II residues of group persistence. They have a sense of objectivity and permanence and believe in family, property, nation, church, and tradition. They are cautious in economics and value saving and “sound money.” They esteem character and duty over education and wealth, and will use force to uphold their values. They rely on their strength and stubbornness.
Foxes, tend to work in the talking professions, like journalism or the law, and live by their wits, shrewdness, deceit and fraud.
Pareto's Residues
There are six classes of Residues but the first two are relevant to our time. Class I residue is the Foxes’ instinct for “combination.” They tend to manipulate words and construct abstruse theories and ideologies. They do not have a strong attachment to church, family, nation, or tradition, but can exploit these loyalties in others. They are creative in economics and politics, and promote change and novelty. They do not plan far ahead and do not look to a great future for their people. They rely on their wits to thwart challenges and respond with ad lib answers to questions.
Pareto made a distinction between changing elements, which he termed derivations, and relatively permanent ones, which he termed residues. The notion of residues is often misunderstood. He meant manifestations of sentiments or their equivalents, which are intermediate between the sentiments, which we cannot know directly, and the overt belief systems and acts that we can know and analyse. They are related to man's instincts but they do not cover all of them, since we can only discover those instincts that give rise to rationalisations in theories. Others remain hidden.
A feature of Foxes is their distaste for the martial and a stress on economics. They tend to cut back on defences with the elites acting as if we are in a safe world and have no enemies. They think they can buy other countries off with overseas aid and good will!
A Survey of Political Change Over the Last Two Centuries
Looking back over history clarifies the effect that elites changing from Lions to Foxes has had on our lives and the standing of the nation. In the case of Britain, the dominant anti-British tendency that favours “the other” can be traced to the aptly-named Charles James Fox, the original of the type that has persisted and increased down to the present. He exhibited the Foxes' tendency for abstractions and high-sounding ideals, which is evident from his support for the principles of the French Revolution regardless of the horrific realities. He regarded our war with France as an attempt to crush a noble experiment in human liberty. In 1786, speaking against the former Governor-General of Bengal, Warren Hastings' response to an uprising by the Afghan Rohillas, he expressed the kind of universal abstractions that have become commonplace:
"By those laws which are to be found in Europe, Africa, and Asia – that are found among all mankind, those principles of equity and humanity implanted in our hearts which have their existence in the feelings of mankind…"
The radical MP Samuel Whitbread was even more anti-British than Fox, and excused the French while denouncing his own people. It was the dawning of our modern era when abstractions were coming to dominate and practical thinking was losing ground. Heroes like Nelson and Wellington were still at that time “role models” for young men, for their stoical and manly courage, selflessness, and high sense of duty. On the French Revolution Edmund Burke foresaw the decline of the values that Pareto associated with the Lions:
“It is gone, that sensibility of principle, that chastity of honour, which felt a stain like a wound, which inspired courage whilst it mitigated ferocity, which ennobled whatever it touched…The age of chivalry is gone. The age of sophisters, economists, and calculators has succeeded.”
The Duke of Wellington was a famous Lion. Like Churchill after him, Wellington had been uninterested in education as a schoolboy. Military types are typically less interested in ideas and theories. Although he defeated Napoleon, he was finally defeated by the Foxes, Cobden and Bright, who promoted free trade as a means of bringing about world peace. In 1846, the year the Corn Laws were repealed, Cobden said:
"I believe that the physical gain will be the smallest gain to humanity from the success of this principle. I look farther; I see in the Free Trade principle that which shall act on the moral world as the principle of gravitation in the universe – drawing men together, thrusting aside the antagonism of race, and creed, and language, and uniting us in the bonds of eternal peace."
Victorian historian James Anthony Froude lamented that we had chosen economics over duty. Foxes were taking over from Lions and this can be traced through the century as economics replaced values like “nobility,” “duty,” and “honour”. It was Disraeli who turned the Conservatives into an opportunistic party from one of tradition. He was a progressive Tory, and sympathetic to some of the Chartists' demands, and argued for an alliance between the landed aristocracy and the working class against the increasing power of the middle class. In 1842 he founded the Young England group to promote the view that the rich should use their power to protect the poor from exploitation by the middle class. During the twenty years which separated the Corn Laws and the Second Reform Bill, Disraeli sought Tory-Radical alliances - though unsuccessfully.
His main rival the Liberal Gladstone was a Fox. He was opposed to General Gordon, and tarried while that brave man was murdered in Khartoum. Gordon expressed the values of Lions in his journal, referring to “honour to his country”. The man who finally avenged Gordon and re-took Khartoum, Lord Kitchener, was worshipped by the public but attacked in the Commons as a “butcher” and “imperialist” by the Foxes. He was pushed out of the War Cabinet by Lloyd George, another Fox, who formed the War Cabinet, which had dictatorial powers and took over the running of the war. A reformer, Lloyd George also out-manoeuvred and replaced General Sir William Robertson, Chief of the Imperial Staff with one of his own kind, Sir Henry Wilson, who wrote more about the balls he attended and the dignitaries he met than anything connected to honour and duty. Robertson was forced to resign on 11 February 1918, taking the lesser role of Commander-in-Chief of the British Home Forces. Wilson had connived with Lloyd George to create the Supreme War Council, something which Robertson had vociferously opposed.
Robertson is the only man in history to rise to the position of Field Marshall from private. A staunch supporter of Sir Douglas Haig, Robertson acted to prevent Lloyd George's attempts to divert effort from the Western to the Eastern Front; unlike Lloyd George, Robertson was a keen 'Westerner', believing that the war could only be won on the Western Front. In his book Soldiers and Statesman 1914 – 1916 (1926) Robertson repeatedly stresses “duty”. He highlighted the anti-military bias of Foxes when he wrote of how Lloyd George and his war cabinet took a private house to seclude themselves from the Generals, “where they sit twice a day and occupy their whole time with military policy, which is my job; a little body of politicians quite ignorant of war and all its needs, are trying to run the war themselves.”
Stanley Baldwin turned the Conservatives from a party that was a bulwark of the Empire to one focused on offering inducements to voters such as “houses” and “prosperity.” A century of disarmament, fueled by both sides of the Commons – Tories preaching appeasement while dozing in their London clubs; Socialists fantasizing about internationalism, disarmament, and submitting to the League of Nations when we were the most powerful country – left us weak and nearly defenceless.
Before being removed or neutralised, Lions are first stigmatised. The Lion Churchill spent a decade in slandered obscurity as a “warmonger” before being needed to fend off Wolves. A Lion called Enoch Powell was sacked from the Shadow Cabinet by the arch-Fox Heath, who has since admitted misleading Parliament and thus the people into the federal state of Europe, saying that it would merely be a trading arrangement. Fox John Major deceived us when he pretended that we would retain control over our borders after his legal advisers had advised him that they had been signed away at Maastricht.
We have had constant moral outrages, such as Blair’s infamous act of sending our troops to war on a lie among his many other lies. Michael Howard, the Conservative leader in the 2005 election, campaigned on immigration control when he knew full well that the European Union would not allow him to implement his plans even had he meant to do so. In June 2004 it was revealed that he was an investor in communications firm Incepta. A subsidiary company, Citigate Lloyd Northover, won two Home Office contracts to develop websites and communications technology to speed up applications from immigrants to enter the UK and also benefitted from work for the Immigration and Nationality Directorate website that helped facilitate the admission and settling of asylum seekers.
Pareto clearly foresaw the deterioration of the Western world:
"The plutocracy has invented countless makeshift programs, such as generating enormous public debt that plutocrats know they will never be able to repay, levies on capital, taxes which exhaust the incomes of those who do not speculate... The principal goal of each of these measures is to deceive the multitudes... When a society's system of values deteriorates to the point where hard work is denigrated and 'easy money' extolled, where authority gives way to anarchy and justice to legal chicanery, such a society stands face to face with ruin... It is a specific trait of weak governments. Among the causes of the weakness two especially are to be noted: humanitarianism and cowardice – the cowardice that comes natural to decadent aristocracies and is in part natural, in part calculated, in "speculator" governments that are primarily concerned with material gain. The humanitarian spirit ... is a malady peculiar to spineless individuals who are richly endowed with certain Class I residues that they have dressed up in sentimental garb."
Cultural Marxists like university educated chief police officers because they are open to politically correct ideas and willing to enforce the Cultural Marxist agenda. The best sort of people to be appointed chief police officers would be former military officers as they understand human nature and how to best curb its excesses. In his autobiography Cloak Without a Dagger, the former chief constable of Sheffield and Glasgow and Director of MI5, Captain Sir Percy Sillitoe, gave this insight into human nature:
“There is only one way to deal with the gangster mentality. You must show that you are not afraid. If you stand up to them and they realise you mean business they will knuckle under. The element of beast in man whether it comes from an unhappy and impoverished background, or from his own undisciplined lustful appetites, will respond exactly as a wild beast of the jungle responds – to nothing but greater force and greater firmness of purpose.”
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vilfredo pareto, sociologie, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 avril 2013
La revolución necesaria
La revolución necesariaEx: http://alternativeeuropeaasociacioncultural.wordpress.com/ |
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, staséologie, révolution, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Revolutionary Lessons of Michael Collins

The Rising:
The Revolutionary Lessons of Michael Collins
By Gregory Hood
Ex: http://www.counter-currents.com/
Michael Collins is a must see for any revolutionary, especially those who feel all hope is lost. The film begins with defeat for the revolutionaries, and the survivors hiding like rats in underground tunnels. By the end, they are dictating policy in councils of state. For a White Nationalist, the rise of the eponymous hero is consistently inspiring.
But there is also the fall. Michael Collins shows the pretty rivalries, greed, and political miscalculations that can destroy any movement from within. This is not a paean to militancy for militancy’s sake. It is a warning of the costs of violence and the inevitability of betrayal. Perhaps more importantly, it shows how the end of a friendship can lead to the collapse of a state. It’s a graduate course in nationalist revolution.
It should be noted that we’ll look at this film mostly on its own terms, ignoring some of the historical errors. Chief among them is the horrifically unfair treatment of Éamon de Valera, easily the dominant Irish political figure of the 20th century. While these errors detract from the film, they do not destroy the film’s importance nor the lessons it has to teach us.
Lesson 1 – The Blood Sacrifice Establishes the State
Michael Collins begins [3] with the Easter Rising of 1916. A sweeping panoramic of a scene of battle eventually ends on the General Post Office [4] in Dublin, where Michael Collins (Liam Neeson) and the other Irish Volunteers are utterly outmatched by British soldiers using artillery. They surrender and are marched out, in uniform, by business-like British officers who contemptuously refer to the uprising as a “farce.”
Of course, in real life it was a farce, and far from popular among the Irish people. Many Irish had relatives fighting in the British Army during World War I, and the feeling of many in the Empire was that the Rising was a unforgivable stab in the back while Great Britain was fighting for its life on the battlefields of Europe. In some areas, Irish civilians physically fought with the Volunteers, and some were even killed. In actuality, it was a rather pathetic spectacle, with a tinpot army marching about in uniforms while their own nominal leader (Eoin MacNeill [5]) tried to stop it.
None of this matters. The British, quite justifiably from their point of view, made the decision to execute the leaders of the rebellion. We see Éamon de Valera (Alan Rickman) writing a letter to Michael Collins while the now legendary figures of Connelly, Pearse, and Clarke are executed one by one in the background. De Valera is spared because he is an American citizen and writes to Collins, “The Irish Republic is a dream no longer. It is daily sealed by the lifeblood of those who proclaimed it. And every one of us they shoot brings more people to our side.”
Michael O’Meara writes in “Cú Chulainn in the GPO” in Toward the White Republic [6] that the violent birth of the Irish Republic was no accident. It the living out of a myth [7], a “noble Ireland won by violent, resolute, virile action” inspired by “millenarian Catholicism (with its martyrs), ancient pagan myth (with its heroes), and a spirit of redemptive violence (couched in every recess of Irish culture)” (p. 55).
The “slaughtered sheep” would brighten “the sacramental flame of their spirit.” O’Meara concludes that the sacrifice was not just for Ireland, but for a spiritual rebirth that would justify the Irish nation’s renewed existence, “for the sake of redeeming, in themselves, something of the old Aryo-Gaelic ways” (p. 59).
Once the sacred blood of revolutionaries was spilled, the Irish Republic became real, though it possessed no currency, territory, or international recognition. The policies enacted by the Irish Republic headed by de Valera became the political expression of the Irish nation, rather than a mummer’s farce of self-important and deluded men. The blood of fallen patriots made it real, the reaction of the British Empire granted it recognition, and the support of the Irish people followed in the wake of martyrdom. By losing, the Irish Volunteers won, for as Pearse said, “To refuse to fight would have been to lose. We have kept faith with the past, and handed down a tradition to the future” (p. 59).
Or, as de Valera put it in the film, “And from the day of our release, Michael, we must act as if the Republic is a fact. We defeat the British Empire by ignoring it.”
In the American experience, there are already proto-nationalist “governments” and states in exile. Harold Covington’s “Northwest American Republic [8],” the “Southern National Congress,” and the League of the South, and innumerable other would-be Founding Fathers make claims to be the political expression of various peoples. However, without the blood sacrifice, and the “recognition” granted by the military repression and extreme political reaction, such movements remain in the realm of myth [9].
Of course, that is where all nationalist movements have to begin.
Lesson 2 – The Transfer of Legitimacy Is Mental Before It is Political
In the American context, there’s a tiresome emphasis on individual “freedom,” which has become an all but meaningless phrase. In response, one should remember the admonition of Italian nationalist leader Giuseppe Garibaldi, that “Without Country you have neither name, token, voice, nor rights, no admission as brothers into the fellowship of the Peoples. You are the bastards of Humanity. Soldiers without a banner, Israelites among the nations, you will find neither faith nor protection; none will be sureties for you. Do not beguile yourselves with the hope of emancipation from unjust social conditions if you do not first conquer a Country for yourselves.”
Michael Collins believes something similar. As an organizer addressing a restive crowd soon after his release from prison, his theme is not that the British are “unfair” or that the Irish need “equality.” He tells the people that the Irish nation already exists, though it’s legitimate leaders are rotting in English jails. “I was in one myself till a week ago,” he jokes.
He continues [10], “They can jail us, they can shoot us, they can even conscript us. They can use us as cannon fodder in the Somme. But, but! We have a weapon, more powerful than any in the arsenal of their British Empire. And that our weapon is our refusal. Our refusal to bow to any order but our own, any institution but our own.”
Here, Collins skillfully draws the distinction between the institutions of “their” Empire and contrasts it with the legitimate institutions that “we” can build – and bow to. More importantly, pointing aggressively at the “our friends at the Royal Irish Constabulary,” he identifies the people who want to “shut me up” and challenges the Irish people to raise their voices if he is cut down.
This speech pays dividends when Ned Broy (Stephen Rea), a detective working for The Castle (the center of British power in Ireland), warns Collins that the entire cabinet of the Irish Republic is to be arrested. Broy (a composite of the real Ned Broy [11]and other characters) justifies his decision on the grounds that Collins can be “persuasive . . . what was it you said, our only weapon is our refusal.” The Irish Broy (whose name is repeatedly mispronounced by his English superiors) has transferred his loyalty from the state that pays his salary, to the new state that serves as the political expression of his people. This is the “revolution in the hearts and minds of the people” (to use John Adams’s phrase) necessary for any nationalist movement to succeed. It is also the outgrowth of de Valera’s entire strategy of building a parallel system of state.
Lesson 3 – Power Trumps Legalism
 Unfortunately, when we see the legitimate political expression of the Irish people in action, it is not impressive. The Cabinet of the Irish Republic is meeting in a tunnel. Dressed in suits and ties and carrying briefcases, they seem unlikely revolutionaries, squabbling over the extent of each minister’s “brief” and constantly pulling rank on one another.
Unfortunately, when we see the legitimate political expression of the Irish people in action, it is not impressive. The Cabinet of the Irish Republic is meeting in a tunnel. Dressed in suits and ties and carrying briefcases, they seem unlikely revolutionaries, squabbling over the extent of each minister’s “brief” and constantly pulling rank on one another.
Michael Collins and his sidekick Harry Boland (Aidan Quinn) are in, but not of this bureaucracy. Collins contemptuously dismisses a colleague’s charge that he is simply Minister for Intelligence by saying he’s the Minister for “Gunrunning, Daylight Robbery, and General Mayhem.” Interestingly, de Valera smiles wryly at this.
Collins reveals that the entire Cabinet is to be arrested but Éamon de Valera sees this as an opportunity, not a danger. As President of the Irish Republic, he orders everyone to sleep at home – if they are all arrested “the public outcry will be deafening.” Of course, when de Valera is arrested, he’s dragged into a truck yelling futilely about an “illegal arrest by an illegal force of occupation” – a strange claim from a revolutionary leader. Significantly, Collins and Boland disobey their “chief,” escape capture, and make plans to accelerate their program of guerrilla warfare.
Earlier, we saw Collins leading an attack on an arsenal to capture weapons. He tells his guerrillas that they will be organized in “flying columns” and engage the enemy on nobody’s terms but their own. The resource conscious Collins warns them each gun must be expected to capture ten more. At the same time, he imposes a core of discipline typical of a standard army.
This dual approach parallels his approach to the state. He recognizes the legitimacy of “his” government, the Irish Republic. His ultimate loyalty is to his “chief,” Éamon de Valera. At the same time, Collins recognizes that a revolutionary army – and government – has to impose costs on its adversary if it is to be effective. To “ignore” the British Empire is enough when it comes to the personal transfer of loyalty necessary for national liberation. However, to actually break the control of the system, there has to be concrete action.
This means breaking the “rules” that normal states obey. A national liberation army will use the “uniform of the man in the street,” the guerrillas will attack and fade away when necessary, and the chain of command must occasionally be violated for tactical reasons.
Lesson 4 – Intelligence Determines the Fate of Insurgencies
Early in the film, Collins is told that British Intelligence “knows what we [had] for breakfast.” In response, he says, “There’s only one way to beat them then. Find out what they had for breakfast.” In order to test whether he can trust Broy, he asks for admittance to The Castle so he can check the files the enemy possess about the Irish liberation movement. He’s stunned at the extent of what they know and comments to Broy, “You could squash us in a week.”
Nationalists and dissenters sometimes look to asymmetrical warfare as an invincible tactic for defeating the system. In reality, it is the weapon of the weak, and the price of weakness is that you most often lose. A powerful system can infiltrate, subvert, and destroy revolutionary organizations through legal pressure on individuals, financial enticements to informers, and well trained double agents. It’s no coincidence that the quasi-government Southern Poverty Law Center openly styles itself as a secret police force with an “Intelligence Report” used to destroy the personal lives of people they don’t like.
Lacking financial resources and functioning bureaucracies, a revolutionary group has to rely on the iron character of its members, and while this sounds idealistic and proud, the hard reality is that no group in history has been free of human weakness. As Americans learned in Iraq and Afghanistan during successful counter-insurgency operations, even groups that think they are fighting for God are capable of being corrupted. Any revolutionary movement can be penetrated, and once it is penetrated, it is easily destroyed.
Collins is aware of this, and comments to his men, “Any of ye who have read Irish history know that movements like ours have always been destroyed by paid spies and informers.” However, “without [informers], the Brits would have no system, they couldn’t move.” In response to this reality, there is only one thing to do. Cigarette hanging out of his mouth like a gangster, he dictates a letter. “To whom it may concern: This is to inform you that any further collaboration with the forces of occupation will be punishable by death. You have been warned. Signed, the Irish Republican Army.”
Here, Michael Collins establishes a strategic objective. “Now imagine Dublin with The Castle like an enclave, where anyone, and I mean anyone who collaborated knew he’d be shot. They wouldn’t be able to move outside those fucking walls.” We have only to look at the American experience in Iraq guarding informers or the Mexican struggle against narco guerrillas (where the police cover their faces out of fear) to know that nothing has changed.
The one advantage a nationalist revolutionary has is that he knows the terrain better than the people he is fighting. If both sides are fully dependent for intelligence on their own resources, without the benefit of paid informers, the nationalists are going to win. After all, they are fighting amidst their own people.
One thing Michael Collins exploits throughout the entire film is that no one (other than Broy) knows what he looks like. This is remarkably unlikely in the film, seeing as how Collins is so bold as to go up and talk to various policeman. Furthermore, for our purposes, this is hardly a realistic strategy in the age of street cameras, social networking, and ubiquitous smart-phones and video.
Nonetheless, revolutionaries don’t have to make it easy for the enemy’s intelligence gathering efforts – so maybe you should take a second look at what you’ve put on your Facebook profile.
Lesson 5 – Make the Political Disagreement a Personal Cost
Collins sets up the “12 Apostles” who systematically murder collaborators and secret policemen. These are men, after all, who are just doing their job to protect the established system. The film takes care to show that some of them are churchgoers and prayerful men, hardly moral monsters. Nonetheless, they must die.
Collins makes his political struggle very personal. Earlier, an outraged policeman shouts at a captured IRA member that he won’t give in to their demands. “What, give up our jobs, and miss out on all the fun?” In response, the IRA member spits back, “Or face the music.”
In this context, obviously this means violence. However, this lesson also applies in “normal” politics.
Certainly white advocates know, often with bitter personal experience, the costs of standing for your beliefs. Though these costs can be exaggerated, jobs, “friends,” and even family have been known to turn on white advocates once they are “outed” or targeted for extermination by the powers that be. A huge number of would-be white advocates are simply too intimidated by the social or financial costs to engage in racial or Traditionalist activism, and so instead they engage in harmless distractions (like libertarianism or Republicanism) or simply drop out altogether.
However, Leftists have also paid the price for political activity on occasion following campaigns by their political opponents. Few political activists – of whatever opinion – can survive in the midst of a personal campaign against them. Even in normal bourgeois politics, we are familiar with the term “throwing someone under the bus.”
A winning political movement increases the costs of association with an opposing political movement. This is all Michael Collins really does – an informer or collaborator has to consider for the first time whether the benefit of payment outweighs the possible cost of violent death. As the spiritual momentum is on the Irish nationalist side, Collins has changed the entire momentum of the conflict.
There’s a word to describe an effort by one group to break the will of another. That word is war – and politics is simply war by the other means.
Thus, Collins freely admits that he “hates” the British. He hates them not because of their race or religion, but because there is no other way. “I hate them for making hate necessary.”
Lesson 6 – Weakness is worse than cruelty; symbolism must be backed by power
While Michael Collins and Harry Boland are waging their guerrilla war, Éamon de Valera is rotting in an English jail. However, he manages to sneak out a copy of the key, and Collins and Boland manage to rescue their chief. Éamon de Valera is seen in a mass rally in Dublin, while the British police stare at him powerless. However, de Valera repeats his earlier mistake and decides that he wants to go to America to seek recognition from the American President. Perhaps more importantly, he takes Harry Boland with him.
It is left to Michael Collins to continue the war, which escalates when the arrival of MI5 Operative Soames (Charles Dance aka Tywin Lannister). Soames suspects Broy, possibly because the latter is constantly correcting his superior as to the proper pronunciation of his Irish name. He catches Broy in the act and has him killed, but is killed himself when Collins launches the assassinations of November 21, 1920 (Bloody Sunday).
When de Valera returns to Ireland having failed to secure diplomatic recognition, he begins a bureaucratic offensive against Collins. He orders the IRA to abandon guerrilla tactics because it allows the British press to call them “murderers.” Instead, he wants large-scale engagements, such as an attack on the Customs House. The attack leads to devastating losses among Republican forces (though the movie neglects to show its positive propaganda effects). Not surprisingly, Collins sneers at the “heroic ethic of failure” of 1916. There is no need for a further blood sacrifice – the British must be brought to their knees “they only way they know how.”
Saul Alinsky wrote in Rules for Radicals that the concern with means and ends varies inversely with one’s proximity to the conflict. Or, as Michael Collins protests to de Valera, “War is murder! Sheer, bloody murder! Had you been here you’d know that!” The attack on the Customs House almost breaks the IRA, and Collins believes that the rebellion is within days of being destroyed in the aftermath.
Éamon de Valera is conscious of his own dignity and the dignity of the Irish Republic as a “legitimate” government. It is not surprising that he favors tactics typical of a “normal” state. However, a revolutionary state is by definition not “normal.” Concessions are won not with fair play and appeals to common principles, but with force. In international relations, little has changed since Thucydides – “the strong do what they can and the weak suffer what they must.” Paradoxically, the Irish Republican (or any revolutionary state) can only be brought into existence by methods that can be characterized as “illegitimate.”
Lesson 7 – The head of a revolutionary movement must participate in, if not command, the war effort
Éamon de Valera was no coward, having participated in the Easter Rising of 1916. However, throughout the film, de Valera shows a curious inability to recognize what is actually happening on the ground. He sees no problem in taking Michael Collins’s most trusted lieutenant Harry Boland at a critical moment in the guerrilla struggle for what is essentially a public relations mission. His attack on the Customs House is launched despite the blunt warning of Michael Collins that it will lead to disaster.
It’s suggested that most of this is motivated by de Valera’s jealousy of Collins and his desire to eliminate a political rival. When Collins and Boland break de Valera out of prison, there is a brief moment of comradely laughter before the chief mentions unpleasantly that he can see the two of them are having a good time because he “reads the papers.” When he returns from America, he is picked up by one of Collins’s aides who tells him “the Big Fella (Collins) sends his regards.” Éamon de Valera spits back, “We’ll see who is the big fella.”
The film strains to present Éamon de Valera as selfish, perhaps even evil, but most of his actions are more than justified from a political perspective. Irish independence is, after all, dependent on negotiations with the British, and there is a strong case to be made that they will not negotiate with people they consider to just be savage murderers. Furthermore, American pressure on Britain in the midst of World War I would have been an invaluable asset to the Irish diplomatic effort. Finally, as President of the Irish Republic, de Valera would be insane to allow a powerful rival with military backing emerge as a separate power center within the government. Removing Boland is a potent political step – as Collins himself recognizes. “We were too dangerous together,” he muses to Boland when the break is beyond healing.
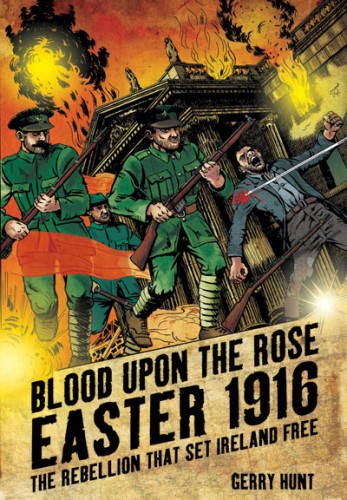 The problem is that all of this political maneuvering should be secondary to his primary role of leading a military effort. Though de Valera is obviously commander in chief, he has little connection to actual military operations throughout the film. This is at least a partial explanation for his stunning strategic incompetence.
The problem is that all of this political maneuvering should be secondary to his primary role of leading a military effort. Though de Valera is obviously commander in chief, he has little connection to actual military operations throughout the film. This is at least a partial explanation for his stunning strategic incompetence.
Throughout the film, there is a fatal separation between the head of the state, the development of strategy, and the execution of a guerrilla war. Éamon de Valera bears heavy responsibility for this because of his disastrous choice to abandon the field for America. This dereliction of duty ultimately forced Collins to take almost sole command of the war for independence, despite his personal loyalty to his President. Éamon de Valera had to act as he did in order to maintain his political leadership, but his ceding of military leadership had catastrophic consequences. If he had stayed in Ireland, none of his political maneuvering would have been necessary.
In a revolutionary movement, there can be no separation between the so-called “civilian” and military leadership. It is a thinly veiled fiction in our democracies anyway. The conflict between Michael Collins and Éamon de Valera was inevitable once the President of the Irish Republic saw his role as being a political leader, rather than a military “chief.”
Lesson 8 – The nationalist myth cannot be undone by pragmatism – even if the myth is becoming destructive
The final section of the movie focuses of the Irish Civil War. Michael Collins brings back the Anglo-Irish Treaty, which creates the Irish Free State, not the Irish Republic. The two most controversial elements of the treaty are an oath of allegiance to the British Crown and the partition of Northern Ireland.
The reunion between Michael Collins and his former sidekick Harry Boland is hardly joyful. Collins appears embarrassed as Boland asks him in horror, “Mick, is this true?”
Collins quickly turns his wrath on Éamon de Valera. “It was the best anyone could have got. And more important Dev knew it. He wanted somebody else to bring back the bad news.” Éamon de Valera for his part screams at Collins, “You published the terms without my agreement!” Collins challenges de Valera to stand by the treaty if the Irish people stand by it; de Valera is silent.
Instead, we see Éamon de Valera giving a passionate speech in front of a giant Irish tricolor. “This treaty bars the way to the Republic with the blood of fellow Irishmen! And if it is only through civil war that we can get our independence then so be it!”
When the debate takes place in the Dail, one of Collins’s political opponents charges, “When the people of Ireland elected us to represent the Republic, did they think we were liars. . . . Mr. Collins would have us take an oath of allegiance to a foreign king.” Collins wins narrow approval through his reputation and his plea to “save the country” from “a war none of us can even contemplate.” Nonetheless, Éamon de Valera refuses to accept the treaty, saying it can “only subvert the Republic” and continues his opposition even after the treaty is ratified by a referendum of the Irish people.
When the Irish Volunteers began their rebellion against the Treaty in the Irish Civil War, Collins is outraged when he is told that Churchill is offering the Irish Free State artillery. “Let Churchill do his own dirty work!” he rages. An aide responds, “Maybe he will Michael, maybe he will.” Collins has to put down the rebellion or risk the British seizing control. In uniform, with all the power of a modern state behind him, a disgusted Collins orders the artillery bombardment of a rebel stronghold. The opening scene is now reversed, with Michael Collins in the position of the British bombing the heroes of Easter 1916.
When Harry Boland is killed, Collins reacts with rage against the boy who shot him. “You killed him, you little uniformed git. You plugged him, you little Free State gobshite. You were meant to protect him!” Instead of the picture of Michael Collins we are familiar with, proud and dignified in his Free State uniform, Collins is disgusted with himself. After all, he is bombing his former comrades with weapons provided by the British Empire, in order to preserve a state nominally pledged to service of a foreign king.
Michael Collins was ultimately right that the Irish Free State was simply a “stepping stone to the ultimate freedom” for most of Ireland. Given the IRA’s weak military situation by the end of the war, the Irish Free State probably was, as Collins claimed, “the best anyone could have got.” As Collins’s supporters in the Dail pointed out, nowhere in the exchange of letters that preceded negotiations was the recognition of the Irish Republic made as a demand. Given that the Irish would gain a government of their own that they could use to “achieve whatever they wanted,” it does seem foolish to go to war “over the form of words.”
However, revolutions have a terrible logic all their own. The heroic myth of the nation rising to self-consciousness through the sacrament of the blood sacrifice is impervious to pragmatic considerations. Why did the Irish suffer and die if only to end up as subjects to the British Crown? How can any Irish patriot wear the uniform of a government that fires on Irishmen with British supplied weapons?
When Éamon de Valera and his deputies leave the hall, Collins screams, “Traitors! Traitors all!” But traitors to whom? Even Michael Collins seems to despise the uniform he wears. Nonetheless, he has made the (in my judgment, correct) rational decision that the Irish Free State is the best hope of achieving the national aspirations of the Irish people and that patriots owe it their allegiance. But myths are impervious to reason. The romantic impulses that can launch a revolution can also destroy it, if not controlled.
Saul Alinsky writes in Rules for Radicals that organizers must be masters of “political schizophrenia.” They must sincerely believe in what they are doing, if only to give them the strength of will to carry forward in difficult times. However, they should never become a “true believer” in the sense of fully internalizing their own propaganda. The point of politics is to achieve concrete ends, not simply to remain true to a dream.
The Myth of nationalist (and racial) redemption is True in some platonic sense. That doesn’t mean it has to be a suicide pact. Revolutionaries have to be willing to die for the dream, but idealism does not exempt them from the laws of political reality.
Lesson 9 – Revolutionary moments create opportunities that are lost in time, but they should be seized incrementally
While Collins was ultimately correct about the short-lived nature of even nominal British control over the Free State, the division of the North was fatal to hopes of a united Ireland. To this day, Ireland remains split, and the British flag flies over Ulster despite decades of revolutionary agitation and violent resistance.
Part of this has to do with the utter corruption of the Irish nationalist movement in the decades after his death. So called Irish nationalists like Sinn Fein have been reduced to arguing that the Republic desperately needs more black immigrants. In the centuries-long struggle between Catholics and Protestants, the winners might be the Nigerians.
There’s also the more substantial question as to whether Ulster Protestants under the Red Hand constitute a separate people, rather than simply existing as an outgrowth of British colonialism. Irish sovereignty over Ulster could be interpreted simply as another form of occupation.
However, from the viewpoint of contemporary Irish nationalists, the acquiescence to division of the country has to be seen as a disaster. The revolutionary momentum of the Free State period was ultimately lost as people reconciled themselves with the status quo of division. If a united Ireland was held to be truly non-negotiable, it had to have been accomplished within only a few years of the formation of the state. Instead, the status quo provides a fatal opening for “moderates” and “realists” to sell out the long term dream of unity for smaller political advantages.
In fairness, Michael Collins never fully reconciled himself to the division of Ireland. At the time of his death, he was planning a new offensive [12] in the North, this time with the backing of state power. Again, to turn to Alinsky, this is the proper course of action given political realities. Revolutionaries should always be ready to accept incremental gains, but should also continue moving the goal posts until they reach their ends. Certainly, the Left has been a master of this over the last century, as each new concession simply fuels the demand for more surrender by conservatives.
Revolutionaries should take what they can get – but never concede that the struggle is finished until they can get all of it. The tragedy for Irish nationalists is that the more “extreme” anti-Treaty partisans may have destroyed the hope of a united Ireland by killing Michael Collins. Michael Collins’s approach may have been more complicated and less ideologically satisfying, but ultimately more likely to succeed.
Lesson 10 – Draft the People
James Mason writes in Siege that white revolutionaries must see all white people as their “army.” The fact that they do not support us now is irrelevant – eventually, they will be drafted.
The IRA’s assassination campaign imposes great costs on the Irish people as a whole. The arrival of the auxiliaries and the Black & Tans unquestionably made life more difficult for ordinary people. The murder of the Cairo Gang led the British to strike back in a wild frenzy at an Irish football game, leading to the deaths of many ordinary people who had nothing to do with the political struggle. In the film, Collins rages at the brutality of the British. In practice, this is deeply dishonest. It’s only to be expected that the IRA’s campaign would lead to greater repression of the Irish people.
Terrorism and violent resistance may make life more difficult for the people you are trying to represent. This is not an unfortunate side effect – it is an intended reaction. Revolutionary movements should seek to expose the repression inherent in the system by refusing to let the authorities hide behind half measures. More importantly, a successful revolutionary campaign forces everyone in the country to take a side. It removes neutrality as an option. As the system can only maintain control by imposing greater costs upon the population, a revolutionary campaign that makes life worse for the people may have the paradoxical effect of garnering greater popular support.
As a revolutionary, you are taking upon yourself the responsibility of “dragging the people into the process of making history,” to use Dugin’s phrase. This requires a stern code of personal responsibility so as to live up to this mission. It also necessitates a willingness to pay a personal price. However, the most important quality revolutionaries have to possess is the moral courage to accept that you will be the cause of suffering among your own people. And when the time comes, like Michael Collins, you must do what is necessary to end that suffering.
Lesson 11 – Impose shared sacrifice and experiences among the leadership
It is no use calling for “unity” among the political leadership of revolutionary movements. By definition, anyone who is attracted to a revolutionary movement is going to be ideologically nonconformist and willing to risk all for the sake of principle. You put a group of these people in a room and they are going to fight about something eventually.
However, Michael Collins gives a different interpretation to the eventual break between Harry Boland and Michael Collins. Boland is in love with Kitty (Julia Roberts) but she wants to be with Collins. The growth of the relationship between Kitty and Collins moves in tandem with the collapse of the friendship between Boland and Collins. Though Collins continues to pledge his friendship to Boland, it is easy to understand Boland’s wrath at a man who essentially stole his girlfriend. Within the context of the film, the ideological differences between Boland and Collins seem like after the fact justifications for a rivalry based in petty personal conflict.
That said, there’s a deeper lesson to seen if the romantic triangle is interpreted as just a metaphor. Boland, Collins, and de Valera are politically and personally united when they share common experiences and common struggles. When de Valera is being spirited away from British raid to flee to America, Collins tells him, “Remember one thing over there. You’re my chief – always.” It’s only after Éamon de Valera returns from America that conflicts become truly serious. Éamon de Valera is no longer a “chief” but a politician. There is a host of separate experiences now separating Collins and his President.
The break between Boland and Collins follows a similar pattern. When Boland is Collins’s fellow guerrilla, they are inseparable. Despite the romantic tensions between the triangle, Kitty, Boland, and Collins are able to coexist in easy intimacy. However, when Boland and Collins develop separate institutional roles, the personal tension elevates into political rivalries and eventually, opposing camps in the government.
Revolutionary movements have to impose a common body of experience on all members insofar as it is possible. Different perspectives, backgrounds, and skills are all valuable and useful but not if they lead to division. At the risk of sounding like a sensitivity trainer, everyone involved in the movement should have a healthy respect for the circumstances and difficulties that all of them are facing in their different roles.
Conclusion
Several years ago, I recall that a white advocacy group fliers with pictures of Michael Collins in his Irish Free State uniform. Our sophisticated media and the well trained population immediately interpreted this as a picture of a “Nazi” in uniform, and there was the usual hysteria. This depressing anecdote shows that despite our information saturation, we live in a remarkably uninformed age. Even the millions of Americans of Irish descent have only the most distant knowledge of the Emerald Isle’s long struggle for independence.
White revolutionaries do not have the luxury of ignorance. If the battle for a white ethnostate is to follow the lines of an anti-colonial struggle, the Irish independence movement is the closest thing that we have to a modern model. The period of the Irish Free State and the Civil War shows not only how a successful movement can triumph, but how it can also destroy itself.
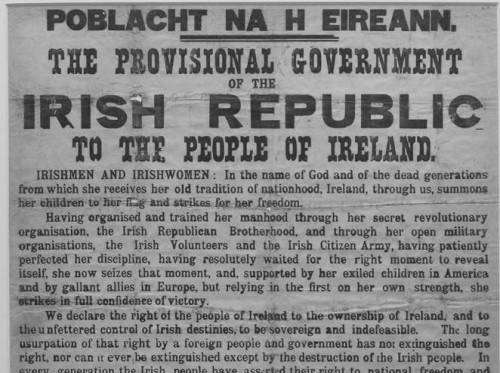
Michael Collins is a good beginning for any white revolutionary seeking to define the struggle. The quest for an ethnostate is not a struggle for “freedom” or some silly abstraction, but an order of our own and institutions of our own that will allow us to achieve what we desire as a people. To achieve this requires the power of Myth, the tactics of soldiers, and the skill of politicians. This Easter, commemorate the Rising by watching Michael Collins and absorbing its lessons. Then with more research into this movement and others, prepare for the Rising to come.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/03/the-rising-the-revolutionary-lessons-of-michael-collins/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/03/michaelcollinsposter.jpg
[2] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/03/michaelcollins.jpg
[3] begins: https://www.youtube.com/watch?v=Aq7bcY9tuao
[4] General Post Office: http://en.wikipedia.org/wiki/General_Post_Office_(Dublin)
[5] Eoin MacNeill: http://en.wikipedia.org/wiki/Eoin_MacNeill#Revolutionary
[6] Toward the White Republic: http://www.counter-currents.com/toward-the-white-republic/
[7] myth: http://www.counter-currents.com/2010/06/cu-chulainn-in-the-gpo/
[8] Northwest American Republic: http://www.counter-currents.com/2010/11/the-northwest-novels-of-h-a-covington/
[9] myth: http://www.counter-currents.com/2010/09/the-myth-of-our-rebirth/
[10] continues: https://www.youtube.com/watch?v=Vl11gInexsA
[11] Ned Broy : http://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Broy
[12] offensive: http://books.google.com/books?id=xscRAhBt2JgC&pg=PA397&lpg=PA397&dq=then+we+can+resume+in+the+north+michael+collins&source=bl&ots=8q51pboR5N&sig=AmuQIGaW6sMGy6gzjRSqHfViUW8&hl=en&sa=X&ei=vXdXUeiyAYL69QT3loGgDw&ved=0CEwQ6AEwAw#v=onepage&q=then%20we%20can%20resume%20in%20the%20north%20michael%20collins&f=false
00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution, irlande, pâques 1916, première guerre mondiale, théorie politique, sciences politiques, politologie, michael collins |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 avril 2013
Le mir
Le mir est une institution organique russe qui, depuis les premières tribus slaves jusqu’aux derniers élans soviets, a maintenu une tradition radicalement démocratique sur ses terres. Il est le pendant économique et social du vétché. Il signifie à la fois « commune », « paix » et « monde ».
Le mir est une structure autonome fondée sur la possession collective de la terre, l’obchtchina, et le partage auto-administré des produits du travail commun de ses membres. Cette commune agraire arbore un régime démocratique sous sa forme la plus simple et directe, sans représentation, où chacun prend part à toutes les délibérations et décisions. Régulièrement, dans chaque village ou canton (pouvant rassembler jusqu’à 30 villages), l’ensemble des paysans librement associés avaient la liberté de traiter eux-mêmes leurs affaires. La terre, divisée en lots égaux, était partagée par tirage au sort entre les individus capables de la travailler et tous les autres sur la base des bouches à nourrir. Tous les produits étaient alors mis en commun assurant ainsi le bien public dans toute la communauté.
Présenté de la sorte sur le papier, le mir semble quelque peu bucolique. La réalité était bien plus tumultueuse, voire séditieuse ! Lisons cette description explicite extraite du magistral « L’Empire des tsars et des russes » d’Anatole Leroy-Beaulieu :
La première chose qui frappe celui qui assiste pour la première fois à l’une de ces réunions est l’extrême confusion qui semble y régner ; de président point ; d’ordre dans les débats aucun. La discussion est caractérisée par des scènes de tumulte. Celui qui a convoqué l’assemblée expose les motifs de cette convocation. Aussitôt après chacun se rue dans la mêlée ; toutes les opinions s’expriment à la fois ; on dirait par moment un combat à coups de poings. Pour avoir la parole il faut savoir la prendre et la garder. Si l’orateur plaît, l’auditoire se charge d’imposer silence aux interrupteurs. Si ce qu’il dit n’a pas d’importance, on ne s’occupe pas de lui et le premier venu peut le faire taire. S’agit-il d’une question brûlante qui échauffe toute une assemblée, tous pérorent en même temps personne n’écoute. Fort souvent on se sépare en petits groupes qui continuent à discuter chacun de leur côté et pour leur compte ; Tout le monde vocifère ; de part et d’autre on crie, on s’insulte, on s’accable réciproquement de sarcasmes, on se défie ; c’est un tumulte indescriptible qui semble ne produire aucun bon résultat.
Cependant, cette apparente confusion est sans portée. C’est une nécessité indispensable pour arriver au but voulu. Dans nos assemblées de village le scrutin est inconnu ; aucune décision ne peut être prise à la majorité des voix. Toutes les questions se règlent à l’unanimité. Il en résulte que la discussion générale ou particulière se poursuit jusqu’à ce qu’on émette une proposition qui concilie autant que possible tous les intérêts et rallie les suffrages de tout le mir. Il est évident qu’en vue d’aboutir à cette issue chaque sujet est débattu à fond et bien épluché, et il est clair que pour triompher d’une opposition isolée, les orateurs qui défendent des opinions contradictoires doivent être mis en présence face à face et ne peuvent vider leur querelle que par un combat singulier.
L’assemblée ne contraint pas la minorité à accepter des résolutions auxquelles celle-ci ne consent pas. Chacun est obligé de faire des concessions pour le bien commun et pour la paix et la prospérité de la communauté. La majorité ne tire aucun avantage de sa supériorité numérique. Le mir n’est pas un maître. »
Sans être un maître il demeura néanmoins une autorité suprême qui perdurera même sous le joug mongol puis le servage moscovite. Les envahisseurs comme les oligarques s’épargnaient ainsi la gestion des affaires agraires… Mais cette relative autonomie fut accordée au prix de lourds impôts.
Ainsi, malgré les empiétements du pouvoir mongol puis tsariste, le mir a offert sur les terres des paysans une certaine harmonie. Par ailleurs ce potentiel plus démocratique que révolutionnaire a longtemps prémuni le pays à la fois contre la création d’un prolétariat misérable et l’incursion de la corruption occidentale.
Aussi, de nombreux intellectuels en ont fait l’éloge tout en s’en inspirant comme base d’un renouveau social : du Baron Westphalien à Kropotkine en passant par August von Haxtausen, Alexandre Herzen, Tchernychevsky, Bakounine, Lavrov, Mikhailovsky, et même…Marx ! Ce dernier s’en fera en effet un temps partisan, il l’a écrit noir sur blanc à Vera Zassoulitch :
L’actuelle propriété collective pourra servir comme point de départ pour une évolution communiste. Cette commune rurale est le point d’appui de la régénération sociale en Russie, mais afin qu’elle puisse fonctionner comme tel, il faudrait d’abord éliminer les influences délétères qui l’assaillent de tous côtés et ensuite lui assurer les conditions normales d’un développement spontané. »
Mais comme souvent avec les propos messianiques, quand ils sont mal interprétés ils peuvent vite engendrer le pire… Ainsi les marxistes considéraient le mir comme un reliquat de l’époque féodale qui devait laisser sa place à l’exploitation capitaliste agraire, favorisant dès lors l’avènement d’un …prolétariat rural ! Cette méconnaissance, voire ce déni, doublé d’une hostilité du monde paysan russe, engendra sa « solution finale » par l’extermination de millions de ses membres par les armes, la déportation ou la famine organisée, durant la guerre civile et la collectivisation forcée des années 1929-1934.
Cédric Bernelas
00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, histoire, mir, démocratie populaire, démocratie organique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 avril 2013
La Corporation chez Julius Evola
La Corporation chez Julius Evola
par Stéphane Blanchonnet
Ex: http://a-rebours.ouvaton.org/
Article paru dans L'Action Sociale Corporative numéro 5. Dans Le Fascisme vu de Droite – ouvrage disponible en français aux éditions Pardès – Julius Evola (1898-1974) propose une critique, au sens d'une analyse rigoureuse, méthodique et sans concession à l'égard de ses détracteurs comme de ses admirateurs, d'un régime et d'une idéologie dont il fut un compagnon de route atypique (Evola s'opposa notamment, dans un esprit contre-révolutionnaire, à l'importation du racisme biologique allemand, à l'abaissement du rôle de la monarchie, aux dérives étatistes et totalitaires). Ce livre publié en 1964 bénéficie à la fois de la proximité avec son sujet que donne à l'auteur sa qualité de témoin et d'acteur, ainsi que de la hauteur de vue que lui procurent la distance dans le temps et sa riche réflexion politique d'après-guerre, dont témoignent des œuvres comme Orientations (1950) ou Les hommes au milieu des ruines (1953). Deux chapitres du Fascisme vu de Droite retiendront particulièrement notre attention dans le cadre de cet article : le chapitre VIII consacré aux institutions fascistes en général et le chapitre IX consacré plus précisément au problème de la corporation et de l'organisation économique.
Dans Le Fascisme vu de Droite – ouvrage disponible en français aux éditions Pardès – Julius Evola (1898-1974) propose une critique, au sens d'une analyse rigoureuse, méthodique et sans concession à l'égard de ses détracteurs comme de ses admirateurs, d'un régime et d'une idéologie dont il fut un compagnon de route atypique (Evola s'opposa notamment, dans un esprit contre-révolutionnaire, à l'importation du racisme biologique allemand, à l'abaissement du rôle de la monarchie, aux dérives étatistes et totalitaires). Ce livre publié en 1964 bénéficie à la fois de la proximité avec son sujet que donne à l'auteur sa qualité de témoin et d'acteur, ainsi que de la hauteur de vue que lui procurent la distance dans le temps et sa riche réflexion politique d'après-guerre, dont témoignent des œuvres comme Orientations (1950) ou Les hommes au milieu des ruines (1953). Deux chapitres du Fascisme vu de Droite retiendront particulièrement notre attention dans le cadre de cet article : le chapitre VIII consacré aux institutions fascistes en général et le chapitre IX consacré plus précisément au problème de la corporation et de l'organisation économique.
Une nouvelle forme de représentation
Le chapitre VIII reconnaît d'abord au fascisme le mérite d'avoir abattu le parlementarisme. Outre la restauration de l'Etat, cette opération permet d'envisager une nouvelle forme de représentation qui tranche avec celle procurée par les partis parlementaires, structures dont le moyen est le clientélisme le plus vulgaire et la fin, non le service de l'Etat mais celui de leurs idéologies respectives : « ils se présentent dans une sorte de concours ou de compétition pour la meilleure défense des intérêts de tel ou tel groupe d'électeurs, mais en réalité ils ont chacun une dimension politique, chacun une idéologie ; ils ne connaissent ni intérêts ni exigences les dépassant, ils agissent dans l'état vide et visent chacun à la conquête du pouvoir : d'où une situation on ne peut plus chaotique et inorganique » (p. 75-76 de l'édition Pardès).
Evola voit immédiatement dans l'abolition de ce système l'occasion de rétablir une représentation qualitative et organique (des groupes, en fonction de leur rôle dans le corps social) et non plus quantitative (des individus selon le principe : un homme, une voix), sur le modèle des institutions de l'Europe d'avant 1789 : « parce que ce n'était pas la simple force numérique des groupes, des corps ou des unités partielles ayant au Parlement leurs propres représentants qui était considérée, mais leur fonction et leur dignité. » (p. 77).
Idéalement pour Evola, le nouveau régime aurait dû promouvoir une forme de bicaméralisme ainsi conçu : une Chambre basse représentant la société sur un mode qualitatif, différencié et organique (représentants des corporations professionnelles, de l'armée, de la magistrature et des autres corps) et une Chambre haute, un « Sénat, avec des membres exclusivement désignés d'en haut, choisis surtout en fonction de leur qualité politique, qualité de représentants de la dimension transcendante de l'état, donc aussi de facteurs spirituels, méta-économiques et nationaux » (p. 79) ayant pour but de faire prévaloir le plan des fins sur celui des moyens et proche en cela de l'idée d'un Ordre, au sens supérieur, traditionnel et religieux du terme. Hélas ce programme ne sera pas mis en œuvre, en tout cas pas dans toute la pureté de sa conception.
L'échec du fascisme
Le chapitre IX s'intéresse plus précisément à l'un des composants de la Chambre basse : la corporation professionnelle. Evola y affirme d'abord la nécessité de « s'opposer à une fonction de la corporation soit comme instrument d'étatisation centralisatrice, soit comme instrument de conquête de l'état par l'économie. » (p. 82). En effet, il décèle deux premiers écueils dans le programme corporatiste : celui du dirigisme qui tue la libre initiative du chef d'entreprise, la corporation étant alors conçue comme une courroie de transmission au service d'un contrôle étatique de l'économie, et celui de "l'état corporatif", la corporation devenant alors l'instrument d'une dissolution du politique dans l'économie.
A cela s'ajoute, le danger consistant à concevoir le corporatisme comme une superstructure nationale où les employeurs et les employés enverraient séparément et par branche leurs représentants, ce qui ne ferait qu'aggraver les antagonismes de classe. Sur ce dernier point, Evola constate l'échec du fascisme : « Le système institua […] sur le plan législatif le double front des employeurs et des travailleurs, dualité qui ne fut pas surmontée là où il aurait fallu, c'est-à-dire dans l'entreprise elle-même, au moyen d'une nouvelle structuration organique de celle-ci (donc dans sa structure interne), mais dans des superstructures étatiques générales affectées d'un lourd centralisme bureaucratique et, en pratique, souvent parasitaires et inefficaces. » (p. 85).
L'auteur oppose à ce modèle bureaucratique, la « reconstruction organique infrastructurelle » (p. 90) des corporations, c'est-à-dire, l'idée d'une entreprise-communauté conçue de manière analogue à la nouvelle vision organique de la nation. C'est dans chaque entreprise donc qu'il conviendrait d'organiser la représentation de tous selon sa fonction : le chef d'entreprise, les cadres, les différents services et ateliers. Cette communauté de travail et son chef seraient alors responsables devant l'Etat.
Nécessité d'une transcendance
Ce dernier point, la responsabilité devant l'Etat, manifeste l'ultime difficulté envisagée par Evola : sans un esprit commun, sans une transcendance politique et spirituelle, la corporation est vouée à l'échec. D'où la nécessaire reconnaissance du « caractère non seulement économique mais aussi éthique de la corporation » (p. 86), de la responsabilité morale du chef d'entreprise devant l'Etat « comme contrepartie de la reconnaissance de sa libre initiative » (p 87), de la lutte nécessaire contre un capitalisme « parasitaire » (le chef d'entreprise devant être le « premier travailleur » de son entreprise par opposition au simple bénéficiaire de dividendes), de la participation des employés aux bénéfices mais aussi aux pertes de l'entreprise.
L'argumentation d'Evola sur la question sociale dans Le Fascisme vu de Droite présente l'intérêt de confronter les principes contre-révolutionnaires en la matière avec l'histoire de l'une des tentatives, partielle et insatisfaisante, mais réelle, de leur mise en œuvre au XXe siècle. L'idée la plus forte que l'on en retiendra est que le projet de restauration d'un ordre vraiment traditionnel et hiérarchique ne peut se mener sur un seul terrain, qu'il soit politique ou social et économique, mais correspondre à un changement complet de direction dans tous les domaines et d'abord au plan spirituel. Tout constructivisme politico-économique qui ne tient pas compte de la dimension anthropologique du problème posé par la Modernité se condamne à l'échec.
Stéphane BLANCHONNET
00:05 Publié dans Histoire, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, traditionalisme, corporation, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 avril 2013
Soral, de Marx à Maurras
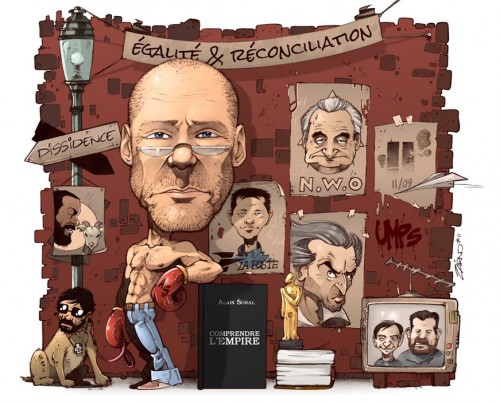
Soral, de Marx à Maurras
par Stéphane Blanchonnet
article d'abord paru sur a-rebours.fr puis repris dans L'AF2000
Ex: http://a-rebours.ouvaton.org/
« J’ai juré de vous émouvoir, d’amitié ou de colère, qu’importe ! » Cette formule de Bernanos, Alain Soral aurait pu la mettre en exergue de chacune de ses œuvres. Aucun de ses essais ne peut en effet laisser indifférent le lecteur de bonne volonté et tous ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à entretenir la grande peur des bien pensants !
La publication récente chez Blanche et Kontre-Kulture, sous le titre de Chroniques d'avant-guerre, d'un recueil de ses articles parus dans le bimensuel Flash entre 2008 et 2011 ne fait pas exception à la règle. On y retrouve avec plaisir son talent de pamphlétaire, son flair de sociologue de terrain, son aisance à manier le concept, à faire bouger les lignes et à prendre le réel dans les mailles d'une dialectique qui n'hésite pas à s'inspirer des traditions intellectuelles les plus diverses.
L'art du boxeur
La forme brève qui est ici imposée par le genre du recueil d'articles n'est pas dépaysante pour le lecteur familier de Soral dont les ouvrages, même les plus construits, comme le roboratif Comprendre l'Empire, paru en 2011, se présentent généralement sous la forme d'une succession de textes brefs qui épuisent en quelque sorte leur sujet à la manière du boxeur enchaînant les directs, les crochets et les uppercuts pour mettre KO son adversaire.
La spécificité de ces Chroniques d'avant-guerre n'est donc pas à proprement parler la forme mais plutôt la composition générale. Là où des ouvrages comme Sociologie du dragueur ou Comprendre l'Empire (qui de l'aveu de l'auteur aurait pu s'intituler Sociologie de la domination) rassemblent les textes courts dont ils sont composés dans une progression logique en sept ou huit parties, les Chroniques d'avant-guerre progressent, elles, au fil de l'actualité des deux années et quelques mois de collaboration d'Alain Soral à Flash. Si l'impression de cohérence est moindre que dans Comprendre l'Empire, on prend un réel plaisir à revivre les événements grands ou petits de cette période. Le fait d'être parfois en désaccord avec l'auteur sur telle analyse de circonstance ou de ne pas épouser tous ses goûts et dégoûts ne nuit en rien à ce plaisir. Alain Soral a d'ailleurs lui-même l'honnêteté de montrer ses propres évolutions sur des sujets comme les printemps arabes ou sur des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Sur ce dernier, nous appelons pour notre part de nos vœux une réconciliation entre les deux talentueux essayistes et polémistes. Sur le fond, et au-delà du cas particulier des Chroniques d'Avant-guerre, le principal intérêt de la lecture d'Alain Soral réside dans sa capacité à produire des axes à la fois politiques et stratégiques toujours cohérents, souvent audacieux, à travers lesquels, il va pouvoir donner une intelligibilité aux événements.
Gauche du travail, droite des valeurs
Le premier de ces axes est bien résumé par le slogan de son association Egalité et Réconciliation : « Gauche du travail, droite des valeurs ». A la manière de Christopher Lasch, de Jean-Claude Michéa, et à la suite de son maître en marxisme Michel Clousclard, Soral dénonce la collusion entre les libéraux et les libertaires, entre la droite et la gauche du capital comme dirait cet autre marxiste original qu'est Francis Cousin ; la gauche sociétale, soixante-huitarde, en fait libérale, ne faisant que s'acharner à détruire les reliquats de la société pré-capitaliste (« mettre une claque à sa grand-mère » selon l'expression de Marx) au nom d'un progressisme qu'elle partage avec la droite libérale, la droite des affaires, la droite du commerce ; la fonction objective de cette gauche étant de briser les moyens de résister au système que sont les solidarités traditionnelles comme la famille, la communauté, la nation. L'acharnement actuel du PS et des Verts à liquider le mariage civil en est une bonne illustration. Face à cette alliance des deux rives du libéralisme, Soral appelle à une unité militante de la gauche réellement sociale et de la droite contre-révolutionnaire. De Marx à Maurras en quelque sorte. Rappelons au passage que ce dernier écrivait qu'« un socialisme libéré de ses éléments démocratiques et cosmopolites peut aller au nationalisme comme un gant bien fait à une belle main. »
Le second axe soralien est une ligne de crête un peu comparable à celle sur laquelle s'était installé Maurras entre 1940 et 1944 quand il critiquait à la fois le camp des « Ya » et le camp des « Yes ». Elle consiste aujourd'hui à dénoncer la politique d'immigration voulue par le patronat et les libéraux de gauche comme de droite, autant d'un point de vue marxiste (l'armée de réserve du capital, la pression à la baisse sur les salaires, la destruction de l'esprit de solidarité et de lutte du prolétariat autochtone) que du point de vue de la défense de l'identité nationale, tout en refusant absolument toute forme d'islamophobie, et même en tendant la main aux musulmans. La thèse de Soral et de son mouvement est la suivante : il y a beaucoup de musulmans en France, une bonne partie d'entre eux a la nationalité française. Il est dans l'intérêt des Français de souche de s'entendre avec la partie la plus saine de cette population. Pour cela, il faut combattre énergiquement tout ce qui peut s'opposer à cette réconciliation : l'islamophobie laïciste de la gauche, l'islamophobie xénophobe de la droite, la poursuite de la politique immigrationniste, principale pourvoyeuse du racisme que ses propres promoteurs prétendent hypocritement combattre, la repentance coloniale permanente, qui entretient la haine entre les communautés et qu'il faudrait remplacer par une valorisation de notre histoire commune, les tentatives de puissances étrangères de financer ou de manipuler la population musulmane de France, le refus par la République de reconnaître la dimension catholique traditionnelle de la civilisation française, préalable pourtant indispensable à une discussion sur la place de l'Islam en France.
Tout pouvoir est une conspiration permanente
Un troisième axe est actuellement développé par Alain Soral qui n'est pas sans rapport avec le précédent. Il s'agit cette fois d'une synthèse entre Marx et l'école traditionaliste de René Guénon et Julius Evola. Sensible aux convergences entre son analyse marxiste de l'économie, en particulier de la crise financière que nous traversons, et les analyses de l'école traditionaliste comme de certains maîtres spirituels musulmans contemporains, Soral semble orienter sa réflexion vers une lecture plus spiritualiste, voire plus eschatologique des événements. Cette veine plus récente dans son œuvre, mais qui est associée à un souci chez lui beaucoup plus ancien de toujours chercher à débusquer les hommes et les intérêts derrière les idées, souci en lui-même très utile du point de vue méthodologique, peut parfois le conduire à s'intéresser à une lecture conspirationniste de l'Histoire, illustrée il est vrai par des personnalités éminentes, mais sur laquelle nous avons pour notre part quelques réserves. Cela dit, comme l'écrivait Balzac : « tout pouvoir est une conspiration permanente. » Il faudrait en effet être bien naïf pour imaginer que le monde fonctionne sur le seul mode du pilotage automatique ! Les analyses développées par Soral mais aussi par Michel Drac ou Aymeric Chauprade sur les stratégies conduites au niveau de l'Etat profond américain par les conseillers du Prince, néo-conservateurs ou autres, qui gravitent dans les sphères dirigeantes de l'Empire, sont d'ailleurs du plus grand intérêt pour comprendre la géopolitique du monde contemporain.
Pour finir, nous ne pouvons qu'encourager nos lecteurs, quelles que soient leurs réticences à l'égard de l'un ou l'autre des axes de la pensée soralienne, que nous avons tenté de résumer brièvement, à se faire une idée par eux-même en lisant ces textes qui présentent une forme toujours attrayante et une réflexion toujours stimulante. Ils y goûteront un climat intellectuel qui n'est pas sans rappeler celui des premiers années de l'Action française.
Stéphane BLANCHONNET
00:05 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain soral, france, marx, maurras, gauche, droite, politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 avril 2013
Vincent Vauclin : "Résister à l'Empire"
Vincent Vauclin :
« Résister à l’Empire »
Ex: http://la-dissidence.org/
Autopsie du corps social
Cette société est perdue.
Le processus est engagé, et la dévastation est telle que nous n’avons plus la capacité de l’inverser.
La seule limite qui se posera, et se pose déjà, est totalement indépendante de notre action : celle des contradictions intrinsèques du système et de son absurdité totale.
Le totalitarisme qui nous fait face est le plus implacable qui soit. De toutes les dictatures, la dictature hédoniste est de loin la plus performante et la plus solide de toutes. Aboutissement logique d’un long processus historique, sociologique et psychologique, la domination moderne s’est imposée comme une idéologie totale, omniprésente, dont chaque individu se fait aujourd’hui le vecteur à son insu, dans son langage, dans son comportement, dans son mode d’appréhension du monde.
Aucune sphère de la société, publique ou privée, n’est épargnée par ce vaste élan de subversion qui ravage les structures et les institutions traditionnelles, impose un rythme effréné, et induit un déracinement à la fois spatial et temporel des hommes, transformés en nomades dans un monde purgé de son sens, amputé de son Histoire, privé de son avenir.
L’aliénation est ainsi totale, et à mesure que les derniers remparts à l’hégémonie moderne s’effondrent, de nouvelles promesses hédonistes émergent, ouvrant comme seules perspectives d’avenir les satisfactions éphémères, organiques, conditionnées et perverses de la consommation et de la sexualité.
Accompagnant ce mouvement, la standardisation des personnalités par les médias de masses systématise les comportements individuels qui s’inscrivent ainsi dans un paradigme global purement matérialiste dont la fonction première est d’isoler l’individu de l’ensemble de ses appartenances, substituant le bien au lien, la possession à la relation.
Un tel totalitarisme neutralise alors l’ensemble de ses oppositions tout en alimentant son essor en s’appuyant sur les archaïsmes psychologiques d’individus qui se trouvent bombardés pluri-quotidiennement d’injonctions publicitaires et normatives qui excitent les plus bas instincts et leur offrent dans le même temps des débouchés pour décharger ces pulsions, que ce soit dans l’acte d’achat ou l’acte sexuel. La mobilisation de ces processus primaires – et parfaitement inoffensifs pour le Système – entraînant par ricochet une dégradation générale de l’intellect dont la source sublimatoire se trouve tarie par le « jouir-sans-entrave » qui s’y manifeste.
Dès lors, c’est un cercle vicieux qui s’enclenche. Standardisés et aliénés, les individus renforcent par leurs comportements et leurs discours une pression sociale qui broie insidieusement le collectif et normalise le processus de décivilisation. C’est là le caractère le plus abjecte de ce totalitarisme : sa domination ne repose ni sur la coercition, ni sur la force. Elle s’appuie sur l’adhésion collective, sur un contrat tacite et inconscient par lequel l’individu renonce à son âme, à ses responsabilités, en échange des quelques satisfactions immédiates à ses désirs, des désirs étant par ailleurs conditionnés par le Système (à travers les phénomènes de mode par exemple).
C’est la mort du corps social, tué de l’intérieur par ceux-là mêmes qui en dépendent.
Au milieu des ruines, les dissidents face à l’Empire
Mais la « perfection » n’est pas de ce monde. Malgré sa terrible efficacité, le Système se trouve dans l’incapacité de combler toutes ses failles et d’absorber l’ensemble de son opposition. Et ce pour une raison très simple : les promesses hédonistes dont il berce les masses ne peuvent satisfaire l’ensemble des individus qui y sont exposés.
Les contradictions et crises récurrentes de ce Système génèrent des frustrations nombreuses qui, si elles participent à la dynamique du Système en temps normal, deviennent ingérables lorsqu’elles dépassent un certain seuil.
La plupart du temps, les individus broyés par le Système, et dont les désirs standardisés entrent en conflits trop violents avec leur réalité matérielle, basculent dans la pathologie mentale : l’augmentation vertigineuse de la consommation d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques en témoigne, de même que celle des suicides et des addictions. Cela dit, d’un point de vue systémique, cette frange de la population reste marginale et ne représente en aucun cas un quelconque danger pour la domination moderne qui, du reste, l’intègre aisément à son processus de domination marchande.
Mais il reste une part de la société sur laquelle la greffe de la modernité ne prend pas, pas totalement en tout cas. Le conditionnement général échoue dans sa tentative hégémonique d’imposer l’uniformisation des comportements, des discours, des attitudes : une frange non-négligeable de la population échappe en effet à cette standardisation, le plus souvent parce qu’elle en désapprouve moralement les fondamentaux, ou parce qu’elle a fait l’expérience malheureuse des conséquences de cette aliénation.
Ces dissidents représentent aujourd’hui la seule véritable résistance à ce Système. Et bien qu’embryonnaire, cette dissidence incarne une faille dans la pensée unique dominante, la lézarde, et contribue à rompre le consensus tacite sur lequel elle s’appuie. Mais le rapport de force étant ce qu’il est, l’analyse objective de la situation doit nous amener à considérer la bataille comme perdue, en tout cas sur le terrain strictement concret et matérialiste.
Notre Grande Guerre est spirituelle
Quelle résistance nous faut-il donc opposer au totalitarisme moderne ?
Il apparaît d’abord tout à fait absurde de se concentrer sur tel ou tel combat secondaire sans jamais oser penser le problème dans sa globalité, ni remonter à sa source.
Ainsi, certains se focalisent sur le combat contre l’Union Européenne par exemple. C’est parfaitement légitime mais, cela dit, ils peuvent être certains que si par miracle ce combat aboutissait, ce serait en pure perte. Tout simplement parce que l’Union Européenne, notamment, n’est que le résultat d’un dysfonctionnement profond de l’ordre social et de la gangrène généralisée qu’est la modernité
En toute logique, une remise en cause de la domination de l’Empire s’avère parfaitement inutile, pour ne pas dire contre-productive, si elle n’est que partielle, puisque se concentrant sur un seul aspect de cette domination.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, qu’ils soient assurés qu’au final leur action aura été nulle. Pour reprendre l’exemple de l’Union Européenne, ils ne feraient que différer temporairement l’influence d’une entité que rien n’empêchera d’émerger de nouveau, sous une forme encore plus abjecte. Tout simplement parce que dans leur combat, ils seront passés à côté de l’essentiel, c’est-à-dire la matrice qui l’a engendrée, et que rien n’empêchera d’enfanter de nouveau.
Il est vrai qu’il est sans doute plus confortable de mener ce type de combat secondaire, sans jamais oser nommer l’ennemi véritable. Il est forcément plus « rentable », moins dangereux, de pointer un seul aspect de la domination moderne que d’affronter en face l’Empire dans sa totalité, dans sa complexité, et notamment dans ses composantes ethno-confessionnelles qu’il faut bien nommer.
En vérité, notre rôle ne peut sérieusement se résumer qu’à maintenir une ligne de front, incarner une résistance totale, et former un « roc » par notre collectif, qui ne cédera rien à l’érosion. Soit transmettre par notre posture, notre ligne et nos actes, les principes fondamentaux de la Civilisation à l’heure où ceux-ci sont purement et simplement balayés par le totalitarisme moderne et hédoniste.
Notre engagement est donc avant tout moral, essentiellement moral. Donc actif, combatif, systématique.
Il est ainsi hors de question d’abandonner le terrain de l’action, mais il est absolument fondamental de concevoir cette action selon ces principes moraux intangibles, qui ne nous compromettent pas avec ce totalitarisme, faute de quoi nous serions nous même « happés » par cette modernité et y perdrions notre essence.
Considérant ces aspects, la dissidence en tant que forme totale d’engagement apparaît être le seul chemin de combat qu’il nous est autorisé d’emprunter.
Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel et culturel, nous devons organiser une riposte globale en cessant purement et simplement de participer aux institutions de l’Empire, en cessant de les cautionner, et en agissant pour l’émergence d’institutions parallèles et légitimes.
La guerre que nous devons mener est avant tout une guerre de légitimité. C’est alors, nécessairement, une guerre spirituelle, qui laisse de côté les contingences politiciennes, et impose à la fois discipline et abnégation.
A l’heure de son trépas, la Civilisation pousse un cri. Un cri dont l’écho résonne en nous et dont il semble que nous soyons les seuls à l’entendre.
Cela nous confère une responsabilité que nous devons assumer, par l’intégrité de notre engagement total et la détermination absolue de ceux qui n’ont rien à perdre, et qui n’attendent plus rien d’un Système dont ils perçoivent la nature fondamentalement malsaine et aliénante.
Et c’est en cela, que nous sommes des dissidents : le totalitarisme moderne n’a pas prise sur nous, tout simplement parce que nous sommes définitivement immunisés de ses illusions.
Vincent Vauclin
Seul compte, aujourd’hui, le travail de ceux qui savent se tenir sur les lignes de crête : fermes sur les principes ; inaccessibles à tout compromis ; indifférents devant les fièvres, les convulsions, les superstitions et les prostitutions sur le rythme desquelles dansent les dernières générations.
Seule compte la résistance silencieuse d’un petit nombre, dont la présence impassible de ‘convives de pierre’ sert à créer de nouveaux rapports, de nouvelles distances, de nouvelles valeurs, à construire un pôle qui, s’il n’empêchera certes pas ce monde d’égarés et d’agités d’être ce qu’il est, permettra cependant de transmettre à certains la sensation de la vérité – sensation qui sera peut-être aussi le déclic de quelque crise libératrice.
Julius Evola – Révolte contre le monde moderne
00:05 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vincent vauclin, système, résistance, théorie politique, sciences politiques, politologie, contestation, révolte, dissidence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 mars 2013
La dictature autodestructrice du Système

La dictature autodestructrice du Système
Ex: http://www.dedefensa.org/
20 mars 2013 – Comme l’on sait, le projet de prélèvement sur les comptes bancaires chypriote a installé une superbe pétaudière, avec bouilloire au bord de la crise de nerf, dans l’usine à gaz générale qu’est le Système. Hier, en fin de journée, le parlement chypriote a rejeté le plan proposé par le gouvernement, ouvrant une nouvelle phase de la crise dont certains jugent qu’elle peut conduire à des événements totalement incontrôlables et insaisissables. Ce 20 mars 2013, un article du Guardian notait : «One [commentator] said it was the opening of Pandora's Box; another saw events in the eastern Mediterranean country as the equivalent of the assassination of archduke Franz Ferdinand in Sarajevo.»
Nous avons effleuré un aspect déconcertant et exotique de cette crise avec quelques observation sur notre chère Sorcha Faal (voir ce 19 mars 2013). Nous allons plus loin dans notre démarche, d’abord en proposant diverses réactions à cette initiative, dont la vertu principale est de montrer, autant que les caractères étranges de la mesure envisagée, le flou et l’incertitude qui règnent quant à identifier précisément qui a décidé quoi, qui a exigé quoi et ainsi de suite... S'il y a bien dictature du Système, le moins qu'on puisse dire est que son efficacité de fonctionnement est pour le moins erratique et confuse, jusqu'à l'inversion de la chose à l'étape présente : le vote du parlement de Chypre a sanctionné une victoire sans conditions de la révolte populaire, à laquelle le Système avait ainsi offert une voie triomphale d'affirmation.
• Le site ZeroHedge.com a largement suivi l’épisode de ce week-end en diffusant plusieurs articles bien documentés, et renvoyant à l’habituelle qualité du site dans ses commentaires. Mark J. Grant résumait la situation au terme du week-end, le 18 mars 2013 : «There was no tax on the bank accounts in Cyprus. There still is no tax; the Cyprus Parliament has not passed it and will not vote on it until tomorrow so whatever action takes place it is retroactive. Next, this was not enacted by Cyprus. The people from Nicosia did not go to the Summit and ask to have the bank accounts in their country minimized to help pay the bills. Far from it; the nations of Europe, Germany, France, the Netherlands and the rest, demanded that this take place, a “fait accompli,” the President of Cyprus said and Europe annexes Cyprus. Let's be quite clear; the European Union has confiscated the private property of the citizens in Cyprus without debate, legislation or Parliamentary agreement.»
Sur le même site, Tyler Durden observe, le 18 mars 2013, citant la Royal Bank of Scotland (RBS), qu’il s’agit du “plus gros coup de poker” jamais joué ; que ce processus a toutes les chances de se répéter dans d’autres pays et que la seule réaction désormais possible est l’insurrection populaire. «[T]his stunning move in Cyprus is likely only the beginning of this process (which seems only stoppable by social unrest now). […] As RBS summarizes, “the deal to effectively haircut Cypriot deposits is an unprecedented move in the Euro crisis and highlights the limits of solidarity and the raw economics that somebody has to pay. It is also the most dangerous gambit that EMU leaders have made to date.”»
• Le 18 mars 2013 également, le site WSWS.org faisait, avec son habituelle précision, un compte-rendu général à la fois des faits et des premières réactions, notamment aux USA et dans les milieux européens. Il faut noter qu’il s’agit là aussi de réactions venues de personnalités et d’organismes qui se trouvent au cœur du Système, tant au niveau financier qu’au niveau politique.
«The response of the financial magazine Forbes was scathing, denouncing the “German-led group of EU officials” for “probably the single most inexplicably irresponsible decision in banking supervision in the advanced world since the 1930s.” Another Forbes columnist entitled his comment, “Welcome to Another Great Depression.” Business Insider noted the “multiple reports which indicated that Germany told Cyprus: Confiscate your depositors’ money or leave the euro zone. That’s a terrible political dynamic, and on top of Italy it exacerbates a bad overall political situation.” […]
»With Italy still lacking a viable government, Monti, in his role as caretaker leader, appealed to EU leaders to soften their austerity course or face the same fate. In a letter to the summit, he declared that the election result showed “public support for the reforms, and worse, for the European Union, is dramatically declining” as part of a “trend which is also visible in many other countries across the Union.” Luxembourg Prime Minister and European Council President Jean-Claude Juncker warned at the start of the summit, “I have big worries about the coming economic developments. I won’t exclude that we run the risk of a social revolution, a social rebellion.”»
• Aujourd’hui, ce 20 mars 2013, Ben Chu, dans The Independent, rapporte quelques précisions sur la confusion extrême qui règne à propos de la détermination des responsabilités de cette décision à l’origine…
«The eurozone was still embroiled in an acrimonious dispute tonight over whose idea it was to impose a tax on the savings of ordinary depositors in Cypriot banks… […] At the weekend, the Cypriot government briefed the media that Wolfgang Schauble, the German Finance Minister, and Christine Lagarde, the head of the International Monetary Fund, had been instrumental in pressuring Nicosia to impose the levy on small depositors as the price of the country’s €10bn bailout. “We didn’t expect such demand from our European partners” said Cypriot President, Nicos Anastasiades. But that interpretation of events was firmly denied by Mr Schauble earlier this week. […] A Reuters report on Monday suggested the idea had come from a desperate President Anastasiades… […] However, an insider account of the Brussels negotiations from the Wall Street Journal muddied the waters further by suggesting that the idea [..] was first put forward by the Economic Affairs Commissioner in Brussels, Olli Rehn.»
• Aditya Chakrabortty, qui est le chef de la rubrique économique du Guardian, livrait son impression générale le 18 mars 2013. Pour l’illustrer de façon décisive il utilise la fameuse formule «C’est pire qu’un crime. C’est une faute», citant ainsi Talleyrand pense-t-il, – mais à cet égard, l’on doit se souvenir que ce jugement lapidaire et fort bien dit sur l’exécution du duc d'Enghien est contesté quant à son auteur : «Le député de la Meurthe Antoine Boulay eut ce mot à propos de ce jugement : “C'est pire qu'un crime. C'est une faute”. Le nom de Boulay étant peu connu du grand public, cette phrase, attestée par des témoignages de l'époque, se retrouvera souvent attribuée à Fouché, et parfois même à Talleyrand.» De même que dans le cas d'origine, ce jugement appliqué à l’affaire chypriote pourrait également être distribué à plusieurs auteurs et, qui plus est, concerner nombre de coupables possibles sans qu'on n'en soit sûr d'aucun, alors que l’unanimité des réactions est remarquable… Dans tous les cas, voici celle de Chakrabortty, commentateur-Système s’il en est, comme le montre le qualificatif de “clown” qu’il applique à Beppe Grillo, sans doute au grand désappointement de Berlusconi.
«What's different this time is the nakedness of the Cyprus heist. The right can jump up and down at a massive infringement of property rights. The left can fulminate at the obvious social unjustness of such a tax, levied even while the banks are shut. However the Brussels elite might thus seek to defend their plan, they have managed to offend all sides – and so blown a huge hole in the credibility of the eurozone. As Talleyrand once scornfully remarked of the latest blunder by Napoleon Bonaparte: “It's worse than a crime; it's a mistake.”
»That will be the lasting lesson from this week: it shows up again just how far the single currency has drifted from all those warm words uttered in the 90s about creating a continental shelter from turbulent globalisation. As we have seen since the sovereign debt crisis began, the euroclub has bullied its poorer members into swallowing poisonous austerity and social regressiveness in order to keep a bust system on the road. In so doing they have created the conditions for such clowns like Beppe Grillo and thugs such as Golden Dawn.
»A friend of mine has a mid-level job at the European Commission. Over the past few years, through Greece and Ireland and Portugal and Spain, he has kept up a resolutely chipper air. This weekend, as details of the Cyprus deal came out, he sent me this email: “Is this what the European financial system has come down to? A direct appropriation of savings because it cannot cure its systemic problems. It is not just the banks that are bankrupt. It is the whole bloody model that has run its course and we are in denial.” If even the true believers in the euro, the ones who have built their careers on it, now express such fundamental scepticism, you have to wonder how long it will last – or in what form.»
• Les Russes, qui sont concernés par cette affaire à cause de dépôts importants d’argent dans les banques chypriotes de divers “oligarques” substantiellement enrichis, réagissent avec vigueur, selon Russia Today le 19 mars 2013. Poutine a qualifié l’affaire de «unfair, unprofessional and dangerous», Medvedev de «forfeiture of other people’s money» selon une décision jugée par lui “étrange et controversée”. L’ancien ministre russe de l’économie Aleksei Koudrine a passé le message suivant sur Twiter : «The EU and its regulators are responsible for the current situation on Cyprus. They have slipped up on it…»
• Plusieurs des responsables (?) les plus importants du Système ont réagi d’une façon assez semblable, en retirant leur responsabilité dans la décision spécifique du président chypriote ensuite repoussée par le Parlement. C’est le cas de l’Allemagne, notamment, pays évidemment perçu comme le premier inspirateur de toute politique activant l'opérationnalité de l'austérité que le Système impose à l’Europe. Le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert a observé : «How the country makes its contribution, how it makes the payments, is up to the Cyprus government. Germany could have imagined a different plan but it is not our decision…» Le ministre des finances allemand est plus rigide et plus discipliné par rapport à sa ligne, et par conséquent moins fuyant que les commentateurs politiques de son gouvernement : il estime que si la décision n’est pas appliquée, «[t]“hen the Cypriot banks will no longer be solvent, and Cyprus will be in a very difficult situation. […] It can't be done any other way if we want to avoid insolvency…»
• Le principal accusé selon l’interprétation générale, celui qui aurait conduit “le raid” contre Chypre en imposant la mesure de prélèvement sur les comptes bancaires, c’est la Troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne et FMI). Pourtant, certains membres de la fine équipe se défendent d’avoir imposé cette mesure spécifique, s’en tenant à l’affirmation de la seule exigence d’un programme de remboursement sur un terme très court, – explication de circonstance qu'on peut supposer plus ou moins faussaire, et surtout contribution notable à la confusion générale... Ainsi, le membre du Conseil d’Administration de la BCE Joerg Asmussen : «[The iniative was] The Cyprus government's adjustment programme, not the Troika's or any other government’s. If Cyprus's president wants to change something in the structure of the levy on bank deposits, that's in his hands. He must simply make sure that the financing is intact…»
• Enfin, pour clore le florilège, encore quelques avis de spécialistes privés du domaine financier, qu’on retrouve à profusion dans les articles de presse : «If European policy makers were looking for a way to undermine the public trust that underpins the foundation of any banking system they could not have done a better job…» (Michael Hewson, analyste des maerchés à CMC Markets) «In the medium term the decision taken regarding the loss on bank deposits could have major ramifications for the eurozone if the European debt crisis re-escalates.[…] What I find most surprising is that they are prepared to take such a major gamble to save such a small amount of money.» (Gary Jenkins, directeur de la gestion à Swordfish Research.)
…Il est évident qu’on relève une exceptionnelle unanimité de commentateurs défavorables. Du côté de la langue de bois, on trouve les diverses potiches gouvernementales ou institutionnelles, qui cherchent à s’en laver les mains, avec les habituelles exceptions teutonnes qui entendent montrer quelle discipline de fer ils sont capables de recommander. Du côté des commentateurs-Système, le déchaînement est général, avec l’accent mis aussi bien sur le caractère arbitraire et interventionniste qui heurte quelques fondements du catéchisme ultra-libéral, que sur l’aspect de l’ébranlement terrible de la pseudo-confiance qu’auraient encore les citoyens-consommateurs et les sacro-saints investisseurs dans la sécurité des organismes de dépôt du Système. (Cas de l’ancien chancelier de l’Echiquier Alistair Darling, qui estime que cette affaire peut engendrer une contagion des retraits des dépôts bancaires [The Telegraph, le 19 mars 2013].)
Quoi qu’il en soit de la véracité de ces critiques, – justes sur le fond mais bien souvent intéressées pour la démarche, – leur véhémence et leur réverbération, y compris dans les rangs de la presse-Système (notamment anglo-saxonne) et dans les structures institutionnelles et satellites du Système, constituent un fait de communication essentiel. Ce tsunami furieux de critiques qui constitue une autocritique du Système a aussitôt entraîné un grand trouble et un flottement évident dans les rangs des organismes les premiers concernés, tant pour les pressions pour l’application du programme, que pour la décision, c’est-à-dire jusqu’à la direction chypriote. Bien entendu, les inquiétudes, l’agitation, les manifestations du public à Chypre même constituent la toile de fond de dramatisation de la pièce avec l’idée de l’épouvantail du désordre social et de l’insurrection populaire (l’idée exprimée par le Luxembourgeois Juncker : «I won’t exclude that we run the risk of a social revolution, a social rebellion»). Hamish McRae (The Independent, le 20 mars 2013) philosophe après la réaction du public chypriote et le vote du Parlement, – ainsi exemplaire de la confusion du commentateur-Système, en saluant comme “encourageant” le succès de la révolte populaire des Chypriotes : «The discouraging lesson is that official bodies are capable of spectacular incompetence. The encouraging one is that ordinary people are learning to cope.»
John Locke, réveille-toi, ils sont devenus fous!
Le cas est extraordinairement net. Il n’y a certainement jamais eu, dans la phase actuelle et peut-être au-delà dans l’histoire des crises financières, une décision et une action au nom du Système, prétendument en faveur du Système, qui ait soulevé avec une telle rapidité et une telle puissance une telle levée de boucliers, y compris et essentiellement au sein du Système. Tout l’arsenal est déployé, y compris les citations des grands anciens, qui, d’ailleurs, s’adaptent superbement à la situation générale. Mark J. Grant, cité plus haut, cite à son tour John Adams et ses formules fondatrices de l’américanisme et du libéralisme qui va avec : «The moment the idea is admitted into society that property is not as sacred as the law of God, and that there is not a force of law and public justice to protect it, anarchy and tyranny commence.» On pourrait citer dix fois, vingt fois John Locke, père spirituel et comptable du libéralisme, dans le même sens.
Il n’y a aucune technicité économiste particulièrement complexe dans cette mesure, ce qui renforce d’une façon exceptionnelle sa perception et sa puissance de communication. Les qualificatifs de banditisme, de “braquage de banques” (bank robbery) conviennent à merveille, sans la moindre exagération et presque comme investis d’une réelle légitimité, d’une vérité extrêmement évidente et dérangeante ; ils parlent donc à tous et disent à tous ce qu’il importe qu’on sache, armant ainsi les esprits et aiguisant les commentaires. Ainsi observe-t-on à cette occasion, puisque tout cela s’exerce contre une action voulue par le Système, ou par ses représentants en l’occurrence dans cette action, qu’il n’est nul besoin d’être antiSystème de nature pour l’être à cette occasion. Cette plasticité “de nature” est d’ailleurs le caractère véridique de l’antiSystème, mais l’occasion est ici confondante par sa netteté, par la vigueur tranchante des positions d’une opposition qui se recrute quasi essentiellement dans les rangs même du Système.
Est-ce une manifestation d’une situation tactique que nous avons déjà rencontrée, que nous avons nommée “discorde chez l’ennemi” ? Nous pensons que cette définition est très largement insuffisante pour la situation créée ce week-end, que cette situation est d’un autre ordre par son exceptionnalité, sa puissance figurative, la rapidité des événements qui la définissent, le symbolisme dont elle est chargée, – et, peut-être, par-dessus tout, par les circonstances. En fonction de tous ces facteurs, nous dirions qu’il s’agit d’un événement stratégique qui ne figure pas une “discorde chez l’ennemi”, mais une totale inversion ; dans ce cas le “chez l’ennemi” ne suffirait pas, et il importerait de dire “inversion au cœur du Système”… Cela impliquerait qu’il y a quelque chose d’explosif, de totalement instable, de complètement irresponsable, – d’absolument autodestructeur enfin, “au cœur du Système”, – l’équation surpuissance-autodestruction à nouveau rencontrée, presque dans une quasi-perfection.
La quasi-unanimité réprobatrice qui salue, au sein du Système, cette décision pris par le Système et pour le Système, est singulière parce qu’elle est exceptionnelle, mais elle est singulière aussi parce qu’elle reflète cette situation tragique d’“inversion au cœur du Système”. La confusion qui entoure les conditions qui menèrent à la décision, avec les principaux acteurs tentant d’éluder leur responsabilité, le plus souvent dans la confusion, aussi bien chez les acteurs nationaux prépondérants (les Allemands) qu’au sein de la Troïka, tout cela est caractéristique. Tout se passe comme si une force générale dont les effets seraient complètement dissimulés aux acteurs-sapiens auraient déclenché cet ouragan, compréhensible dans ses détails et explicable dans ses buts rationnels, incontrôlable et insaisissable dans son opérationnalité impérative et furieuse, dans ses effets immédiatement catastrophiques, dans ses conséquences aujourd’hui d’une incertitude complète avec la possibilité de redémarrage du tourbillon central européen, tout cela déformant ainsi à mesure et grossissant monstrueusement les conditions générales de la chose. L’effet de critique furieuse, de rejet de la responsabilité, etc., finit par ressembler à une sorte de révolte du personnel-sapiens du Système, quasiment privé de la compréhension de l’évolution du phénomène, incapable de comprendre ce qui se passe, révolté effectivement, révulsé, stupéfait qu’une telle initiative venue du Système soit si profondément stupide, contre-productive, comme l’on jette des tonnes et des tonnes d’essence sur un incendie… Pour la première fois apparaît cette situation d’une façon aussi éclatante, urgente, oppressante, et, bien entendu, ils n’y comprennent rien. (Comme les autres et à peu près comme tout le monde en fait, mais l’essentiel pour ce propos est que ce soit eux aussi, eux les serviteurs du Système.) Bien qu’ils en soient les serviteurs, ils n’imaginent pas que puisse exister une entité nommé Système, qui agit d’une façon autonome, qui abrite dans ses flancs l’horrible secret de l’équation surpuissance-autodestruction, – d’où leur confusion, le désordre des idées, des critiques, la rupture complète du consensus-Système, de l’unanimisme de la pensée, de la solidarité et de la coordination de l’action.
Bien évidemment, le système de la communication a joué et joue un rôle amplificateur d’une puissance considérable, comme c’est la coutume, et encore plus puisqu’il s’agit d’une mesure envisagée d’une extrême puissance figurative et symbolique comme on l’a dit. D’une certaine façon, il importe assez peu que cette mesure soit ou non réellement appliquée, qu’elle soit modifiée, adaptées, etc. L’effet de communication a eu lieu et c’est l’essentiel. La possibilité de la chose est entrée dans les psychologies, y compris et surtout dans les psychologies des serviteurs divers du Système. L’effet n’est pas tant de division, voire de déstructuration, d’ailleurs la séquence a parfaitement montré combien les acteurs du Système sont, entre eux, d'ores et déjà déstructurés puisqu’ils se soupçonnent et s’accusent les uns les autres ; ils ne montrent aucune solidarité d’esprit et d’action, confirmant notre appréciation théorique qu’ils agissent par définition hors de tout cadre principiel. L’effet général est celui d’une phase nouvelle de dissolution, avec un plus une réelle méfiance installée “au cœur du Système”, avec cette idée désormais substantivée qu’à tout moment peut être prise, par le Système ou au nom du Système, une décision inepte ou l’autre, et une décision qui serait comme une provocation, une incitation aux pires excès. (Le fameux «risk of a social revolution, [of] a social rebellion» de Juncker, qui les terrorise tous, – eux qui n'ont pas compris qu'entre Beppe Grillo et le vote du parlement chypriote sous la pression et la surveillance de la rue, la “social rebellion” adaptée aux us et coutumes postmodernes est d'ores et déjà en bonne vitesse de croisière.) Tout se passe comme si une sorte de traître était installé au cœur du Système pour lancer des mesures provocatrices et idiotes, et même tout se passe comme si ce traître pouvait être le Système lui-même…
C’est une occurrence à la fois sympathique et significative qu’éclate cette affaire au même moment où l’on envisage des remous graves au sein du bloc BAO, une sorte de “deuxième époque du bloc BAO” (voir le 18 mars 2013) présentant la possibilité du dissolution du bloc par divergences et affrontements internes. Il existe comme une sorte d’enchaînement logique, de mécanique vertueuse, par lesquelles on verrait le terme “autodestruction” de l’équation surpuissance-autodestruction prendre de plus en plus l’avantage sur l’autre dans tous les domaines du Système, dans tous ses actes d’opérationnalité.
00:05 Publié dans Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, critique du système, système, théorie politique, scicens politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 mars 2013
Contre le totalitarisme technicien...
Contre le totalitarisme technicien...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com/
Les éditions Le passager clandestin publient cette semaine un essai de Serge Latouche intitulé Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien. Principal penseur français de la décroissance, Serge Latouche est l'auteur, notamment, du Pari de la décroissance (Fayard, 2006) et de Sortir de la société de consommation (Les liens qui libèrent, 2010). Il a aussi récemment publié aux éditions Les Liens qui Libèrent Bon pour la casse - les déraisons de l'obsolescence programmée.
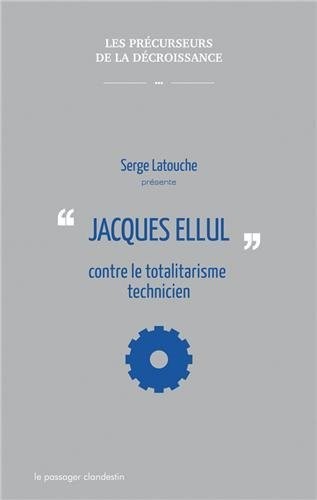
" Jacques Ellul a, dès l’origine, été perçu par le mouvement de la décroissance comme l’un de ses principaux précurseurs. Sa critique de la démesure technicienne et son analyse du « totalitarisme technicien », comptent parmi les pièces maîtresses du projet, en l’alimentant aussi bien sur le plan théorique que sur celui des propositions concrètes.
Jacques Ellul a dénoncé en maints endroits et avec la plus grande fermeté la démesure de la société occidentale, la croissance et le développement. Il a montré que la société économique de croissance ne réaliserait pas l’objectif de bonheur proclamé de la modernité, et que les évolutions de la technique étaient incompatibles avec les rythmes de l’homme et l’avenir du monde naturel.
Cette relecture par Serge Latouche de la pensée de Jacques Ellul, rappelle aussi que la virulence de la critique sociale du maître bordelais s’accompagnait toutefois d’une conception minimale de l’action politique, définie comme dissidence individuelle. Lire Ellul à l’ère de l’anthropocène, c’est aussi rappeler, avec les objecteurs de croissance, que les temps sont désormais aux métamorphoses radicales."
00:05 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, livre, jacques ellul, théorie politique, technocratie, technocratisme, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 mars 2013
Othmar Spann: A Catholic Radical Traditionalist
Othmar Spann:
A Catholic Radical Traditionalist
By Lucian Tudor
Ex: http://www.counter-currents.com/
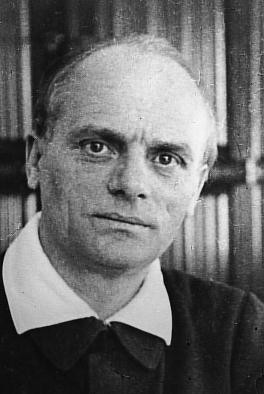 Othmar Spann was an Austrian philosopher who was a key influence on German conservative and traditionalist thought in the period after World War I, and he is thus considered a representative of the intellectual movement known as the “Conservative Revolution.” Spann was a professor of economics and sociology at the University of Vienna, where he taught not only scientific social and economic theories, but also influenced many students with the presentation of his worldview in his lectures. As a result of this he formed a large group of followers known as the Spannkreis (“Spann Circle”). This circle of intellectuals attempted to influence politicians who would be sympathetic to “Spannian” philosophy in order to actualize its goals.[1]
Othmar Spann was an Austrian philosopher who was a key influence on German conservative and traditionalist thought in the period after World War I, and he is thus considered a representative of the intellectual movement known as the “Conservative Revolution.” Spann was a professor of economics and sociology at the University of Vienna, where he taught not only scientific social and economic theories, but also influenced many students with the presentation of his worldview in his lectures. As a result of this he formed a large group of followers known as the Spannkreis (“Spann Circle”). This circle of intellectuals attempted to influence politicians who would be sympathetic to “Spannian” philosophy in order to actualize its goals.[1]
Othmar Spann himself was influenced by a variety of philosophers across history, including Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, J. G. Fichte, Franz von Baader, and most notably the German Romantic thought of Adam Müller. Spann called his own worldview “Universalism,” a term which should not be confused with “universalism” in the vernacular sense; for the former is nationalistic and values particularity while the latter refers to cosmopolitan or non-particularist (even anti-particularist) ideas. Spann’s term is derived from the root word “universality,” which is in this case synonymous with related terms such as collectivity, totality, or whole.[2] Spann’s Universalism was expounded in a number of books, most notably in Der wahre Staat (“The True State”), and essentially taught the value of nationality, of the social whole over the individual, of religious (specifically Catholic) values over materialistic values, and advocated the model of a non-democratic, hierarchical, and corporatist state as the only truly valid political constitution.
Social Theory
Othmar Spann declared: “It is the fundamental truth of all social science . . . that not individuals are the truly real, but the whole, and that the individuals have reality and existence only so far as they are members of the whole.”[3] This concept, which is at the core of Spann’s sociology, is not a denial of the existence of the individual person, but a complete denial of individualism; individualism being that ideology which denies the existence and importance of supra-individual realities. Classical liberal theory, which was individualist, held an “atomistic” view of individuals and regarded only individuals as truly real; individuals which it believed were essentially disconnected and independent from each other. It also held that society only exists as an instrumental association as a result of a “social contract.” On the other hand, sociological studies have disproven this theory, showing that the whole (society) is never merely the sum of its parts (individuals) and that individuals naturally have psychological bonds with each other. This was Othmar Spann’s position, but he had his own unique way of formulating it.[4]
While the theory of individualism appears, superficially, to be correct to many people, an investigation into the matter shows that it is entirely fallacious. Individuals never act entirely independently because their behavior is always at least in part determined by the society in which they live, and by their organic, non-instrumental (and thus also non-contractual) bonds with other people in their society. Spann wrote, “according to this view, the individual is no longer self-determined and self-created, and is no longer based exclusively and entirely on its own egoicity.”[5] Spann conceived of the social order, of the whole, as an organic society (a community) in which all individuals belonging to it have a pre-existing spiritual unity. The individual person emerges as such from the social whole to which he was born and from which he is never really separated, and “thus the individual is that which is derivative.”[6]
Therefore, society is not merely a mechanical aggregate of fundamentally disparate individuals, but a whole, a community, which precedes its parts, the individuals. “Universalists contend that the mental or spiritual associative tie between individuals exists as an independent entity . . .”[7] However, Spann clarified that this does not mean that the individual has “no mental self-sufficiency,” but rather that he actualizes his personal being only as a member of the whole: “he is only able to form himself, is only able to build up his personality, when in close touch with others like unto himself; he can only sustain himself as a being endowed with mentality or spirituality, when he enjoys intimate and multiform communion with other beings similarly endowed.”[8] Therefore,
All spiritual reality present in the individual is only there and only comes into being as something that has been awakened . . . the spirituality that comes into being in an individual (whether directly or mediated) is always in some sense a reverberation of that which another spirit has called out to the individual. This means that human spirituality exists only in community, never in spiritual isolation. . . . We can say that individual spirituality only exists in community or better, in ‘spiritual community’ [Gezweiung]. All spiritual essence and reality exists as ‘spiritual community’ and only in ‘communal spirituality’ [Gezweitheit].[9]
It is also important to clarify that Spann’s concept of society did not conceive of society as having no other spiritual bodies within it that were separate from each other. On the contrary, he recognized the importance of the various sub-groups, referred to by him as “partial wholes,” as constituent parts and elements which are different yet related, and which are harmonized by the whole under which they exist. Therefore, the whole or the totality can be understood as the unity of individuals and “partial wholes.” To reference a symbolic image, “Totality [the Whole] is analogous to white light before it is refracted by a prism into many colors,” in which the white light is the supra-temporal totality, while the prism is cosmic time which “refracts the totality into the differentiated and individuated temporal reality.”[10]
Nationality and Racial Style
Volk (“people” or “nation”), which signifies “nationality” in the cultural and ethnic sense, is an entirely different entity and subject matter from society or the whole, but for Spann the two had an important connection. Spann was a nationalist and, defining Volk in terms of belonging to a “spiritual community” with a shared culture, believed that a social whole is under normal conditions only made up of a single ethnic type. Only when people shared the same cultural background could the deep bonds which were present in earlier societies truly exist. He thus upheld the “concept of the concrete cultural community, the idea of the nation – as contrasted with the idea of unrestricted, cosmopolitan, intercourse between individuals.”[11]
Spann advocated the separation of ethnic groups under different states and was also a supporter of pan-Germanism because he believed that the German people should unite under a single Reich. Because he also believed that the German nation was intellectually superior to all other nations (a notion which can be considered as the unfortunate result of a personal bias), Spann also believed that Germans had a duty to lead Europe out of the crisis of liberal modernity and to a healthier order similar to that which had existed in the Middle Ages.[12]
Concerning the issue of race, Spann attempted to formulate a view of race which was in accordance with the Christian conception of the human being, which took into account not only his biology but also his psychological and spiritual being. This is why Spann rejected the common conception of race as a biological entity, for he did not believe that racial types were derived from biological inheritance, just as he did not believe an individual person’s character was set into place by heredity. Rather what race truly was for Spann was a cultural and spiritual character or type, so a person’s “racial purity” is determined not by biological purity but by how much his character and style of behavior conforms to a specific spiritual quality. In his comparison of the race theories of Spann and Ludwig Ferdinand Clauss (an influential race psychologist), Eric Voegelin had concluded:
In Spann’s race theory and in the studies of Clauss we find race as the idea of a total being: for these two scholars racial purity or blood purity is not a property of the genetic material in the biological sense, but rather the stylistic purity of the human form in all its parts, the possession of a mental stamp recognizably the same in its physical and psychological expression.[13]
However, it should be noted that while Ludwig Clauss (like Spann) did not believe that spiritual character was merely a product of genetics, he did in fact emphasize that physical race had importance because the bodily racial form must be essentially in accord with the psychical racial form with which it is associated, and with which it is always linked. As Clauss wrote,
The style of the psyche expresses itself in its arena, the animate body. But in order for this to be possible, this arena itself must be governed by a style, which in turn must stand in a structured relationship to the style of the psyche: all the features of the somatic structure are, as it were, pathways for the expression of the psyche. The racially constituted (that is, stylistically determined) psyche thus acquires a racially constituted animate body in order to express the racially constituted style of its experience in a consummate and pure manner. The psyche’s expressive style is inhibited if the style of its body does not conform perfectly with it.[14]
Likewise Julius Evola, whose thought was influenced by both Spann and Clauss, and who expanded Clauss’s race psychology to include religious matters, also affirmed that the body had a certain level of importance.[15]
On the other hand, the negative aspect of Othmar Spann’s theory of race is that it ends up dismissing the role of physical racial type entirely, and indeed many of Spann’s major works do not even mention the issue of race. A consequence of this was also the fact that Spann tolerated and even approved of critiques made by his students of National Socialist theories of race which emphasized the role of biology; an issue which would later compromise his relationship with that movement even though he was one of its supporters.[16]
The True State
Othmar Spann’s Universalism was in essence a Catholic form of “Radical Traditionalism”; he believed that there existed eternal principles upon which every social, economic, and political order should be constructed. Whereas the principles of the French Revolution – of liberalism, democracy, and socialism – were contingent upon historical circumstances, bound by world history, there are certain principles upon which most ancient and medieval states were founded which are eternally valid, derived from the Divine order. While specific past state forms which were based on these principles cannot be revived exactly as they were because they held many characteristics which are outdated and historical, the principles upon which they were built and therefore the general model which they provide are timeless and must reinstituted in the modern world, for the systems derived from the French Revolution are invalid and harmful.[17] This timeless model was the Wahre Staat or “True State” – a corporative, monarchical, and elitist state – which was central to Universalist philosophy.
1. Economics
In terms of economics, Spann, like Adam Müller, rejected both capitalism and socialism, advocating a corporatist system relatable to that of the guild system and the landed estates of the Middle Ages; a system in which fields of work and production would be organized into corporations and would be subordinated in service to the state and to the nation, and economic activity would therefore be directed by administrators rather than left solely to itself. The value of each good or commodity produced in this system was determined not by the amount of labor put into it (the labor theory of value of Marx and Smith), but by its “organic use” or “social utility,” which means its usefulness to the social whole and to the state.[18]
Spann’s major reason for rejecting capitalism was because it was individualistic, and thus had a tendency to create disharmony and weaken the spiritual bonds between individuals in the social whole. Although Spann did not believe in eliminating competition from economic life, he pointed out that the extreme competition glorified by capitalists created a market system in which there occurred a “battle of all against all” and in which undertakings were not done in service to the whole and the state but in service to self-centered interests. Universalist economics aimed to create harmony in society and economics, and therefore valued “the vitalising energy of the personal interdependence of all the members of the community . . .”[19]
Furthermore, Spann recognized that capitalism also did result in an unfair treatment by capitalists of those underneath them. Thus while he believed Marx’s theories to be theoretically flawed, Spann also mentioned that “Marx nevertheless did good service by drawing attention to the inequality of the treatment meted out to worker and to entrepreneur respectively in the individualist order of society.”[20] Spann, however, rejected socialist systems in general because while socialism seemed superficially Universalistic, it was in fact a mixture of Universalist and individualist elements. It did not recognize the primacy of the State over individuals and also held that all individuals in society should hold the same position, eliminating all class distinctions, and should receive the same amount of goods. “True universalism looks for an organic multiplicity, for inequality,” and thus recognizes differences even if it works to establish harmony between the parts.[21]
2. Politics
Spann asserted that all democratic political systems were an inversion of the truly valuable political order, which was of even greater importance than the economic system. A major problem of democracy was that it allowed, firstly, the manipulation of the government by wealthy capitalists and financiers whose moral character was usually questionable and whose goals were almost never in accord with the good of the community; and secondly, democracy allowed the triumph of self-interested demagogues who could manipulate the masses. However, even the theoretical base of democracy was flawed, according to Spann, because human beings were essentially unequal, for individuals are always in reality differentiated in their qualities and thus are suited for different positions in the social order. Democracy thus, by allowing a mass of people to decide governmental matters, meant excluding the right of superior individuals to determine the destiny of the State, for “setting the majority in the saddle means that the lower rule over the higher.”[22]
Finally, Spann noted that “demands for democracy and liberty are, once more, wholly individualistic.”[23] In the Universalist True State, the individual would subordinate his will to the whole and would be guided by a sense of selfless duty in service to the State, as opposed to asserting his individual will against all other wills. Furthermore, the individual did not possess rights because of his “rational” character and simply because of being human, as many Enlightenment thinkers asserted, but these rights were derived from the ethics of the particular social whole to which he belonged and from the laws of the State.[24] Universalism also acknowledged the inherent inequalities in human beings and supported a hierarchical organization of the political order, where there would be only “equality among equals” and the “subordination of the intellectually inferior under their intellectual betters.”[25]
In the True State, individuals who demonstrated their leadership skills, their superior nature, and the right ethical character would rise among the levels of the hierarchy. The state would be led by a powerful elite whose members would be selected from the upper levels of the hierarchy based on their merit; it was essentially a meritocratic aristocracy. Those in inferior positions would be taught to accept their role in society and respect their superiors, although all parts of the system are “nevertheless indispensable for its survival and development.”[26] Therefore, “the source of the governing power is not the sovereignty of the people, but the sovereignty of the content.”[27]
Othmar Spann, in accordance with his Catholic religious background, believed in the existence of a supra-sensual, metaphysical, and spiritual reality which existed separately from and above the material reality, and of which the material realm was its imperfect reflection. He asserted that the True State must be animated by Christian spirituality, and that its leaders must be guided by their devotion to Divine laws; the True State was thus essentially theocratic. However, the leadership of the state would receive its legitimacy not only from its religious character, but also by possessing “valid spiritual content,” which “precedes power as it is represented in law and the state.”[28] Thus Spann concluded that “history teaches us that it is the validity of spiritual values that constitutes the spiritual bond. They cannot be replaced by fire and sword, nor by any other form of force. All governance that endures, and all the order that society has thus achieved, is the result of inner domination.”[29]
The state which Spann aimed to restore was also federalistic in nature, uniting all “partial wholes” – corporate bodies and local regions which would have a certain level of local self-governance – with respect to the higher Authority. As Julius Evola wrote, in a description that is in accord with Spann’s views, “the true state exists as an organic whole comprised of distinct elements, and, embracing partial unities [wholes], each possesses a hierarchically ordered life of its own.”[30] All throughout world history the hierarchical, corporative True State appears and reappears; in the ancient states of Sparta, Rome, Persia, Medieval Europe, and so on. The structures of the states of these times “had given the members of these societies a profound feeling of security. These great civilizations had been characterized by their harmony and stability.”[31]
Liberal modernity had created a crisis in which the harmony of older societies was damaged by capitalism and in which social bonds were weakened (even if not eliminated) by individualism. However, Spann asserted that all forms of liberalism and individualism are a sickness which could never succeed in fully eliminating the original, primal reality. He predicted that in the era after World War I, the German people would reassert its rights and would create revolution restoring the True State, would recreate that “community tying man to the eternal and absolute forces present in the universe,”[32] and whose revolution would subsequently resonate all across Europe, resurrecting in modern political life the immortal principles of Universalism.
Spann’s Influence and Reception
Othmar Spann and his circle held influence largely in Germany and Austria, and it was in the latter country that their influence was the greatest. Spann’s philosophy became the basis of the ideology of the Austrian Heimwehr (“Home Guard”) which was led by Ernst Rüdiger von Starhemberg. Leaders of the so-called “Austro-fascist state,” including Engelbert Dollfuss and Kurt Schuschnigg, were also partially influenced by Spann’s thought and by members of the “Spann circle.”[33] However, despite the fact that this state was the only one which truly attempted to actualize his ideas, Spann did not support “Austro-fascism” because he was a pan-Germanist and wanted the German people unified under a single state, which is why he joined Hitler’s National Socialist movement, which he believed would pave the way to the True State.
Despite repeated attempts to influence National Socialist ideology and the leaders of the NSDAP, Spann and his circle were rejected by most National Socialists. Alfred Rosenberg, Robert Ley, and various other authors associated with the SS made a number of attacks on Spann’s school. Rosenberg was annoyed both by Spann’s denial of the importance of blood and by his Catholic theocratic position; he wrote that “the Universalist school of Othmar Spann has successfully refuted idiotic materialist individualism . . . [but] Spann asserted against traditional Greek wisdom, and claimed that god is the measure of all things and that true religion is found only in the Catholic Church.”[34]
Aside from insisting on the reality of biological laws, other National Socialists also criticized Spann’s political proposals. They asserted that his hierarchical state would create a destructive divide between the people and their elite because it insisted on their absolute separateness; it would destroy the unity they had established between the leadership and the common folk. Although National Socialism itself had elements of elitism it was also populist, and thus they further argued that every German had the potential to take on a leadership role, and that therefore, if improved within in the Volksgemeinschaft (“Folk-Community”), the German people were thus not necessarily divisible in the strict view of superior elites and inferior masses.[35]
As was to be expected, Spann’s liberal critics complained that his anti-individualist position was supposedly too extreme, and the social democrats and Marxists argued that his corporatist state would take away the rights of the workers and grant rulership to the bourgeois leaders. Both accused Spann of being an unrealistic reactionary who wanted to revive the Middle Ages.[36] However, here we should note here that Edgar Julius Jung, who was himself basically a type of Universalist and was heavily inspired by Spann’s work, had mentioned that:
We are reproached for proceeding alongside or behind active political forces, for being romantics who fail to see reality and who indulge in dreams of an ideology of the Reich that turns toward the past. But form and formlessness represent eternal social principles, like the struggle between the microcosm and the macrocosm endures in the eternal swing of the pendulum. The phenomenal forms that mature in time are always new, but the great principles of order (mechanical or organic) always remain the same. Therefore if we look to the Middle Ages for guidance, finding there the great form, we are not only not mistaking the present time but apprehending it more concretely as an age that is itself incapable of seeing behind the scenes.[37]
Edgar Jung, who was one of Hitler’s most prominent radical Conservative opponents, expounded a philosophy which was remarkably similar to Spann’s, although there are some differences we would like to point out. Jung believed that neither Fascism nor National Socialism were precursors to the reestablishment of the True State but rather “simply another manifestation of the liberal, individualistic, and secular tradition that had emerged from the French Revolution.”[38] Fascism and National Socialism were not guided by a reference to a Divine power and were still infected with individualism, which he believed showed itself in the fact that their leaders were guided by their own ambitions and not a duty to God or a power higher than themselves.
Edgar Jung also rejected nationalism in the strict sense, although he simultaneously upheld the value of Volk and the love of fatherland, and advocated the reorganization of the European continent on a federalist basis with Germany being the leading nation of the federation. Also in contrast to Spann’s views, Jung believed that genetic inheritance did play a role in the character of human beings, although he believed this role was secondary to cultural and spiritual factors and criticized common scientific racialism for its “biological materialism.”
Jung asserted that what he saw as superior racial elements in a population should be strengthened and the inferior elements decreased: “Measures for the raising of racially valuable components of the German people and for the prevention of inferior currents must however be found today rather than tomorrow.”[39] Jung also believed that the elites of the Reich, while they should be open to accepting members of lower levels of the hierarchy who showed leadership qualities, should marry only within the elite class, for in this way a new nobility possessing leadership qualities strengthened both genetically and spiritually would be developed.[40]
Whereas Jung constantly combatted National Socialism to his life’s end, up until the Anschluss Othmar Spann had remained an enthusiastic supporter of National Socialism, always believing he could eventually influence the Third Reich leadership to adopt his philosophy. This illusion was maintained in his mind until the takeover of Austria by Germany in 1938, soon after which Spann was arrested and imprisoned because he was deemed an ideological threat, and although he was released after a few months, he was forcibly confined to his rural home.[41] After World War II he could never regain any political influence, but he left his mark in the philosophical realm. Spann had a partial influence on Eric Voegelin and also on many Neue Rechte (“New Right”) intellectuals such as Armin Mohler and Gerd-Klaus Kaltenbrunner.[42] He has also had an influence on Radical Traditionalist thought, most notably on Julius Evola, who wrote that Spann “followed a similar line to my own,”[43] although there are obviously certain marked differences between the two thinkers. Spann’s philosophy thus, despite its flaws and limitations, has not been entirely lacking in usefulness and interest.
Notes
1. More detailed information on Othmar Spann’s life than provided in this essay can be found in John J. Haag, Othmar Spann and the Politics of “Totality”: Corporatism in Theory and Practice (Ph.D. Thesis, Rice University, 1969).
2. See Othmar Spann, Types of Economic Theory (London: George Allen and Unwin, 1930), p. 61. We should note to the reader that this book is the only major work by Spann to have been published in English and has also been published under an alternative title as History of Economics.
3. Othmar Spann as quoted in Ernest Mort, “Christian Corporatism,” Modern Age, Vol. 3, No. 3 (Summer 1959), p. 249. Available online here: http://www.mmisi.org/ma/03_03/mort.pdf [2].
4. For a more in-depth and scientific overview of Spann’s studies of society, see Barth Landheer, “Othmar Spann’s Social Theories.” Journal of Political Economy, Vol. 39, No. 2 (April, 1931), pp. 239–48. We should also note to our readers that Othmar Spann’s anti-individualist social theories are more similar to those of other “far Right” sociologists such as Hans Freyer and Werner Sombart. However, it should be remembered that sociologists from nearly all political positions are opposed to individualism to some extent, whether they are of the “moderate Center” or of the “far Left.” Furthermore, anti-individualism is a typical position among many mainstream sociologists today, who recognize that individualistic attitudes – which are, of course, still an issue in societies today just as they were an issue a hundred years ago – have a harmful effect on society as a whole.
5. Othmar Spann, Der wahre Staat (Leipzig: Verlag von Quelle und Meyer, 1921), p. 29. Quoted in Eric Voegelin, Theory of Governance and Other Miscellaneous Papers, 1921–1938 (Columbia: University of Missouri Press, 2003), p. 68.
6. Spann, Der wahre Staat, p. 29. Quoted in Voegelin, Theory of Governance, p. 69.
7. Spann, Types of Economic Theory, pp. 60–61.
8. Ibid., p. 61.
9. Spann, Der wahre Staat, pp. 29 & 34. Quoted in Voegelin, Theory of Governance, pp. 70–71.
10. J. Glenn Friesen, “Dooyeweerd, Spann, and the Philosophy of Totality,” Philosophia Reformata, 70 (2005), p. 6. Available online here: http://members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Totality.pdf [3].
11. Spann, Types of Economic Theory, p. 199.
12. See Haag, Spann and the Politics of “Totality,” p. 48.
13. Eric Voegelin, Race and State (Columbia: University of Missouri Press, 1997), pp. 117–18.
14. Ludwig F. Clauss, Rasse und Seele (Munich: J. F. Lehmann, 1926), pp. 20–21. Quoted in Richard T. Gray, About Face: German Physiognomic Thought from Lavater to Auschwitz (Detroit: Wayne State University Press, 2004), p. 307.
15. For an overview of Evola’s theory of race, see Michael Bell, “Julius Evola’s Concept of Race: A Racism of Three Degrees.” The Occidental Quarterly, Vol. 9, No. 4 (Winter 2009–2010), pp. 101–12. Available online here: http://toqonline.com/archives/v9n2/TOQv9n2Bell.pdf [4]. For a closer comparison between the Evola’s theories and Clauss’s, see Julius Evola’s The Elements of Racial Education (Thompkins & Cariou, 2005).
16. See Haag, Spann and the Politics of “Totality,” p. 136.
17. A more in-depth explanation of “Radical Traditionalism” can be found in Chapter 1: Revolution – Counterrevolution – Tradition” in Julius Evola, Men Among the Ruins: Postwar Reflections of a Radical Traditionalist, trans. Guido Stucco, ed. Michael Moynihan (Rochester: Inner Traditions, 2002).
18. See Spann, Types of Economic Theory, pp. 162–64.
19. Ibid., p. 162.
20. Ibid., p. 226.
21. Ibid., p. 230.
22. Spann, Der wahre Staat, p. 111. Quoted in Janek Wasserman, Black Vienna, Red Vienna: The Struggle for Intellectual and Political Hegemony in Interwar Vienna, 1918–1938 (Ph.D. Dissertion, Washington University, 2010), p. 80.
23. Spann, Types of Economic Theory, pp. 212.
24. For a commentary on individual natural rights theory, see Ibid., pp.53 ff.
25. Spann, Der wahre Staat, p. 185. Quoted in Wassermann, Black Vienna, Red Vienna, p. 82.
26. Haag, Spann and the Politics of “Totality,” p. 32.
27. Othmar Spann, Kurzgefasstes System der Gesellschaftslehre (Berlin: Quelle und Meyer, 1914), p. 429. Quoted in Voegelin, Theory of Governance, p. 301.
28. Spann, Gesellschaftslehre, p. 241. Quoted in Voegelin, Theory of Governance, p. 297.
29. Spann, Gesellschaftslehre, p. 495. Quoted in Voegelin, Theory of Governance, p. 299.
30. Julius Evola, The Path of Cinnabar (London: Integral Tradition Publishing, 2009), p. 190.
31. Haag, Spann and the Politics of “Totality,” p. 39.
32. Ibid., pp. 40–41.
33. See Günter Bischof, Anton Pelinka, Alexander Lassner, The Dollfuss/Schuschnigg Era in Austria: A Reassessment (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2003), pp. 16, 32, & 125 ff.
34. Alfred Rosenberg, The Myth of the Twentieth Century (Sussex, England: Historical Review Press, 2004), pp. 458–59.
35. See Haag, Spann and the Politics of “Totality,” pp. 127–29.
36. See Ibid., pp. 66 ff.
37. Edgar Julius Jung, “Germany and the Conservative Revolution,” in: The Weimar Republic Sourcebook, edited by Anton Kaes, Martin Jay, and Edward Dimendberg (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995), p. 354.
38. Larry Eugene Jones, “Edgar Julius Jung: The Conservative Revolution in Theory and Practice,” Conference Group for Central European History of the American Historical Association, Vol. 21, No. 02 (1988), p. 163.
39. Edgar Julius Jung, “People, Race, Reich,” in: Europa: German Conservative Foreign Policy 1870–1940, edited by Alexander Jacob (Lanham, MD, USA: University Press of America, 2002), p. 101.
40. For a more in-depth overview of Jung’s life and thought, see Walter Struve, Elites Against Democracy: Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany, 1890–1933 (Princeton, N.J.: Princeton University, 1973), pp. 317 ff. See also Edgar Julius Jung, The Rule of the Inferiour, 2 vols. (Lewiston, New York: Edwin Mellon Press, 1995).
41. Haag, Spann and the Politics of “Totality,” pp. 154–55.
42. See our previous citations of Voegelin’s Theory of Governance and Race and State; Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932 (Stuttgart: Friedrich Vorwerk Verlag, 1950); “Othmar Spann” in Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Vom Geist Europas, Vol. 1 (Asendorf: Muth-Verlag, 1987).
43. Evola, Path of Cinnabar, p. 155.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/03/othmar-spann-a-catholic-radical-traditionalist/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/03/spann.jpg
[2] http://www.mmisi.org/ma/03_03/mort.pdf: http://www.mmisi.org/ma/03_03/mort.pdf
[3] http://members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Totality.pdf: http://members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Totality.pdf
[4] http://toqonline.com/archives/v9n2/TOQv9n2Bell.pdf: http://toqonline.com/archives/v9n2/TOQv9n2Bell.pdf
00:14 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : othmar spann, révolution conservatrice, philosophie, catholicisme, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 mars 2013
Rayer des pays de la carte

« Rayer des pays de la carte » : Qui déroute les «États en déroute»?
Washington « œuvre à la destruction » d’une très longue liste de pays
Une dangereuse rumeur s’est propagée à travers le monde et elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La légende veut que le président iranien ait menacé de détruire Israël ou, pour citer les propos déformés, dit « Israël doit être rayé de la carte ». Contrairement à la croyance populaire, il n’a jamais fait cette déclaration […] (Arash Norouzi, Wiped off The Map: The Rumor of the Century, janvier 2007.)
Les États-Unis ont attaqué directement ou indirectement environ 44 pays à travers le monde depuis août 1945, certains d’entre eux à plusieurs reprises. Le but affiché de ces interventions militaires était d’effectuer un « changement de régime ». Pour justifier et dissimuler ce qui correspondait à des actions unilatérales et illégales, on a invariablement évoqué les « droits humains » et la « démocratie ». (Professeur Eric Waddell, The United States’ Global Military Crusade (1945- ), Global Research, février 2007)
« Voici un memo du Pentagone qui décrit comment nous allons anéantir sept pays en cinq ans en commençant par l’Irak, ensuite la Syrie, le Liban, la Somalie, le Soudan et pour terminer, l’Iran ». J’ai dit « Est-il classifié? » Il a dit « Oui monsieur. » J’ai répondu : « Alors ne me le montrez pas. » (General Wesley Clark, Democracy Now, 2 mars 2007.)
Washington « œuvre à la destruction » d’une très longue liste de pays.
Qui « raye des pays de la carte? » L’Iran ou les États-Unis?
Durant une période appelée euphémiquement l’« après-guerre » – de 1945 à aujourd’hui – les États-Unis ont directement ou indirectement attaqué plus de 40 pays.
Alors que les principes de la politique étrangère des États-Unis prétendent « propager la démocratie », l’interventionnisme étasunien, par des moyens militaires et des opérations clandestines, a donné lieu à la déstabilisation totale et la partition de pays souverains.
Détruire des pays fait partie d’un projet impérial des États-Unis, un processus de domination mondiale. De plus, selon des sources officielles, les États-Unis ont en tout 737 bases militaires à l’étranger (données de 2005).

Le concept d’« État en déroute »
Dans son rapport « Global Trends » (Tendances mondiales, décembre 2012), le National Intelligence Council (NIC), situé à Washington, « prédit » que 15 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient deviendront des « États en déroute » d’ici 2030 en raison de leurs « conflits potentiels et leurs ennuis environnementaux ».
La liste des pays dans le rapport de 2012 du NIC comprend l’Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Kenya, le Burundi, l’Éthiopie, le Rwanda, la Somalie, la République démocratique du Congo, le Malawi, Haïti et le Yémen. (voir p 39)
Dans le rapport de 2005, publié au début du second terme de Bush, le NIC avait prévu que le Pakistan deviendrait un « État en déroute » d’ici 2015 « car il sera affecté par la guerre civile, la talibanisation totale et la lutte pour le contrôle de ses armes nucléaires ».
Le Pakistan a été comparé à la Yougoslavie, découpée en sept États par procuration après une décennie de « guerres civiles » parrainées par les États-Unis et l’OTAN.
Le NIC prévoyait pour le Pakistan « un destin à la yougoslave […], un pays déchiré par la guerre civile, des bains de sang et des rivalités interprovinciales ». (Energy Compass, 2 mars 2005.)
Bien qu’il affirme que les États en déroute « servent de refuge aux extrémistes politiques et religieux » (p. 143), le rapport ne reconnaît pas que depuis les années 1970, les États-Unis et leurs alliés ont secrètement soutenu des organisations religieuses extrémistes afin de déstabiliser des États-nations laïques et souverains. Et le Pakistan et l’Afghanistan étaient des États laïcs dans les années 1970.
Un « statut d’État en déroute » à la yougoslave ou à la somalienne n’est pas le résultat de divisions sociales internes, mais un objectif stratégique mis en œuvre par des opérations clandestines et des actions militaires.
Fund for Peace, dont le siège est à Washington et le mandat consiste à promouvoir « une sécurité durable par la recherche », publie (annuellement) un « Index des États en déroute » basé sur une évaluation des risques (voir la carte ci-dessous). Trente-trois pays (compris dans les catégories Alerte [rouge] et Avertissement [orange]) sont identifiés comme étant des « États en déroute ».
Selon Fund for Peace, les États en déroute sont également des « cibles pour les terroristes liés à Al-Qaïda ».
Le classement annuel des pays par Fund for Peace et Foreign Policy indiquant les symptômes des États en déroute/fragiles est publié au moment où le monde s’inquiète de plus en plus du sanctuaire étatique au nord du Mali où s’établissent des extrémistes liés à Al-Qaïda pour l’expansion du djihad.
Inutile de dire que l’histoire d’Al-Qaïda comme élément du renseignement étasunien, son rôle dans la division des factions et l’instabilité au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique subsaharienne n’est pas mentionnée. Les activités des unités djihadistes d’Al-Qaïda dans la plupart de ces pays relèvent d’un programme clandestin diabolique du renseignement.

Les États « faibles » et « en déroute » : une menace pour les États-Unis
Selon une logique tordue du Congrès étasunien, les « États en déroute plus faibles » constituent une menace pour la sécurité des États-Unis : « [P]lusieurs menaces [émanent] d’États décrits soit comme étant faibles, fragiles, vulnérables, défaillants, précaires, en déroute, en crise ou déstructurés ».
Lorsque la Guerre froide a pris fin au début des années 1990, les analystes ont pris conscience de l’émergence d’un environnement de sécurité internationale dans lequel les États faibles et défaillants devenaient des véhicules pour le crime organisé international, des voies pour la prolifération nucléaire et des points chauds pour les conflits civils et les urgences humanitaires. Les menaces potentielles à la sécurité nationale des États-Unis que posent les États faibles et défaillants est devenue davantage évidente avec les attentats du 11-Septembre 2001 contre les États-Unis commis par Al-Qaïda, organisés par Oussama ben Laden à partir du refuge offert par l’Afghanistan. Les événements du 11-Septembre 2001 ont poussé le président George W. Bush à déclarer dans la Stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 2002 que les « États faibles comme l’Afghanistan peuvent poser un danger aussi grand pour nos intérêts nationaux que les États forts ». (Weak and Failing States: Evolving Security, Threats and U.S. Policy, Rapport du CRS pour le Congrès des États-Unis, Washington, 2008.)
Dans ce rapport du CRS du Congrès, on ne mentionne toutefois pas que « les points chauds du crime organisé et les conflits civils » sont le résultat d’opérations clandestines du renseignement étasunien.
Fait amplement documenté, l’économie afghane de la drogue, générant plus de 90 pour cent des réserves mondiales d’héroïne, est liée à une opération de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars impliquant de grandes institutions financières. Le commerce de la drogue en provenance de l’Afghanistan est protégé par le CIA et des forces d’occupation des États-Unis et de l’OTAN.
La Syrie qualifiée d’« État en déroute »
Les atrocités commises contre la population syrienne par l’Armée syrienne libre (ASL), appuyée par les États-Unis et l’OTAN, créent les conditions favorisant une guerre confessionnelle.
L’extrémisme confessionnel favorise le démantèlement de l’État-nation qu’est la Syrie ainsi que la fin du gouvernement central à Damas.
Le but de la politique étrangère de Washington est de transformer la Syrie en ce que le NIC appelle un « État en déroute ».
Le changement de régime implique le maintien d’un gouvernement central. Alors que la crise syrienne se développe, l’objectif ultime n’est plus le « changement de régime », mais la destruction et la partition de la Syrie en tant qu’État-nation.
La stratégie des États, de l’OTAN et d’Israël consiste à diviser le pays en trois États faibles. De récents reportages indiquent que si Bachar Al-Assad « refuse de démissionner, la Syrie « deviendra un État en déroute comme la Somalie ».

L’un des possibles « scénarios de démantèlement » rapporté par la presse israélienne est la formation d’États, séparés et « indépendants », sunnite, alaouite-chiite, kurde et druze.
Selon le major-général Yair Golan des Forces de défense d’Israël (FDI), « la Syrie est dans une guerre civile qui fera d’elle un État en déroute où se propagera le terrorisme » et les FDI analysent actuellement « comment la Syrie se démantèlerait ». (Reuters, 31 mai 2012.)
En novembre l’ambassadeur de la paix des Nations Unies Lakhdar Brahimi a laissé entendre que la Syrie deviendrait « une nouvelle Somalie […] mettant en garde contre un scénario où les seigneurs de guerre et les milices remplissent un vide laissé par l’effondrement de l’État ». (Reuters, 22 novembre 2012.)
« Ce que je crains est pire […], que l’État s’effondre et que la Syrie se transforme en Somalie. »
« Je crois que si l’on ne s’occupe pas de cette question correctement, la partition ne sera pas le problème mais plutôt la « Somalisation » : l’effondrement de l’État et l’émergence de seigneurs de guerre, de milices et de groupes de combattants. » (Ibid.)
Ce que l’envoyé de l’ONU a omis de mentionner est que le démantèlement de la Somalie était délibéré. Il faisait partie d’un projet militaire et du renseignement des États-Unis, désormais appliqué à plusieurs pays ciblés du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie qualifiés d’« États en déroute ».
Voici la question principale : qui déroute les États en déroute? Qui les « anéantit »?
Le démantèlement planifié de la Syrie en tant qu’État souverain relève d’un plan régional intégré d’ordre militaire et des services de renseignement comprenant le Liban, l’Iran et le Pakistan. Selon les « prédictions » du NIC, le démantèlement du Pakistan devrait se produire au cours des trois prochaines années.
Michel Chossudovsky
Article original: “Wiping Countries Off the Map”: Who’s Failing the “Failed States”, publié le 29 décembre 2012.
Traduction Julie Lévesque pour Mondialisation.ca
Michel Chossudovsky est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation et professeur émérite de sciences économiques à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de Guerre et mondialisation, La vérité derrière le 11 septembre et de la Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial (best-seller international publié en plus de 20 langues).

Mondialisation de la pauvreté.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, états-unis, états faillis, états en déroute, géopolitique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 mars 2013
Finanzkapitalistische Raumrevolution

Finanzkapitalistische
Raumrevolution
Ein Anfall
Im Haushaltsausschuss des Bundestages verlor Finanzminister Schäuble in den letzten Novembertagen 2012 jeden Anstand. In Brüssel und in Paris hatte er sich darauf eingelassen, dass die Bundesrepublik erneut Milliardenbeträge nach Griechenland pumpen würde, um dort den Staatsbankrott zu vermeiden. Das überschuldete Griechenland, ein Mafiastaat, der jede moderne Verwaltung und Aufsicht vermissen liess, eine Gesellschaft, unterentwickelt, ohne produktive Industrie und Landwirtschaft, strategischer Militärstützpunkt der NATO, heruntergekommerner Tourismusort, unterschied sich vom technologisch und industriell hochgerüsteten Zentraleuropa grundsätzlich. Hinzu kam, dass die vergangenen Militärdiktaturen und eine von der Mafia gesteuerte „Demokratisierung“ vermieden, den Sozial- und Militärstaat mit einer modernen Steuergesetzgebung und rationalen Bürokratie zu verbinden. Die Kontrollen durch das Parlament blieben mangelhaft. Selbst die europäischen Auflagen und Rechtsdirektiven wurden missachtet. Ein aufgeblasener Apparat diente als Selbstbedienungsladen der Staatsangestellten, der Spekulanten und des organisierten Verbrechens. Der Parasitismus der unterschiedlichen sozialen Schichten wurde sogar noch gefördert und die EU Zuschüsse grosszügig verteilt. Gewinne und Profite wurden nicht registriert und versteuert und eine masslose Verschuldung eingeleitet. Sie wurden über landeseigene und internationale Privat- und Kreditbanken, Hedgfonds und über die europäische Umverteilungen finanziert. Alle lebten in Saus und Braus.
In Griechenland wurden zu hohe Renten und Löhne gezahlt und zugleich riesige Gewinne realisiert. Sie wurden nicht erwirtschaftet, sondern über Kredite und Schulden aufgebracht. Nach den Gesichtpunkten der industriellen Durchschnittsproduktivität und nach dem Zustand von Staat und Recht, lag Griechenland irgendwo in Nordafrika. Dieser Kontinent hatte, bezogen auf Technologie, Arbeitsteilung, Produktion, Verkehr, Recht, Verwaltung, Lug und Trug den Balkan, Süditalien, Südspanien und Portugal erreicht. Der Überbau von Staat und Politik als ein Gebilde aus Korruption, Parasitismus, Vetternwirtschaft, Plünderung hatte mit Zentraleuropa nichts gemeinsam. Riesensummen wurden aus diesen Industriestaaten in das europäische „Afrika“ transferiert. Von dort wurden sie als billige Beute von den reichen und einflussreichen Familien in die Schweiz auf Geheimkonten gebracht oder an die nordamerikanischen Spekulanten weitergereicht. Sie hatten den griechischen Staat mit Krediten ausgeholfen. Die griechischen Regierungen verfälschten in der Vergangenheit die Bilanzen und den Stand der Verschuldung, um in das „Paradies“ der Europäische Union zu gelangen. Die deutschen Steuerzahler finanzierten dadurch die griechischen Betrüger und Absahner oder die nordamerikanischen Kredithaie. Ein grosser Rest wurden an die überbezahlten Staatsangestellten und Rentner bezahlt, um sie ruhig zu stellen und dem System eine demokratische Legitimation zu geben. Kein Wunder, dass in einem derartigen Milieu der Spiritualismus gedieh. Die faschistische „Morgenröte“ pendelte sich zu einer starken Partei auf. Die deutschen Steuerzahler leistete sich den Luxus, einen kranken und maroden Staat zu unterstützen, der unbedingt zu Europa gehören sollte. Diese Entscheidung wurde jedoch in USA gefällt.
Geostrategisch bildete Griechenland für diese Militärmacht einen Flugzeugträger, einen Militärstützpunkt und hielt die Meerenge der Dardanellen nach Russland unter Aufsicht. Griechenland stellte die Verbindung zur Türkei her und bildete die Brücke in den Nahen Osten. Es konnte mit dem albanischen Kosovo und Kroatien verbunden werden, die durch die amerikanischen Bombardements Serbien entrissen wurden. Es hielt die Verbindung nach Bulgarien und Rumänien, die unter nordamerikanischen Einfluss gestellt werden sollten. Griechenland schuf die Garantien für ein europäisches Mittelmeer. Es bildete eine Voraussetzung für ein „Grossisrael“, das sich gegen die arabischen Anreinerstaaten behaupten musste. Nordafrika oder die Nahoststaaten sollten militärisch und politisch dem Einfluss des islamischen Fundamentalismus entwunden werden. Sie sollten wie der Irak und Syrien einer Neuordnung unterliegen. Der zukünftige Krieg gegen den Iran benötigte die geostrategische Position Griechenlands und die finanzielle Unterstützung Deutschlands. Dieser deutsche Staat wurde von den USA angewiesen, das südeuropäische „Afrika“ und Israel zu stabilisieren. Es wurde zugleich darauf vorbereitet, in der Zukunft den Bestand der Mafiastaaten Bulgarien und Rumäniens zu gewährleisten. Frankreich entzog sich der Verpflichtung und geriet selbst in eine Finanzkrise. Deutschland sollte den geldpolitischen Hintergrund für ein „nordamerikanisches Europa“ bilden, das sich gegen Russland, gegen China und den Iran in Front brachte. Die Hauptabsatzmärkte der deutschen Wirtschaft lagen in diesen „feindlichen Regionen“ und im Gegensatz zu dem Aufmarsch wäre eine friedliche Koexistenz mit diesen Ländern notwendig. Deutschland als Wirtschaftsmacht und Griechenland als machtpolitischer Dominostein bildeten eine erzwungene Einheit. Den Deutschen wurde ein neues „Versailles“ aufgedrängt, an dem es kaputt gehen konnte. Das konnte Schäubele alles wissen. Er konnte sich den Auflagen und Befehlen der NATO und der USA schwer entwinden. Er fühlte sich inzwischen als Vertrauensmann dieser Mächte. Er hatte Schwierigkeiten, sich diesen Manipulationen zu entziehen. Die Frage stand im Raum, wie lange er diese Rolle aufrechterhalten wollte?
Der Finanzminister war innerlich erregt, denn er konnte nicht begründen, warum er der deutschen Republik derartige Zahlungen zumutete. Ihm fehlte jedes plausible Argument. Also schrie und pöbelte er. Jetzt im Ausschuss, Ende November, kommentiert durch FAZ, FR und FTD, fühlte er sich von der Linksabgeordneten Pau angegriffen und er wehrte sich gegen den SPD – Hinterbänkler aus Hamburg, der nicht einmal wusste, worum es ging, sondern für Würde und Anstand sorgen wollte. Schäubele brüllte über zehn Minuten in den Saal hinein und gab zu erkennen, dass er die Übersicht verloren hatte. Er ahnte wohl, dass die europäische Krise wie in Argentinien 2001 in einem Staatsbankrott enden konnte. Er wusste, dass er deutsche Interessen kaum noch wahrnahm. Er konnte auch die Tatsache nicht verdrängen, dass er die Ziele der NATO, der EU und der USA bediente und dadurch die staatliche Souveränität Deutschlands unterminierte. Seit Ende der achtziger Jahre hatte er sich in der Regierung Kohl als ein Mann der „Kompromisse“ bewährt. Jetzt steuerte er die Finanzpolitik der Regierung von Angela Merkel und würde den Wohlstand der Mittelklassen in Deutschland riskieren und die Armut der millionenfachen Habenichtse in dieser Gesellschaft vergrössern. Die Zahlungen an Griechenland würden die Inflation und die Steuern steigern. Er wusste, dass Europa sich auf einen Krieg zubewegte. Sehr bald musste die Bundesregierung den Einsatz deutscher Soldaten in der Türkei, in Syrien, Ägypten und im Iran rechtfertigen. Schräuble schrie seine masslose Wut heraus, denn sein unbedachtes Spiel wurde offenkundig.
Planspiele
Listen wir die einzelnen Massnahmen auf. An die wirtschaftliche Konsolidierung der südeuropäischen Staaten durch eine gezielte Entwicklungspolitik wurde in Brüssel und Berlin nie gedacht. Statt die Riesensummen für die Spekulanten, die Absahner und die Mafia zu vergeuden, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, den Ausbau der Infrastruktur dieser Länder zu finanzieren, um eine industrielle Grundlage zu schaffen. Allerdings hätten die EU – Institutionen die Kontrolle der Investitionen übernehmen müssen, um den korrupten Poltikern der Zugriff zu entziehen. Statt Israel mit Atom- U – booten auszurüsten und Militärausgaben zu übernehmen, hätte Deutschland die israelische Wirtschaft stabilisieren können, um einen Friedensprozess des Ausgleichs gegen die Kriegspropheten in diesem Land einzuleiten. Derartig Visionen durften nicht einmal erwähnt werden. Jede rationale Politik wurde von EU und NATO verworfen. Stattdessen einigten sich der griechische Staat und die Europäische Zentralbank darauf, die finanziellen Griechenlandhilfen, von denen Deutschland den Anteil von etwa 70% aufbrachte, zu einem „Schuldenschnitt“ zu nutzen. Die Schuldenagentur in Athen legte Rückkaufwerte für die ausstehenden Staatsanleihen für „private Investoren“ fest. Sie erreichten einen höheren „Preis“, als von den griechischen und nordamerikanischen Investoren erwartet worden war. Der „Internationale Währungsfonds“ (IWF) sollte ruhig gestellt werden. Zugleich wurde es wichtig, die Verluste der Anleihen zu begrenzen und die Inhaber zu veranlassen, die Papiere zu einem nicht erwarteten Wert zurückzugeben. Der „Umtausch“ bzw. der „Rückkauf“ der Staatsanleihen durch die staatliche Agentur wurde mit Hilfe des europäischen und deutschen Hilfsgeldes attraktiv gestaltet, um die Gläubiger zu veranlassen, die fälligen Staatsschulden abzugeben. Der griechische Staat sollte dadurch einen Anfang gestalten, die riesigen Schulden zu tilgen.
Der internationale Anleihenmarkt reagierte mit einem Kurssprung der griechischen Staatspapiere. Sie stiegen von 4.31 Punkten auf 40.06 Zählern. Sogar der Euro konnte im Kurs gegenüber dem Dollar zulegen und stabilisierte seinen Kurswert, weil die Griechen zu einem nicht erwarteten Teilpreis die „Privatschulden“ bezahlten. Die Regierung in Athen verfolgt den Plan, mit Mitteln des Euro – Rettungsfonds (ESFS) die von Privatinvestoren oder Fondsgesellschaften gehaltenen Anleihen im Umfang von 10 Milliarden Euro zurückzukaufen. Es handelt sich um Papiere, die Griechenland im Frühjahr 2012 im Verfahren einer Umschuldung aufgelegt hatte. Der Rückkauf soll die Schulden, da der Preis zum Ursprungswert halbiert wurde, um rund 20 Milliarden Euro senken. Etwa Eindrittel der von Privatbanken gehaltenen Schulden wären durch diesen Rückkauf beglichen. Den Grossteil der griechischen Schulden, ein paar 100 Milliarden Euro, halten die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) und einzelne europäische Staaten. Die genaue Höhe dieser Werte fand bisher keine „öffentliche Zahl“. Gehen die Privatbanken auf dieses angebotene Geschäft des Rückkaufes ein, gibt es einen Wegweiser für die Freigabe der seit Juni „eingefrorenen“ Hilfsgelder. Die Entschuldung Griechenlands könnte langfristig über einen geregelten Rückkauf, über Staatsverträge und über den notwendigen Umbau des Sozial- und Steuerstaates angegangen werden.
Der vorsichtige Anleihenrückkauf verfolgt das Ziel, bis 2020 die Verschuldung auf 124% des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Ohne derartige Massnahmen würden die Schulden Griechenlands „explodieren“ und den Staat in den Bankrott treiben. Ein derartiger Staatspleite würde das Land unregierbar machen, denn Teile der Betriebe der Dienstleistung, der Verwaltung, der Kommunen, der Staatswirtschaft würden schliessen müssen und zugleich die anderen „Südstaaten“ der EU in den Strudel der Staatspleiten reissen. Massenstreiks und soziale Unruhen waren zu erwarten. 2014 hätten die Schulden fast 200% des skizzierten Inlandsprodukts erreicht. Der Schuldenrückkauf musste deshalb sicherstellen, dass die Privatinvestoren auf das Geschäft eingehen und sich verpflichten, die angebotene Teilsumme zu akzeptieren. Die Staats- und staatlichen EU – Bankschulden wurden über Staatsverträge geregelt, an die sich die privaten „Spekulanten“ nicht halten mussten. Sie konnten internationale Gerichtshöfe anrufen, ihr Geld einklagen und den Schuldnerstaat in die Pleite jagen. Das passierte 2001 in Argentinien. 2012 wurde der Staatsbankrott des südamerikanischen Staates nicht abgewendet, denn die einzelnen Privatfonds bestanden auf der Zahlung des „gesamten Preises“ der Schulden. Die Konstruktion des Schuldenrückkauf war auch für Griechenland schwierig und der Staat musste eine „wacklige Normalität“ organisieren. Das komplizierte „Kartenhaus“ konnte schnell zusammenstürzen.
Die Entschuldung Griechenlands kannte drei Phasen. Zuerst mussten die Privatkunden, privaten Banken und Spekulanten in die Massnahmen eingebunden werden. Danach regelten Staatsverträge und Abmachungen den Rückkauf der Schulden von den Staatsbanken und Einzelstaaten. Unter Umständen wurde die Summe der Schulden Griechenland erlassen, falls nicht die anderen Schuldnerstaaten wie Spanien, Portugal, Italien, Irland u. a. die gleichen Bedingungen „einklagen“ würden. Der Schuldenrückkauf lief deshalb in der Form einer „Auktion“, um die Stimmungen und Interessen auf dem „Schuldenmarkt“ zu testen. Die Investoren und Gläubiger mussten ihre Preisvorstellungen offenlegen. Danach wurde von der Staatsagentur das Kaufangebot unterbreitet. Griechenland bot seinen Gläubigern je nach Laufzeit der Anleihe zwischen 30,2% und 38,1% des Nennwerts der jeweiligen Staatsanleihe. Den Zuschlag erhalten die Höchstgebote, die zwischen 32% und 40% liegen konnten. Auf dem freien Markt war lediglich mit einer Offerte zwischen 20% und 30% zu rechnen. Für einen begrenzten Zeitraum konnten die Spekulanten mit einem Zuschlag von etwa 10% rechnen. Sie hatten oft die Papiere auf dem niedrigen Stand von ca. 8% des Kurswerts gekauft und verdienten so nebenbei ein paar hundert Millionen Euro, denn Deutschland hatte nun zugesagt, weiterhin für die Schulden Griechenlands aufzukommen. Stimmten sie zu und schalteten nicht die internationalen Gerichtshöfe ein, konnte die zweite und dritte Phase eingeleitet werden. Nicht nur der deutsche Finanzminister zeigte sich nervös. Alles hing an einem „seidenen Faden“.
In Argentinien war 2001 eine derartige Planung gescheitert, die nordamerikanischen Spekulanten und die unterschiedlichen Staatsbanken unter einen „Hut“ zu bringen. Der Staatsbankrott zerstörten den argentinischen Mittelstand, der in Bezug auf Bildung, Dienstleistung, Sicherheit, Gesundheit, Fürsorge, Erziehung usw. vom Staat anhängig war und auf die Strasse gesetzt wurde. Dieser Mittelstand hatte die Elektro-, Mode-, Computer-, Nahrungsmittel-, Bau- und Autoindustrie „gefüttert“ und diese Branchen durch die Arbeitslosigkeit und Pleiten in den Ruin getrieben. Die Immoblienpreise zerfielen. Die Hedgefonds hatten sich am Spiel der „Entschuldung“ nicht beteiligt. Bis heute wird das ausländische Kapital angeklagt, Argentinien in den Abgrund zu treiben. Der Populismus von Cristina Kirchner bekam Auftrieb und aktualisierte den antiimperialistischen Kampf. Vor allem der Hedgefonds Eliot Capital und Aurelius Capital und der Internationale Währungsfonds (IWF) verklagten den argentinischen Staat auf die Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar. Sie erhielten 2012 vor dem amerikanischen Gerichtshof Recht. Bereits Ende 2005 beglich Argentinien die Schulden beim IWF, bevor die anderen Gläubiger abgefunden wurden. Der IWF hatte 2001 einen Kredit zurückgehalten und den Staatsbankrott ausgelöst. Argentinien pocht heute auf Souveränität und ist bemüht, den Einfluss des internationalen Finanzkapitals zurückzudrängen, um so etwas wie „Souveränität“ zu erlangen. Die genannten Hedgefonds beteiligten sich nicht am „Schuldenschnitt“. Sie klagten vor dem US – Gericht auf Gleichbehandlung. Die Klage wurde in der ersten Instanz anerkannt. Muss Argentinien zahlen, wäre ein zweiter Staatsbankrott angesagt. Dieses Beispiel beweist, dass der Prozess und die Phasen der Entschuldung eine weitere Komplikation enthalten, ziehen die Spekulanten nicht mit. Sie verfolgen andere Ziele als die Staaten und sind primär an hohen Gewinnen und an der Sicherung der Rohstoffe, Ländereien und Immobilien interessiert. Sie setzen wie in Südeuropa auf Krieg, um die „Landmächte“ Iran, Russland und China zu entmachten. Die „Logik“ ihrer Spekulation ist schwer zu durchschauen. In Nordamerika und in Europa begründeten sie eine Doppelmacht zum Präsidenten oder zu den Staaten der EU, da eine Bankkontrolle fehlte bzw. zu Beginn der neunziger Jahre abgeschafft wurde. Die neuen Rohstoffe, Industrien und Immobilien in Osteuropa, Russland und Afrika sollten gesichert werden.
Die griechische Staatsanwaltschaft demonstrierte der europäischen Öffentlichkeit nach der letzten Zahlung der Hilfsgelder, was die griechischen Spekulanten mit dem leicht verdienten Geld aus der EU anfingen. Die Staatsanwaltschaft untersuchte Vorwürfe gegen knapp 2000 Griechen, die Bankkonten bei der Genfer Filiale der britischen Grossbank HSBC eingerichtet hatten. Ihnen wird Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Finanzbetrug vorgeworfen. Illustre Namen aus Politik, Bankgeschäft und Mafia sind auf der Liste der Betrüger zu finden. Sie belegen Verbindungen, die vorher nicht einmal vermutet wurden. Mit dem Namen von Magret Papandreou tauchten Hinweise auf die Spitzen der politischen Elite auf. Sie lenkten auf raffinierte Weise Zahlungen aus der EU auf ihre Konten, überwiesen die Summen auf Schweizer, britische oder nordamerikanische Banken und kauften mit diesem Geld etwa in Berlin, München oder Frankfurt/ Main Immobilien, Mietshäuser, Grundstücke und landwirtschaftliche Nutzflächen. Die einzelnen Wohnungen wurden mit „Eigenbedarf“ belegt, verkauft und die Mieter vertrieben. Das Geld kam also nach Deutschland zurück und wurde in „sichere Anlagen“ investiert, weil Zentraleuropa für die Spekulanten eine gute Adresse war. Zugleich wurden die deutschen Steuerzahler, die die Zahlungen nach Griechenland aufbrachten und soweit die Wohnhäuser von den neuen griechischen Hausbesitzern „besetzt“ wurden, aus ihren Wohnungen gejagt.
Die griechische Staatsanwaltschaft deckte diese Machenschaften auf, um den Gremien der EU und Deutschlands die europäische Normalität des Rechtsstaates in Griechenland zu signalisieren, falls weiterhin die Unterstützungsgelder flossen. Sie brachten „Bauernopfer“, ohne den Kreislauf oder den Geldtransfer kaschieren zu wollen. Das europäische Geld wurde teilweise in Griechenland abgezweigt und landete auf den Konten in der Schweiz. Von dort wurde das Geld zum Immobilien- und Landkauf in Europa eingesetzt oder wurde genutzt, Ländereien oder Wälder in West- oder Ostafrika zu erwerben. Das „Holz“ wurde geschlagen und die Wälder gerodet. Anschliessend wurden riesige Soya-, Mais- oder Zuckerrohrfarmen errichtet, um aus diesen genmanipulierten Naturrohstoffen Biogas oder Bioöl herzustellen, das in Europa teuer zu Weltmarktpreisen verkauft wurde. Die afrikanischen Bauern wurden vertrieben und schlugen sich nicht selten als Flüchtlinge nach Europa durch. Allein an diesem Beispiel lässt sich die „negative Funktion“ der Finanzspekulation und des Finanzkapitals aufzeigen. Die Zerstörung aller „Produktivkräfte“ enthielt keinerlei Schaffenskraft oder eine Zielsetzung, die Weltgesellschaften zu stabilisieren. Falls die Regierungen der Zerstörungswut und der Raffgier dieses Kapitals keinen Einhalt boten, würde es über den Weltmarkt Not und Elend tragen. Die enge Kooperation der Spekulanten mit den Ganoven der Mafia und der politischen Eliten, die die griechische Staatsanwaltschaft aufgedeckt hatte, entwarf ein erstes „Gesicht“ dieses Kapitals, das keinerlei Moral oder Verantwortungsethik kannte. Erstaunt waren die Berichterstatter der Zeitungen, dass die Parteien des Bundestages, etwa die Grüne Partei und die CDU zu fast 100% der Griechenlandhilfe zustimmten. War die Erwartung einer zukünftigen „Koalition“ so gross, dass diese Parteien die aktuelle „Raumrevolution“ des Finanzkapitals nicht zur Kenntnis nahmen und sich diesen Manipulationen auslieferten? Würde ein Verteidigungsminister Trittin, deutsche Soldaten in die Türkei und in den Iran schicken? Gab es keinen „Karl Liebknecht“ bei den grünen Aufsteigern? Wurde die ganze Biographie dieser Poitiker für einen Staatsjob riskiert?
Fragen des Weltmarktes
Wieso konnte Afrika in Gestalt der Misswirtschaft, der niedrigen Arbeitsproduktivität, der Arbeitslosigkeit, der Überbevölkerung, der Verschuldung nach Südeuropa hineinragen? Warum wurde Russland „asiatisiert“? Wie konnte es passieren, das Afrika, Asien und Lateinamerika sich in den nordamerikanischen Kontinent eingruben? Die Kriterien sollen entschlüsselt werden in der je spezifischen Form des Kapitalismus der einzelnen Gesellschaften und Regionen. Die Übersetzung der technologischen Revolutionen in die Produktivität der Industrie und in den rationalen Aufbau von Staat, Recht und Verwaltung bestimmen ein weiteres Thema. Berücksichtigt werden soll das Ausmass der Konzentration und Zentralisation der Produktion, der Banken und des Handels. Die Machtpolitik der Kapitalfraktionen, vor allem des Finanz- und Medienkapitals und der politischen Klasse, bildet einen anderen Gesichtspunkt. Die Kriegs- und Rüstungswirtschaft, gekoppelt mit den unterschiedlichen Ansätzen von Diktatur, mit der Neudefinition der Klassen und Völker und mit den politischen Bündnissen der einzelnen Eliten, umreissen einen weiteren Masstab der kapitalistischen Durchdringung der einzelnen Kulturen und Erdteile. Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang von Machtpolitik und Imperialismus die Disposition der Ideologie und die Umsetzung in Propaganda, Reklame und politische Religion. Der Okkultismus der herrschenden Cliquen gewinnt an Bedeutung, denn sie reagieren auf eine wachsende Rationalität von Organisation und Planung, auf die Unregierbarkeit von „Massen“, die durch Automation und Denkmaschinen aus Arbeit und „Brot“ gedrängt werden. Die herrschenden Machteliten verbergen über rassische, religiöse oder völkische Mythologien die Potentialitäten der sozialen Frage und der „Freiheit“. Sie begründen über Verschwörungen und parapsychologische Phantasmen den Führungsanspruch. Im Angesicht einer technisch begründeten Produktionsordnung radikalisieren die Spekulanten und Ideologen den Irrationalismus und zerren die Neuzeit zurück in das dunkle Mittelalter. Wie lassen sich nun derartige Differenzen und die Formen von Machtpolitik skizzieren?
1. Differente Akkumulationsbedingungen des Kapitals im Weltmaßstab: Entscheidend für die potentielle Einheit und für den hierarchischen Aufbau des Weltmarktes sind und waren die unterschiedlichen Akkumulationsbedingungen des Kapitals. Marx und Engels skizzierten bereits die unterschiedlichen Formen einer ursprünglichen Akkumulation des Kapitals in England, Frankreich, Preussen, Russland und Nordamerika. England wies die klassische Form des Kolonialismus, der Vertreibung, des Handels, des Manufakturkapitals, der „industriellen Revolution“ und der Proletarisierung der eigentumslosen Bauern und Städter auf. Frankreich und USA kannten neben dem Staat die Unterstützung des Finanzkapitals, das jeweils die Kredite für die industrielle Akkumulation zur Verfügung stellte. Die Rüstungswirtschaft und der Aufbau einer modernen Armee und Flotte wurden Motor einer technologischen „Revolution“, die sich an den neusten Waffensystemen orientierte. Die staatlichen Investitionen wurden durch Kredite unterstützt, die das Finanzkapital zur Verfügung stellte. Es favorisierte die Herausbildung der Monopole, der Trust und Syndikate, um die organisatorische und wertmässige Konzentration der Produktion durch eine Zentralisation der „Produktivkräfte“ zu steigern, die eine bessere Arbeitsteilung und eine enge Kooperation der Betriebe und Regionen ermöglichten. Preussen bereits übersetzte über Staat und Armee die technologischen und industriellen Errungenschaften des „Westens“ in Reformen und in eine staatskapitalistische Kriegswirtschaft, die auf der Privatwirtschaft fusste, zugleich jedoch die Erfindungen und Entdeckungen, die Forschung materiell und produktiv in der Rüstung umsetzte. Die Mischformen staatlicher und privater Initiativen wurden bedeutsam. Diese wiederum beeinflusste die zivile Produktion. Über eine weitgefächerte Bildung der Berufs- und Ingenieursschulen und über das System der Forschungsstätten, der Naturwissenschaften und technischen Universitäten wurde ein Mittelstand geschaffen, der als Unternehmer, Forschungsintelligenz, Management, Verwaltungsspezialist, Offizier die Effiziens und die Breite der industriellen Produktion in Gross- und Kleinbetrieben förderte. Über diese technologische und bildungspolitische Kooperation manifestierten sich politische Bündnisse zwischen den Facharbeitern und Ingenieuren, Gewerkschaften und Unternehmern, Parteien und Armee. Die Kriegswirtschaft als staatskapitalistisches Unternehmen bewährte sich nach 1945 als eine enge Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Kräfte. So „gewann“ das westliche Deutschland in den fünfziger Jahren durch ein „Wirtschaftswunder“ nachträglich den II. Weltkrieg.
2. Staatskapitalistische Erweiterung der kapitalistischen Industrialisierung: In Russland und USA wurde dieses „preussische Modell“ (Stolypin nach 1905, New Deal nach 1934) übernommen, wirkte jedoch unterschiedlich. Russland wollte den preussischen Reform- und Militärstaat übertragen, scheiterte jedoch an der Schwäche der Staatseliten und des russischen Industriekapitals. Die Arbeiterklasse als legale Gewerkschaft konnte sich nicht formieren. Die bolschewistische Diktatur errichtete nach 1917 einen Kriegskommunismus, der primär über Terror und Zwang die industrielle Akkumulation umsetzte. Zugleich wurden die Klassen und Völker über die Staatsdespotie und die Zwangsarbeit umdefiniert in „werktätige Massen“. Die Rüstung stand im Mittelpunkt, erlangte jedoch nie die Produktivität des westlichen Kapitalismus und konnte nur bedingt auf die zivile Produktion übertragen werden. Trotz einer Bildungsreform fehlten in einer Mangelwirtschaft die produktiven Facharbeiter und Ingenieure. In einem Zwangssystem verpasste die Propaganda und die politische Ideologie die Erziehung selbstbewusster und produktiver Arbeitskräfte. Bis 1989 konnte die Diktatur über Polizei- und Militärgewalt das russische Imperium bewahren, das danach unter den Schlägen des westlichen Kapitalismus sehr schnell zusammenbrach. Die russische Macht, eingeklemmt in den Methoden von Staatskapitalismus, Planwirtschaft, despotischer Präsidialmacht und Privatkapital, hatte Probleme die innere Konsistenz gegen die vielen Völker und nationalen Märkte zu behaupten. Der Präsident Putin nahm deshalb die Ziele der bolschewistischen Expansion erneut auf, um sich gegen das US – Finanzkapital behaupten zu können, das an den Rohstoffen und an den Zerfall Russlands in Einzelrepubliken interessiert ist.
3. Finanzkapitalistische Formen der Konzentration und Zentralisation des Kapitals: In USA sorgte das Finanzkapital für die wirtschaftpolitische Besonderung und „Funktion“ der Monopole und Syndikate, die durch Armee und Flotte unterstützt und durch die Präsidialmacht finanziert und kontrolliert wurden. Schon deshalb erlangte hier das Finanzkapital den Zuschnitt einer Doppelmacht, die Einfluss nahm auf die „Politik“ und die Medien und ausserhalb der Verfassung innen- und aussenpolitische Ziele verfolgte. Es sicherte sich den Zugriff auf die Weltrohstoffen und forderte die Unterstützung von Armee und Flotte. Es konkurierte mit dem europäischen und asiatischen Imperialismus und übernahm sehr bald die Erbschaft des spanischen, portugiesischen, französischen und englischen Imperialismus. Der dreissigjährige Krieg mit Deutschland und Japan nach 1914 liess sich nicht vermeiden. Der Sieg über Japan und Deutschland machten Russland und China zu den Hauptgegnern. Nicht der amerikanische Präsident propagierte den Mythos von „Feindschaft“ und „Okkupation“, sondern das Finanzkapital folgte hier der Logik von Profit, Macht, Markt und Rohstoffsicherung, kaschierte jedoch diese Ansprüche unter den Handels-, Freiheits- und Menschenrechten. Es sorgte dafür, dass über internationale Verträge und Militärstützpunkte die mediale „Inszenierung“ und Gestaltung der Demokratie und die Herrschaft der Machteliten auf die Einflusszonen übertragen wurden. Neben den russischen und chinesischen „Reichen“ und „Kontinenten“ wurde nach 1918 und vor allem nach 1945 und 1989 ein nordamerikanisches „Imperium“ gefestigt und ausgedehnt.
4. Der chinesische Weg der Industrialisierung: China kombinierte die russische Erfahrung von Staatskapitalismus und Planung mit einer Öffnung zum Weltmarkt und zum westlichen Finanzkapital. Es sicherte vielfach das chinesische Reich über staatliche Grossbetriebe, Zwangsarbeit, Kleinwirtschaft, „Kommunen“, das Primat der “Partei“, Militarisierung der Gesellschaft und Polizeiwillkür. Die Gefahr der Verselbständigung einer „Despotie“ sollte durch die materiellen Anreize eines mittelständischen Privatkapitalismus und der „Konkurrenz“ der staatlichen Grossbetriebe auf dem Weltmarkt aufgebrochen werden. Jedoch nicht die kapitalistischen Investoren oder das private Kapital sollte die Oberhand gewinnen und dem westlichen Finanzkapital Einfluss und Herrschaft gewähren. Der chinesische Staatskapitalismus improvisierte als Staatshandel und Staatsbank die westlichen Methoden der Spekulation und der Kreditvergabe und koppelte diese „Kapitalisierung“ mit einer ökonomischen Politik des privaten Handels, des Mittelstands und der Bauernwirtschaft. Zugleich produzierten die Staatsbetriebe vorerst Ramschprodukte für den Weltmarkt, stellten sich jedoch auf eine Qualitätsarbeit im Auto- und Maschinenbau ein. Ob dieser Kriegskommunismus als Friedenswirtschaft Erfolg haben wird, wird sich zeigen. Eine Rüstungswirtschaft, moderne Armee und Flotte belegen die Ziele eines chinesischen Imperialismus, der seinen Einfluss in Asien und Afrika ausbaut. Hatte Russland Mühe, sich als europäische und asiatische Macht zu konsolidieren, stemmte sich die Volksrepublik China gegen die us-amerikanischen Ansprüche von Weltmacht und Einflusszonen.
5. Mischformen der Industrialisierung: Der asiatische Kontinent weist neben dem japanischen und chinesischen Weg zum Kapitalismus Wirtschaftsexperimente auf, die sich an Europa, die USA, Russland oder das britische Empire orientieren. Die wachsende „Überbevölkerung“ kann durch eine mässig wachsende Wirtschaft nicht absorbiert werden. Sie wandert ab, gefördert durch den Weltmarkt oder durch ein EU – Recht oder illegal, nach Europa, Russland oder Nordamerika. Dadurch entstehen in diesen Gesellschaft „kulturelle Zonen“, die die ursprüngliche, nationale Kultur zersetzen oder zu einem neuen, anderen Zusammenhalt kombinieren.
6. Die Teilmärkte unter dem Druck des Weltmarktes: Der Weltmarkt teilt sich auf in die unterschiedliche Teilmärkte, die zwar der industriellen Produktivität „Rechnung“ tragen und sich den Durchschnittpreisen, Gewinnen und Profiten annähern, trotzdem die Politik und den Staat als Regulator benötigen. Dieser Staatseingriff wird durch das nordamerikanische Finanzkapital in Lateinamerika, Europa, Afrika, Australien, Asien, Russland und China aufgebrochen. Die Sicherung der Weltrohstoffe wird als Ursache der Intervention genannt. Es geht jedoch darum, jede Souveränität und Unabhängigkeit auszulöschen, um über einen Weltmarkt die eigene Ordnung zu sichern, die eine Konkurrenz der kulturellen Werte, der politischen Mächte oder gar des Fremdkapitals nicht dulden kann. Die Sicherung der Macht des Finanzkapitals benötigt den Staat und die Legitimation über eine „parlamentarische Demokratie“, die allerdings den Interessen der Lobbygruppen des Kapitals folgen muss. Diese „Legitimation“ durch die „Massen“ benötigt die mediale Inszenierung von Politik und Wohlbefinden und sie ist auf die Einfluss- und Machtlosigkeit der „Bürger“ und „Wähler“ angewiesen. Schon deshalb werden die Partei- und Staatseliten kontrolliert, „bezahlt“ und „verwaltet“. Derartige Herrschaftsmethoden und Feindbilder gegen Russland, China, den Iran, den Islamismus erfordern die politische, wirtschaftliche und kulturelle Einheit des Imperiums.
7. Die Theorie des staasmonopolistischen Kapitalismus und die Fragen der „Raumrevolution“: Nikolai Bucharin und Eugen Varga begründeten eine Theorie des „Staasmonopolistischen Kapitalismus“ (Stamokap), die von einer doppelten Negation der finanzkapitalistischen Intervention auf Wirtschaft und Staat ausging. Die Existenz der „Sowjetunion“ und der kommunistischen Arbeiterbewegung zwang nach diesem theoretischen Kalkül das Finanzkapital, einen Sozialstaat anzuerkennen und zu fördern und zugleich gegen die kommunistische Herausforderung faschistische oder konterrevolutionäre Parteien oder Formationen zu formieren. Mit Hilfe dieser „konterrevolutionären Kräfte“ wurden Kriege vorbereitet, konnte Georgij Dimitroff auf dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale berichten. Ein ausserökonomischer Faktor verlangte neben den Verfassungsrechten die Anerkennung sozialer Rechte im Staatsaufbau. Zugleich fand der „Faschismus“ Unterstützung, um die kommunistischen Ansprüche einzugrenzen und zu überwinden. Wir folgen dagegen der Einschätzung von Karl Marx, Rudolf Hilferding, W. I. Lenin, Rosa Luxemburg, Max Horkheimer und Herbert Marcuse. Die Arbeiten der konservativen Denker um Max Weber, Carl Schmitt und Ernst Forsthoff über die Herrschaftsformen und über den Status von Recht und Verfassung geben weitere Einblicke.
8. Zur Theorie der Doppelmacht: Das Finanzkapital formierte neben dem nationalen Staat eine internationale Doppelmacht. Die Staatsinterventionen bzw. die Methoden des Staatskapitalismus wurden genutzt, eigene Interessen umzusetzen. Die „Inszenierung“ der Demokratie als Parteienherrschaft und als Medienmacht sollte sicherstellen, die politischen Eliten in Abhängigkeit zu bringen und die sozialen Klassen und Interessengruppen zur Anerkennung bestehender Herrschaft zu zwingen. Die Umdefinition der Klassen in Publikum, Konsument, Zuschauer usw. sicherte neben der Subsumtion der politischen Eliten unter die kapitalistischen Interessen die Macht des Finanzkapitals, ohne Widerstand oder Widerworte zu riskieren. Die „Paralyse“ und die „Chaotisierung“ der Gesellschaft, ihre Pauperisierung und Verwahrlosung garantierten die finanzkapitalistische Macht als demokratisch inszenierte Diktatur. Diese Macht wirkte expansiv und empfand jeden Widerspruch als politische Herausforderung, so dass neben dem Sicherheitsstaat der Sozialstaat die Ausmasse eines totalen Staates gewann, ohne allerdings eine offensive „Militarisierung“ und „polizeistaatliche Kontrolle“ der Gesellschaft zu eröffnen. Die Sicherung der Weltrohstoffe und die massive Aufrüstung trugen die Potenzen neuer Kriege. Neue Regionen und Kontinente sollten vom Imperium besetzt werden.
9. Finanzkapitalistische Machtprinzipien und die Zerstörung der kontinentalen Ordnung: das Beispiel Russland. Der Zusammenbruch des russischen Kriegskommunismus Ende der achtziger Jahre hatte viele Ursachen. Die Planwirtschaft verlor die Übersicht über die industriellen und materiellen Ressourcen. Die Hierarchie der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger potenzierte einen Bürokratismus, der auf die produktiven und technologischen Veränderungen der industriellen Produktion nicht mehr reagieren konnte. Die Mangelwirtschaft schuf Unzufriedenheit im Volk. Die Arbeitsethik wurde zerstört. Schlamperei, Diebstahl, Gleichgültigkeit und Sabotage gehörten zum Arbeitstag der Ingenieue und Arbeitskräfte. Die ideologische Propaganda verlor jede Resonanz. Die Mangel- und Planwirtschaft gab den russischen Werktätigen „überschüssiges Geld“, das sie nicht ausgeben konnten, weil es nichts zu kaufen gab. Die Korruption zerfrass eine geplante „Reproduktion“ der Wirtschaft. Ein „geheimer Kapitalismus“ breitete sich über den Schwarzmarkt und über die organisierte Kriminalität in der Wirtschaft und in den „Staatsorganen“ aus. Den Rüstungswettstreit zwischen USA und UdSSR musste die russische Diktatur verloren geben. Die Rüstungswirtschaft befruchtete nicht die Konsumindustrie. Sie kostete Riesensummen Rubel. Forschung und Spionage waren schlecht mit der Wirtschaft koordiniert. Armee und Geheimpolizei konnten die Gesellschaft nicht länger „militarisieren“ oder kontrollieren. Im wachsenden Chaos konnte sich das finanzkapitalistische Prinzip von Macht und Geschäft ausbreiten, wie Michail Chodorkowski in „Mein Weg, ein politisches Bekenntsnis“ beschreibt. Erste Reformen legalisierten zum Ende der achtziger Jahre den „grauen“ und den „schwarzen“ Markt. Ein eigenständiges „Wirtschaften“ sollte die Kooperation zwischen den Staatsunternehmen und den Universitäten erleichtern. Die Kosten sollten für die staatlichen Grossbetriebe gesenkt werden. „Private Kooperative“ sollten die Möglichkeiten schaffen, mehr Konsumgüter herzustellen. Chodorkowski organisierte in Moskau an der Universität und an der Akademie der Wissenschaften junge Forschungsspezialisten, die neue technische Produkte entwarfen und für den Konsummarkt aufbereiteten. Vor allem die Computertechnik, die Produktion künstlicher Diamanten oder Kunststoffe, Farben wurden für russische Verhältnisse übersetzt, verändert und für die Massenproduktion vorbereitet. „Leistungsverträge“ zwischen den einzelnen Abteilungen der Universität und den Staatsbetrieben wurde geschlossen, um an „Material“ oder Rohstoffe heranzukomen. Ein staatliches Komitee für Preise behinderte weiterhin die Flexibilität der Kooperativen und sorgte für langwierige und bürokratische Verfahren. Das „übeschüssige Geld“ der Betriebe und der Konsumenten verlangte nach einem „freien Handel“, der schliesslich von der staatlichen Preisaufsicht gewährt wurde. Die Planwirtschaft zerbrach. Jetzt liefen sogar die Geheimpolizisten zu den neuen Unternehmern über und lieferten Informationen. Chodorkowski erlangte dadurch von der Staatsbank die Erlaubnis, eine „Geschäftsbank“ zu gründen und mit Devisen und ausländischen Waren, etwa mit amerikanischen Computern, „russifiziert“ im Sprachprogramm und in der „Logistik“, zu handeln. Als erfolgreicher Unternehmer unterstützte er Jelzin bei der Präsidentenwahl Mitte der neunziger Jahre. Es gelang ihm, Erdölquellen und Rohstoffelder zu erwerben und gründete im neuen Jahrtausend den Yukos – Konzern. Er kooperierte eng mit den nordamerikanischen Chevron – Konzern und wollte eine Pipeline nach China und nach Murmansk errichten. Von Chevron übernahm er unterschiedliche Technologien, die das nordamerikanische Patent trugen, die als „Privileg“ die Dieselproduktion aus Erdgas „revolutioniert“ hätten. Chodorkowski finanzierte die russischen Parteien Jabloko, Einheitliches Russland, sogar eine Kommunistische Partei. Zugleich wollte er Fernsehsender aufkaufen, Universitäten und Forschungsakademien einrichten und sich als Präsidentschaftskandidat gegen Putin aufstellen lassen. Er verkörperte ohne Zweifel die amerikanische „Freiheit“ in Russland, trotzden stand die „Struktur“ von Politik und Öffentlichkeit, Technik und Patentrecht, Finanzkapital und Rohstoffverarbeitung, Wissenschaft und Forschung nicht in der „russischen Tradition“. Der Schutz des Volkes, der Rohstoffe und der Wirtschaft liess sich mit dieser „Kapitalisierung“ nicht vereinbaren. Nicht aus dem „russischen Kontinent“ wurden neue Formen der Demokratie, des Rechts und des Marktes aus dem „Kriegskommunismus“ ertrotzt, sondern das Prinzip des westlichen Finanzkapitalismus wurde „aufgeproft“. Das mag der Grund sein, warum der Präsident Putin Michail Chodorkowski verhaften liess.
10. Die vier Säulen der nordamerikanischen Zivilisation: In Strategiepapieren des Center for a New American Security (CNAS) und des German Marshall Fund of the United States (GMFUS) werden die vier Säulen der nordamerikanischen Weltordnung herausgestellt. Sie umfassen Frieden, Wohlstand, Demokratie und Menschenrechte. Sie werden gesichert und ausgebaut über die Welthandelsordnung (WTO), Weltfinanzordnung (IWF), Seefahrtfreiheit (UNCLOS), die Nichtverbreitung von Atomwaffen und die Menschen- und Freiheitsrechte. In Russland und vor allem in China werden diese Säulen des nordamerikanischen Imperiums nicht anerkannt. Die chinesische Volksrepublik unterläuft durch Staatsunternehmen, durch die Staatsbank und durch die Kopie der finanzkapitalistischen Methoden in Handel und Kreditmarkt die Welthandelsordnung. China untergräbt durch eigene Kreditvergaben den internationalen Währungsfonds und wickelt den Welthandel nicht über den Dollar, sondern über den chinesischen Yuan ab und vergibt eigenständig Kredite an afrikanische und lateinamerikanische Staaten. Diese Grossmacht benutzt den Dollar zur „Gegenspekulation“, um die manipulierte Staatsverschuldung und Währungspolitik des nordamerikanischen Finanzkapitals in den Staatsbankrott der USA zu überführen. China verstösst gegen das internationale Seerecht, denn es beansprucht Inseln im südchinesischen Meer. Es will die Rohstoffe und Erdöllager für die chinesische Volkswirtschaft sichern. Der Bau der Atomwaffe wird durch China in Nordkorea und im Iran unterstützt. Es akzeptiert nicht die westlichen Handels-, Menschen- und Freiheitsrechte und unterstützt eine politische Ordnung, die sich grundsätzlich von der nordamerikanischen Demokratie unterscheidet. Dadurch gibt primär China sich als „Feind“ der USA und Westeuropas zu erkennen. Cuba, Venezuela, Iran, Russland wären machtunfähig, würde China nicht für die Souveränität dieser Staaten einstehen.
11. Die USA und die „Swingstaaten“: Um China zu isolieren, orientieren die USA sich auf die „Übergangs- und Swingstaaten“, die eine eigenständige Industrialisierung durchführen und zugleich Teilmärkte des Welthandels bilden. Es handelt sich um Brasilien, Indien Indonesien und die Türkei. Diese Staaten sollen überzeugt werden, die chinesische Wirtschaftsexpansion zu stoppen. Im Rahmen der WTO sollen Schutzzölle gegen chinesische Importe erhoben werden. Mit den einzelnen Unternehmerverbänden sollen Verhandlungen aufgenommen werden, die chinesische Konkurrenz einzudämmen und zu vermeiden, chinesische Kredite anzunehmen. Freihandelszonen mit den USA sollen gegründet werden, um die eigene Wirtschaft zu fördern und den Einfluss des IWF zu gewährleisten. Aus diesem Währungsfonds sollen die Nationalbanken und Staaten Kredite aufnehmen. Eine Kooperation mit Brasilien sollen die USA befähigen, in Afrika eine neue Entwicklungspolitik aufzunehmen, die sich nicht primär um die Rohstofflager kümmert, sondern die wirtschaftlichen Grundlagen der einzelnen Staaten fördert. Die chinesischen Erfolge in Afrika beunruhigen die USA, die Brasilien einsetzen müssen, um auf die afrikanische Kultur und Sozialstruktur eingehen zu können, ohne die korrupten Eliten zu unterstützen. Die Militärmacht der Türkei wird angesprochen, die arabischen Armeen in Saudiarabien zu trainieren und die Verbindungen zur NATO und zur Bundeswehr zu verstärken. Das türkische Militär soll zur politischen Stabilisierung der Region beitragen, falls ein interner Bürgerkrieg die staatliche Struktur Syriens und des Iraks zerstört. Die türkische Armee soll die Intervention der USA oder Israels „übernehmen“ und zugleich den Nahen Osten im Sinne der nordamerikanischen Ordnung befrieden. Der Türkei wird zugestanden, dass kein kurdischer Staat gegründet werden kann. Ausserdem soll die Türkei Teil der EU werden, um diesen Staatenbund und die NATO in den potentiellen Krieg gegen den Iran und gegen Russland einzubinden. Diese Swingstaaten sollen angeregt werden, Parteien und politische Eliten im nordamerikanischen Sinn aufzubauen. Ausserdem sollen Nichtregierungsorganisationen (NGO) den chinesischen Einfluss in Indonesien und in den arabischen Staaten zurückdrängen.
12. Die Weltüberbevölkerung und die sozialen Völkerwanderungen: Die Produktivität der kapitalistischen Industriezweige und das Wachsen der Weltbevölkerung „produzieren“ eine Überbevölkerung, die von den bestehenden Arbeitsmärkten der einzelnen Staaten nicht aufgenommen werden kann. Eine grosse Masse, junge und alte Arbeitskräfte, Flüchtlingen, Vertriebene, Verelendete, Arme, Emigranten werden durch Sozialhilfen und Hilfsgelder ernährt. Sie erlauben primär in Zentraleuropa, in Deutschland und in einzelnen Städten und Staaten der USA den Betroffenen ein „Überleben“, das lediglich den Bruchteil des Wohlstands des Mittelstands erreicht. Fast Eindrittel der europäischen Bevölkerung geriet in den Status der Hilfsbedürftigen. Sie „geniesst“ einen Lebensstandard, der zwar im Masstab des Landes „erbärmlich“ bleibt, trotzdem gegenüber Afrika, Asien und Lateinamerika eine „Verheissung“ vorstellt. Dort darben fast Zweidrittel der Völker ohne Land, ohne Auskommen und Arbeit in den Slumgrosstädten. Eine industrielle Entwicklung scheint unmöglich zu sein, weil die imperialistischen Mächte an Rohstoffen, Urwald und Land interessiert sind und die korrupten Eliten diese Interessen bedienen. Vor allem die Jugend kennt deshalb nur ein Ziel, nach Europa oder Nordamerika zu kommen, um hier zu überleben. Dieser Sozialstaat und dieses Flüchtlingslager in Europa müssen polizeiliche Methoden der Kontrolle einsetzen, um diese Massenbevölkerung der Paupers unter Aufsicht zu halten. Nicht allein der Ausnahmestaat, Rüstung und Militär bedrohen den Rechtsstaat, er wird zugleich durch den Sozialstaat untergraben, der die Hilfsgelder verteilen muss. Neben dem Ausbau des Sicherheits-, Militär- und Polizeistaates übernimmt der Sozialstaat Polizeiaufgaben, denn Einkommen, Bankkonten, Geschäfte, Krankheit, Geburt, Gesundheit der einzelnen Bürger werden durch diesen Staat registriert und verwaltet. Die kleine Schicht der Millionäre und Milliardäre aus dem Sektor der Finanzspekulation wird allerdings von diesen Massnahmen ausgenommen.
13. Jugendarbeitslosigkeit: Nach Berechnungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat die aktuelle Krise fatale Auswirkungen auf die Sockel- und Jugendarbeislosigkeit. Die produktive Industrie, Wirtschaft und Verwaltung können in Europa die Masse der Arbeitslosen nicht mehr aufnehmen und beschäftigen. Selbst wenn die Konjunktur irgendwann wieder anspringen würde, wäre diese Massenarbeitslosigkeit nicht überwindbar. In Spanien etwa lag die strukturelle Arbeitslosigkeit Ende 2011 bei 12,6% der arbeitsfähigen Bevölkerung. Diese Arbeitslosen würden zu keinem Zeitpunkt mehr einen Arbeitsvertrag erhalten. Griechenlands „bereinigte“ Erwerbslosenrate wies die Ziffer von 12,8% auf. Vor allem die Südländer der EU gewannen für Investoren keinerlei Attraktivität. Sie errichteten die neuen Autofabriken oder Zuliefererfirmen in China, Indien oder in USA. Die miserable Schul- und Berufsausbildung, die schlechte Arbeitsmoral und die Kosten schreckten die Finanziers ab. Dadurch stieg die „Trendarbeitslosigkeit“ in Südeuropa noch weiter. Vor allem junge Menschen sind von dieser Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre Biographie wird kaum eine Beschäftigungskarriere aufweisen, falls sie nicht nach Nordeuropa auswandern. Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren ist in Europa fast jeder vierte ohne Arbeitsplatz, Die Arbeitslosigkeit erreicht in dieser Gruppe oder „Generation“ der Erwerbslosen über 25%. Eine wachsende Verwahrlosung der Jugend ist zu erwarten. Soziale Unruhen und Radikalismus finden in dieser hoffnungslosen Jugend ein Echo. Zwar sollen staatliche Massnahmen eine „Bildungspolitik“ ergänzen, die die Jugend bisher an die Universitäten, Schulen und Fachhochschulen versetzt hatte, ohne ihr gesellschaftlich notwendige Berufe oder Fachwissen zu vermitteln. Derartige Bildungsmassnahmen sind kaum finanzierbar, werden jedoch von der EU erweitert und auf die Unterschichtsjugend ausgedehnt, ohne zu wissen, welche Ziele diese „Beschäftigungstherapie“ verfolgt. Sie in die Armeen zu stecken, die Gesellschaften zu militarisieren, würde die Gewaltbereitschaft und die Kriegsgefahr erweitern. Den Zynismus der Politiker kann sich niemand vorstellen, die Jugenderwerbslosigkeit und die Massenarbeitslosigkeit über Kriege regeln zu wollen.
14. Die Neugeburt des nordamerikanischen Kontinents: Eine neue Lage auf dem Weltmarkt entstand, als sich herausstellte, dass in den USA riesige Erdöl- und Erdgaslager gefunden wurden. Die Preise für Energie mussten nicht ausschliesslich über die Sicherung der Weltrohstoffe gewährleistet werden. Das US – Finanzkapital verfügte über Rohstoffreserven, die für eine Reindustrialisierung Nordamerikas eingesetzt werden konnten. Die industrielle Infrastruktur wurde bisher durch den europäischen Maschinenbau, die Auto-, Chemie- und Pharmaindustrie gefährdet. In USA war ausserdem die Bildungskapazität der Facharbeiter, der Ingenieure und des mittleren Managements unterentwickelt. Neben der Spitzenforschung und neben den Spezialisten und Forschern in der Rüstungsindustrie fehlte der Unterbau einer grundlegenden Fach- und Berufsausbildung. Durch die billigen Energiepreise für Kohle, Diesel, Bezin und Elektrizität verlangten die Hilfs- und Massenarbeiter keine hohen Löhne, denn die Sozial-, Renten- und Gesundheitsabgaben waren gering. So kann passieren, dass der deutsche Maschinenbau, die Autoindustrie und die anderen produktiven Industriezweige in Nordamerika neue Betriebe aufbauen und die Gesellschaft bildungs- und berufsmässig „kultivieren“. Der Schaden, den die Finanzoperationen und Spekulationen in Nordamerika angerichtet hatten, wird plötzlich durch die nordeuropäischen Kulturleistungen relativiert und zurückgenommen. Es ist jedoch anzunehmen, dass das US – Kapital aus den alten Fehlern nichts lernen wird. Erneut wird das Prinzip des „Catch is catch can“ alle Aufbauleistungen zerfetzen. Ein „europäischer“ Reform- und Bildungsstaat wird nicht existieren.
15. Über den Okkultismus als Herrschaftsprinzip: Die Marx’sche Religionskritik und die konservative Feindanalyse stimmen in einzelnen Punkten überein. Für Marx stand in der Kritik am Christentum fest, dass der Geldfetisch, das Finanzgebaren, die Spekulation, die Gesinnungsethik des Geldgeschäfts alle Religionen erfassten, die wie die jüdischen, katholischen, protestantischen und islamischen Religionen von einem einzigen „Menschengott“ sprachen, der im Leben der Menschen und zugleich in der Geschäfts- und Arbeitsethik „verkörpert“ wurde. Nicht nur dass die Menschen in diesen Religionen sich als Menschheits- und Sozialprinzip selbst anbeteten, sie übertrugen nach Marx die Geldakkumulation und die Mühen der notwendigen Arbeit auf die Religion als Schuld und Verheissung. Dadurch verloren die religiösen Menschen das Bewusstsein von Freiheit und Gerechtigkeit. Sie leiteten die Freiheits- und Menschenrechte aus den frühen und entstehenden Kapitalismus ab. Ein „Geld- und Warenfetisch“ wurde nach Marx auf den Liberalismus und auf die unterschiedlichen Utopien und „politischen Religionen“ übertragen. Durch diese Übermacht der religiösen Mysterien im menschlichen Denken wurden die die nachfolgenden Ideologien als „politische Religionen“ einem wachsenden Irrationalismus ausgesetzt. Je technisch rationaler die Gesellschaft durch den modernen Kapitalismus gestaltet wurde, desto irrationaler wurde der Glauben bzw. die ideologische Weltsicht. Völkerhass, Rassismus, Astrologie, Weltuntergang, Wunderglauben und Mystik steigerten den irrationalen „Verstand“ in einer durchrationalisierten und technologisch vollkommenen „Gesellschaftsmaschine“. Dieser religiöse Okkultismus war deshalb nach Marx Mittel, die Aufklärungsphilosophie zu verfälschen und die soziale Angst und Entwurzelung zu politisieren. Die Herrschaft der wenigen Geldmagnaten und Mächtigen konnte nur gelingen, wenn die Klassen, Völker und Nationen jeden Gedanken an die eigene Stärke und Tradition verloren und sich in einem Kampf der Religionen und Kulturen verschleissen liessen. Marx sprach diese Religionskritik wiederholt als Form der „Entfremdung“ und der „reellen Subsumtion“ der Arbeitskräfte unter die Kapitalbedingungen von Markt, Geld, Lohn, Profit, Preis und Produktion an. Dem atheistischen Materialisten interessierten nicht die moralischen, ethischen und kulturellen Aufgaben der „Menschengottreligionen“, um so ewas zu garantieren wie „Gottvertrauen“, Moral und Verantwortungsethik. Die Religion gewann bei den Konservativen einen anderen Stellenwert. Die konservativen Kritiker des Liberalismus und der modernen Ideologien setzten eine Feindanalyse an den Anfang der Staats- und Demokratiekritik. Der Feind und Gegner der eigenen Kultur, der die Lebens- und Arbeitsbedingungen bedrohte oder sogar zerstörte, sollte analytisch bestimmt werden, um einen fatalen „Funktionalismus“ bzw. eine Rechtfertigung der kapitalistischen Produktion oder des Bankgeschäfts zu vermeiden. Katholizismus oder Protestantismus bezeichneten den Ausgangspunkt der Feindsicht. Der wachsende Irrationalismus, die Dekadenz, die Zerstörungswut, die „Fäulnis“ des Feindes sollte benannt werden, um sich der eigenen Kraft und Gesellschaftlichkeit zu vergewissern. Die christliche Religion bildete die Voraussetzung der Feindanalyse. Sie gab Grundwerte und Tradition. Diese Vorgehendweise lässt sich in der Philosophie von Martin Heidegger, in der Soziologie von Hans Freyer, in den Arbeiten von Ernst Jünger und in der Staatstheorie von Carl Schmitt aufspüren.
Skizzen einer „Raumrevolution“ in Europa
Die USA übertrugen nach dem II. Weltkrieg ihre Herrschaftsmethoden und die Prinzipien der Macht auf Westeuropa und Japan. Nach 1989 wurden Versuche gestartet, Osteuropa, Russland, die Türkei und sogar den Nahen Osten nach diesen Ordnungsfaktoren zu gestalten. Die USA betätigten sich in diesen Gesellschaften nicht offen als Kolonialmacht, Diktatur und Unterdrücker, obwohl der militärische Sieg und die Besetzung der genannten Länder erst die Garantie bot, die eigenen Interessen umzusetzen. Formal wurden die Freiheits- und Demokratierechte eingeführt und sogar Wirtschaftskonjunkturen angestossen, die dazu beitrugen, das Elend und die Folgen der Kriege und Diktatur zu überwinden. Die Werte und Formen einer instrumentalisierten „Demokratie“ wurden aus USA übersetzt und verbunden mit einem kapitalistischen Lebensstil, Medienkult und Konsumideologie. Die Vereinzelung und Zersplitterung aller sozialen Klassen, Schichten, Bürger und Interessen durch derartige Methoden sicherte den kleinen Gruppen in Wirtschaft und Staat die Macht. In den zwei, drei Grossparteien verwalteten und gestalteten ausgesuchte und überprüfte Eliten, Cliquen und Gruppen eine parlamentarische Demokratie, die den Widerspruch und die Konkurrenz der unterschiedlichen Demokratieformen nicht kannte. Die Wähler wurden zu den „Konsumenten“ und Zuschauern von Ereignissen, Debatten und politischen Szenen, ohne selbst entscheiden zu können. Eine „Einheitspartei“ inszenierte Demokratie als Spektakel.
Westdeutschland gewann ab Mitte der fünfziger Jahre über den Marshall – Plan durch eine „Wohlstandsgesellschaft“ sogar nachträglich gegenüber einzelnen West- und Oststaaten den II. Weltkrieg. Ohne die Unterstützung der USA wäre die Wiedervereinigung der zwei Deutschlands nach 1989 unmöglich gewesen. Umgekehrt half das geeinte Deutschland den USA, in Osteuropa, in Asien und Nordafrika Einflüsse zu gewinnen, um die Rohstoff- und Absatzmärkte zu sichern. Die enge Kooperation der deutschen und nordamerikanischen Wirtschaft war Ausdruck der Präsenz und der direkten Eingriffe der USA. Umgekehrt profitierten die deutschen Märkte von der Dynamik und der Politik Nordamerikas. Allerdings vermieden die deutschen Regierungen, sich in die Interventionskriege dieser Grossmacht hineinziehen zu lassen. Weder in Korea, in Vietnam, im Irak, in Syrien kämpften deutsche Truppen oder Legionäre. Der Krieg in Afghanistan dokumentierte eine ersten „Waffenbrüderschaft“ und es ist zu vermuten, dass ein Angriff auf den Iran eine deutsche, militärische Teilhabe verzeichnen würde. Die Bundesrepublik stabilisierte im Sinne der USA Westeuropa und erleichterte den Zusammenbruch des „Kriegskommunismus“ in Osteuropa. Trotzdem wiesen beide Mächte eine eigene und andere Tradition von Wirtschaft und Politik auf. In der Gegenwart scheint die zerstörerische Kraft des Finanzkapitals dieses „Bündnis“ und die Stabilität der gemeinsamen Ziele zu untergraben.
Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, setzte auf eine enge Zusammenarbeit mit den USA, um einen neuen, deutschen Teilstaat aus den Resten bzw. Trümmern der NS – Diktatur und der preussischen Tradition zu begründen. Ihm war zugleich wichtig, die westdeutsche Wirtschaft technologisch zu erneuern und über eine Wirtschaftskonjunktur, die „Eingliederung“ der vielen Flüchtlinge, Ausgebombten und „Heimkehrer“ zu gewährleisten. Aus dem Schutt der NSdAP zwei Grossparteien zu errichten und zu zwei politischen, fast „identischen“ Lagern zu fügen, ohne der NS – Ideologie einen Auftrieb zu geben, konnte ohne die USA nicht gelingen. Diese Grossmacht verzichtete auf eine „antifaschistische Neuordnung“, die in Potsdam zwischen der UdSSR und den Westalliierten ausgehandelt wurde und stützte sich auf deutsche Kämpfer und „Partisanen“ aus den Wehrmachtverbänden, der GESTAPO und der SS, um einen russischen Angriff abwehren zu können. Präsident Harry Truman und sein Geheimdienstchef Allan Dulles waren überzeugt, dass die russische Gegenmacht die revolutionären Unruhen in China, Indien, Persien, Griechenland, Westeuropa und Afrika ausnutzen würde, um mit den kampferprobten Panzerverbänden bis zum Atlantik vorzustossen. Die deutschen Kämpfer sollten einen Partisanenkrieg eröffnen und die Rote Armee aufhalten, bis die nordamerikanischen Bomberverbände den Vormarsch zusammemschiessen würden. Eine Geheimarmee, Gladio, von ein paar zehntausend Mann, wurde mit amerikanischen Waffen und Offizieren ausgerüstet. Die USA als Siegermacht schienen mit dem Anspruch der Freiheits- und Menschenrechte die Anschauungen eines „Führerstaates“ und die Utopien der kommunistischen Ideologie endgültig zu widerlegen und durch den materiellen Realismus einer Konsumgesellschaft, des Wohlstands und der wehrhaften Demokratie zu begründen. Endlich „kämpfte“ das westliche Restdeutschland auf der richtigen Seite.
Im Sog dieser geheimen Militarisierung des entstehenden „Kalten Krieges“ entdeckte der ersten Bundeskanzler der deutschen Westrepublik die Chance, aus den unverbrauchten „Resten“ des deutschen Volkes und aus den produktiven Beständen von Wirtschaftsfachleuten, Managern, Militär und Sicherheitsdiensten einen neuen Staat aufzubauen. Die katholische Bourgeoisie des Rheinlandes, Schwabens und Bayerns sollte das soziale Fundament des neuen Staates abgeben. Die katholische und christliche Arbeiterbewegung, alles tapfere Soldaten und Facharbeiter, sollten die bürgerlichen Ansprüche ergänzen und zu einer Bündnis- und Volkspartei vereinen. Der Antipreusse Adenauer nahm die Reform- und Bündnispolitik des preussischen Staates auf, internationalisierte sie jedoch durch den europäischen Katholizismus, der die Grundlagen des europäischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus pragmatisch und ideologisch überwinden sollte. Ihm war zugleich wichtig, den Staat Israel anzuerkennen und eine Politik der Wiedergutmachung an den Juden einzuleiten, um zu vermeiden, dass die zionistischen Kreise in Israel, Europa oder USA Front bezogen gegen den westdeutschen Teilstaat. Der neue Bundesstaat und die Kanzlerdemokratie waren auf die Unterstützung der USA angewiesen, um das Experiment der Neugründung mit den alten, belasteten Beamten und Funktionären zu starten und die politischen Wurzeln einer „Volkspartei“, der CDU/CSU zu stabilisieren, die gerade nicht eine Fluchtburg der Parteigenossen der NSdAP werden sollte. Dieses doppelte Experiment einer Staatsgründung und der Formierung einer Parteiendemokratie gelang, weil der Kanzler Adenauer den Auflagen des Besatzungsstatutes, der „Kanzlerakte“ und der Verträge mit den USA genügte. Er spielte den „Kanzler der Alliierten“, wie Kurt Schumacher höhnte, und erschuf aus den Trümmern der deutschen Kriegswirtschaft und des totalen Staates eine neue Ordnung und Ökonomie. Diese Politik folgte den Direktiven und Vorbehalten der USA und besass trotzdem eine deutsche Tradition. Die Bündnis- und Reformpolitik, die Verbindung von Sozial- und Sicherheitsstaat, die staatliche Konjunkturpolitik, das weitgefächerte Bildungsprogramm, der wachsende Wohlstand, die Einrichtung einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, der soziale Aufstieg eines geschundenen Volkes nahmen die Tradionen Preussens und der „deutschen Reiche“ seit 1871 auf.
Die Bundesrepublik überrundete sehr schnell Frankreich und England. Es mussten keine Koloialkriege geführt werden. Ausserdem musste kein „Kolonialreich“ finanziert werden. Es war nicht nötig, die vielen Wirtschaftsflüchtlinge aus Nordafrika und dem „Empire“ aufzunehmen. Die Bundesrepublik verfügte über das Fachwissen und den Aufbauwillen eines Restvolkes, das die Wirtschaftsräume Ostdeutschlands und Osteuropas aufgeben musste. In Westeuropa behinderten die Kolonien ein „Neubeginnen“. Stattdessen siedelte Nordafrika in Südfrankreich und Kalkutta breitete sich in London und Manchester aus. Die Kolonialkriege erreichten die „Mutterländer“ und destabilisierten Wirtschaft und Politik. England und Frankreich verloren nachträglich den II. Weltkrieg und waren auf die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik angewiesen, um selbst ein labiles Gleichgewicht zu halten. General De Gaulle bewunderte deshalb den Kanzler Adenauer und wollte die westdeutsche Politik aufnehmen und erweitern in ein Europa der „Vaterländer“. Nach diesem Muster sollte eine „Europäische Union“ errichtet werden. Die Bundesrepublik wurde zum wirtschaftlichen und kulturellen „Drehpunkt“ des neuen Europas erklärt. Eine derartige „Integration“ lag durchaus im Interesse des nordamerikanischen Finanzkapitals. Vorerst musste deshalb eine neue Ostpolitik eingeleitet werden, um Russland und Osteuropa zu destabilisieren.
Die beiden Deutschlands, die Bundesrepublik und die DDR, wurden in den Plänen der NATO und des Warschauer Paktes als Regionen des Krieges, des Aufmarsches und des Einsatzes von Raketen gesehen. Diese beiden Deutschlands wären in eine Mondwüste bei Ausbruch des modernen und totalen Krieges verwandelt worden. Die westdeutschen Kanzler und die Staatsratsvorsitzenden der DDR wussten, welchem Zwang und welcher Verantwortung sie ausgesetzt wurden. Die USA beobachteten misstrauisch die Angebote Stalins an den Kanzler Adenauer, die deutsche Einheit und einen Friedensplan zu riskieren. Er lehnte ab, denn die USA hielten die Bundeswehr, den Bundesnachrichtendienst und die Regierung unter Kontrolle. Die Nato- und die Wirtschaftsverträge nahmen neben dem Besatzungsrecht und den Stationierungsauflagen der Bundesrepublik die Souveränität. Adnauer verhandelte mit Nikita S. Chrustchew Mitte der fünfziger Jahre über die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen. Erste Handelsverträge wurden geschlossen. Ludwig Erhardt weigerte sich, die Kriegspolitik der USA in Vietnam und im Nahen Osten in den sechziger Jahren zu unterstützen. Die Studentenrevolte war ihm willkommerner Anlass, vor einem Kriegseinsatz deutscher Soldaten im Ausland zu warnen. Die Regierungen unter den Kanzlerschaften von Georg Kiesinger und Willy Brandt setzten die Adenauerpolitik fort, denn die Sozialdemokratie hatte die „List der Vernunft“ des alten Kanzlers übernommen und sie war wie die CDU daran interessiert nach 1961, nach dem Mauerbau in Berlin, die Kriegsfronten im Osten durch einen Reform- und Gullaschkommunismus aufzuweichen. Die Verwestlichung der Oststaaten und der DDR lag durchaus im Interesse der USA und im Kalkül der finanzkapitalistischen „Doppelmacht“.
Erst 1989, beim Zusammensturz des Kriegskommunismus, traten Widersprüche auf. Kanzler Helmut Kohl wurde von der US – Regierung und vom Finanzkapital auf die Chancen der „deutschen Einheit“ aufmerksam gemacht. Es wurde wichtig, die Generalität und das Offizierkorps der „Volksarmee“ und der „Sovetskaja Armija“ abzufinden und ihnen den Verteidigungswillen zu nehmen. Noch wichtiger wurde es, dem Geheimdienst, KGB, MfS und HVA, neue Aufgaben in der Wirtschaft zu übertragen, ohne eine „revolutionäre Rachejustiz“ einzuleiten. Nicht vergessen werden durfte, die Parteiführung von SED und KPdSU zu schonen und ihre Legalisierung in einer neuen Republik zu gewährleisten. Die Formel der „friedlichen Revolution“ im Osten umschrieb die Manöver, den alten Führungskadern aus Politik, Militär und Sicherheit im Osten Straffreiheit zu gewähren und sie unterzubringen im Sozialstaat und in der Wirtschaft. Voraussetzung dafür war, die entstehende „soziale Revolution“ aufzuhalten und stattdessen die Ordnung der alten Bundesrepublik als Rechtsstaat und als Parteiendemokratie in den Osten zu überführen. Gelang diese „Transformation“ der BRD in die DDR, konnte sie in Osteuropa und in Russland als Programm der „Demokratisierung“ wiederholt werden. Diese Vereinigung der beiden Deutschlands und der beiden Europas kostete mehrere hundert Milliarden DM. Weitgehend die deutsche Wirtschaft brachte diesen Betrag auf und wurde belohnt mit neuen Absatzmärkten, Immobilien und billigen Industrieinvestitionen. Als Verhandlungsführer dieser komplizierten „Übertragung“ wirkte im Auftrag von Helmut Kohl der Staatssekretär Schäubele, heute Finanzminister und Geburtshelfer eines europäischen Einheitsstaates.
Irgendwann nach 1990 entstanden Gegensätze in den politischen Perspektiven des europäischen Kontinents gegenüber der Weltmacht USA. Als finanzkapitalistische und politische Doppelmacht waren die USA an der Zerschlagung Russlands als Grosstaat, Imperium, Kultur, Rohstoffreserve, Industriegigant und asiatische Gegenmacht interessiert. Russland sollte in viele Kleinstaaten zerlegt werden. Die wichtigen Rohstoffregionen sollten durch nordamerikanische Konzerne besetzt werden. Die ehemaligen, russischen Sateliten sollten durch nordamerikanische Stützpunkte und Finanzhilfen unter die Hegemonie der USA gestellt werden. Vor allem Deutschland musste dagegen am russischen Teilmarkt interessiert sein. Wie nach 1871 waren deutsche Investitionen und industrielle Aufbauhilfen gefragt, um den alten morbiden Planstaat, den Sicherheits- und Militärapparat zu überwinden. Die Kombination von Staatskapitalismus, kapitalistischer Grosswirtschaft und Handel, von Mittelstand- und Sozialspolitik und der Einführung einer weitgefächerten Berufsbildung boten Alternativen zum „Kriegskommunismus“, aber auch zur Negativkraft des Finanzkapitalismus, dessen Zerstörungswut in USA und Südeuropa zur Deindustrialisierung, zur Massenarmut, Arbeitslosigkeit und zur Prassucht der Superreichen verleitet hatte. Die „Negation“ der Aufbauarbeit oder das Fehlen einer „neuen Schaffenskraft“, aus den Trümmern neue Initiativen, Technologien und produktive Ansätze zu „zaubern“, wiesen auf eine tiefe Krise der finanzkapitalistischen Spekulation. Der Verlust an Möglichkeiten oder die Realität einer „negativen Aufhebung“ des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage belegten den Einbruch aller Potenzen. Eroberungskriege wiesen auf einen letzten Ausweg. Selbst die neuen Rohstoff- und Erdölfunde in den USA und die Hineinnahme der europäischen und deutschen Bildungs- und Wirtschaftskraft zum Neuanfang einer Industrieproduktion demonstrierten den grundlegenden Widerspruch, dass der US – Staat die Zerstörungswut des Finanzkapitals nicht länger zügeln konnte. Oder war zu erwarten, das die lateinamerikanischen und afrikanischen Völker in USA das „Steuer“ herumrissen und einen neuen Reform- und Gesundheitsstaat schufen und der finanzkapitalistischen Spekulation Aufsicht und Regulation aufzwangen? Der europäische Kontinent und hier Deutschland und Russland würden aus der kombinierten staats- und privatkapitalistischen Wirtschaft und vor allem aus einer „Revolution von oben“ neue Anfänge hervorbringen.
Diese Alternativen sind öffentlich kaum diskutierbar, weil die Medien, die Parteien und die Politik, die „Negativkräfte“ der fianzkapitalistischen Spekulation in Südeuropa, in Griechenland und USA nicht erörtern und darstellen. Darüber darf nicht gesprochen werden. Die Überwindung oder „Abschaffung“ der Arbeiterbewegung in Deutschland hat alle Konflikte und gegensätzliche Interessen eingeebnet. Die Forschungsinstitute der Parteien und Universitäten sind angewiesen, über den „Negativfaktor“ Finanzkapital keinerlei grundlegende Analysen zu erheben. Die Medien hüllen sich in „Schweigen“ oder in vagen Andeutungen. Es bleibt trotzdem erstaunlich, dass die Hintergründe der aktuellen Krise nicht benannt werden dürfen. Das mag an der Doppel- bzw. Parallelmacht des Finanzkapitals liegen, das über „Logen“, Geheimbünde, Absprachen, Verschwörungen Staat und Wirtschaft durchziehen und die Medien beherrschen. Die devoten Eliten in Parteien und Staat wagen es nicht, aufzubegehren, um ihren Lebensstandard und ihre Position nicht in Frage zu stellen. „Verschwörungen“ bringen letztlich keinerlei Lösung. Sie verstärken ein Chaos durch Entscheidungslosigkeit der Eliten oder durch eine „Paralyse“, die die gesamte Gesellschaft erfasst. Schon deshalb werden Ereignisse auftreten, die wie ein Befreiungsschlag wirken werden.
Mit der nordamerikanischen Doppelmacht des Finanzkapitals ist nicht etwa eine „jüdische Plutokratie“ oder eine „jüdische Weltherrschaft“ gemeint. Diese Form des Kapitalismus lässt sich nicht auf eine Ethnie festschreiben. Die antisemitische Polemik eines Joseph Goebbels diente dem Weltmachtanspruch der NS – Diktatur und entbehrte jeder wissenschaftlichen Grundlage. Dass es auch jüdische Banker und Spekulanten gibt, verleiht diesem Kapital nicht ein irgendwie „jüdisches Wesen“. Der Finanzkapitalismus folgt einer geldspezifischen und finanzpolitischen Logik, die sich aus der „Struktur“ des Geldes, der Spekulation, der Aktie, des Fonds, der Börse, des Handels usw. ergibt. Selbst der Existenzkampf des israelischen Staates hat mit den finanzkapitalistischen Operationen wenig zu tun. Allerdings liegt er in einer Region, deren Bodenschätze für die Spekulation interessant sind. Kurzschlüsse in die skizzierte Richtung zu vollziehen, lässt sich aus den anwachsenden okkultischen Strömungen im modernen Kapitalismus erklären, einen „Schuldigen“ oder das „Böse“ schlechthin zu finden.
00:08 Publié dans Actualité, Economie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, bernd rabehl, allemagne, théorie politique, politologie, sciences politiques, capitalisme, globalisation, mondialisation, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Opérationnalité de l’inconnaissance

Opérationnalité de l’inconnaissance
Ex: http://www.dedefensa.org/
20 février 2013 – Il s’agit ici d’une réflexion que nous avons à l’esprit, et presque sous la plume, depuis plusieurs semaines. (Cet article, référencé pour nous au 6 février pour le début du travail, indiquant la date où l’idée a commencé à en être “opérationnalisée”, est en gestation depuis au moins ce laps de temps, notamment comme le montre l’extension dans le temps des références que nous donnons.) Nous voulons dire par cette introduction presque “technique” qu’il s’agit d’une tendance très forte et profonde de notre jugement, qui peut et doit influer sur notre travail, donc sur le contenu de ce site. “Cette introduction presque ‘technique’” implique également, dans son chef, une forme d’“avertissement” dans le sens littéraire élargi à notre propos : une “courte préface” qui est aussi un “appel à l’attention”.
Au départ de cette réflexion, il y a, très simplement, les événements eux-mêmes, sans classification nécessaire, du type “intérieur” ou “extérieur”, politique ou sociaux, etc., mais bien le rythme et l’évidente incohérence des ces événements. Cette situation, qui nous paraît chaque jour de plus en plus évidente et que nous ne manquons pas de souligner avec nos commentaires lorsque nous commentons (voir, le plus récemment, le F&C du 8 février 2013), nous conduit à deux remarques. Il nous semble que ces deux remarques ne surprendront pas nos lecteurs parce qu’elles se trouvent également au cœur de nos commentaires, sous-jacentes ou exprimées précisément.
• La première de ces remarques concerne le crédit que l’on peut accorder aux réseaux de l’information-Système. (Ces réseaux font partie de ce que nous nommons le système de la communication, sur lequel nous avons récemment encore fait un commentaire spécifique [le 14 décembre 2012], où nous mettions en évidence le caractère dual, ou type “Janus” de ce système de l’information.). Il s’agit de l’information dispensée par ce que nous nommons la presse-Système, mais aussi de l’information-Système dispensée par les déclarations officielles et les divers commentaires venus des champs divers des élites-Système, qu’elles soient de membres des directions politiques nécessairement inféodées au Système, de bureaucraties, d’observateurs également dans cette position. Non seulement ce crédit est nul, comme nous l’estimons depuis longtemps, – depuis une décennie au moins (voir aussi bien le 10 septembre 1999 que le 13 mars 2003), – mais il tend de plus en plus à être tout simplement négatif. (Et “négatif”, non dans le sens de la tromperie, de la manipulation, ce qui a un côté instructif répétons-le, mais dans le sens de la bassesse pure, de l’infécondité, de la stérilité. La presse-Système, comme tout ce qui est “-Système” dans notre langage, tend vers l’ossification et la néantisation, suivant en cela le Système et sa marche vers l’autodestructions par dissolution avant l’entropisation.)
Les exemples à cet égard abondent, de l’étalage de cette littérature qui devient presque contre-productive pour son propre parti, à la dénonciation qui en est faite avec une facilité déconcertante, – enclenchant ainsi cet effet négatif dont nous parlons. Voyez comme exemple ce 1er février 2013, ce texte dont le titre dit tout à cet égard («Shocking Numbers That Show The Media Is Lying To You About Unemployment In America») ; des textes de cette sorte pullulent littéralement sur l’Internet. (Encore faudrait-il, dans ce titre, enlever le mot “shocking”, car cette sorte d’évolution dans la négation absolue de la situation du monde n’a plus aujourd’hui rien de “choquant” pour l’esprit averti. On dirait même, tout au contraire, qu’il a valeur de confirmation, qu’il a donc un aspect indiscutable, et nullement inintéressant, de confirmation de son inexistence en tant qu’être : l’information-Système, qui nous accable de sa masse, n’est pas littéralement, – inexistence complète.)
Les enquêtes régulièrement faites à cet égard contribuent largement à alimenter notre jugement général, sans surprise ni brio d’ailleurs. On pourrait se référer notamment, comme à un récent exemple en date, à une enquête IPSOS dont les résultats ont été publiés dans Le Monde du 25 Janvier 2013. Plutôt que se référer à cette feuille-Système, on peut aussi bien lire le compte-rendu qu’en fait l’OJIM, le 29 janvier 2013. L’enquête montre une hostilité généralisée des Français au Système dans tous ses aspects, et notamment à l’information-Système et à la presse-Système… Vraiment aucune surprise.
«Cette hostilité vis-à-vis des élites touche également les médias. 72% des sondés estiment en effet que les journalistes sont “coupés des réalités et ne parlent pas des vrais problèmes des Français”, 73% pensent qu’ils ne sont pas indépendants et “ont tendance à céder aux pressions du pouvoir politique” (les électeurs du Front national et du Front de gauche étant les plus nombreux dans cette catégorie) et 58% considèrent qu’ils font mal leur travail…
»L’écart entre le discours répété en boucle par les hommes politiques, journalistes, experts, etc… et l’attente des Français est devenu proprement sidérant. Il s’agit d’un véritable déni de réalité de la part des élites qui ont fait sécession d’avec le reste du pays…»
Devant ces faits, qui sont avérés à force d’être devinés intuitivement et d’être régulièrement vérifiés, que répond l’intelligence-Système ? (Nous employons cette expression “intelligence-Système”, pour éviter absolument d’employer des mots tentants tels que “débiles”, “connards”, “salopards”, “cyniques” et ainsi de suite ; ces termes grossiers se qualifient et se disqualifient eux-mêmes, trop courts et trop brutaux pour avoir un sens intéressant, cela qui désigne le sapiens dont l’intelligence est affaiblie, déformée, faussaire par ses fréquentations et ses orientations, – bref, l’intelligence amenée près du Mal, comme l’observe Plotin, mais qui n’est évidemment pas la Mal elle-même : «Mais les autres, ceux qui participeraient de lui et s’y assimileraient, deviennent mauvais, n’étant pas mauvais en soi.”»)… L’intelligence-Système, donc, répond qu’elle est victime, et elle geint… Exemple : «Pour le journaliste Gérard Courtois qui l’analyse dans Le Monde, ces craintes et cette hostilité [les «72% des sondés estiment en effet que les journalistes sont “coupés des réalités et ne parlent pas des vrais problèmes des Français”»] ne sont que fantasme, “résultat du travail d’incendiaires” de “ceux qui attisent ces peurs”…»
Un autre cas dans ce sens, dans un autre registre encore plus exotique et grotesque, que nous voulons signaler, nous est fourni par l’actualité, et postérieur à l’entame de ce commentaire, comme s’il apportait un point d’orgue à ce que nous voulons signifier dans ce passage qui concerne le crédit de l’information dans sa branche Système. Il s’agit du Bloc-Notes de ce même jour de publication de notre texte, ce 20 février 2013, commentant une chronique de Glenn Greenwald sur l’état d’esprit de la chaîne de télévision MSNBC. Le climat de dévotion religieuse qui prévaut à Ciel ouvert lorsqu’il s’agit du président-Saint Barack Obama donne une mesure grave de la valeur qu’il importe d’accorder à l’information, ici semi-officieuse, semi-officielle, semi-Vatican. Certes, il s’agit d’un bon sujet d’étude pour un étudiant en anthropologie venu d’une civilisation évidemment développée sur une planète assez lointaine, pour enrichir sa thèse sur le cas de l’hypomanie de sacralisation des élites-Système, sur la planète-Terre. Sur le cas de la vertu d’information de la réalité en tant que sas d’accès vers une compréhension de la situation de la vérité du monde, on doit donc cultiver une réserve qui confine souvent à la dérision, ou à l’occasion d’un sarcasme saluant leur comportement pathétique, – bref, passons outre, mais gardant la leçon à l’esprit, de cette poussière de sapiens plongée dans son activité de termite du sacré...
• La seconde remarque concerne notre propre attitude, qui est d’observer que ce n’est pas parce que tout ce que dit le Système peut être pris nécessairement comme faussaire (avec parfois une façon intéressante d’utiliser le sens imprimé à cet aspect faussaire) que nous puissions savoir, par simple déduction antinomique, la réalité des choses. Au contraire, même : le seul contrepied de l’information-Système faussaire peut en général conduire, à notre sens, à une interprétation qui est le plus souvent, et même dans l’écrasante majorité des cas, elle-même fausse et donc faussaire. Il nous paraît d’ailleurs évident, comme une règle de logique implacable, qu’on ne peut extraire de la quasi-exclusive fréquentation de ce qui est néantisation par comportement faussaire, quelque chose qui contienne en soi une part, ou même une parcelle, même infime, de vérité ; on ne peut extraire quelque essence que ce soit sous forme d'“une part de vérité” de ce qui est dissolution proche de l'entropisation. (Nous ne disons certainement pas “une part de réalité” car il faut admettre explicitement que l’existence de cette néantisation de l’esprit est en soi une réalité fondamentale, à ce point qu’elle détermine pour une part essentielle cette réflexion. On observera que nous insistons de façon très affirmée sur la différenciation nécessaire à faire entre “réalité” et vérité, jusqu’à une différence de nature interdisant toute proximité. On verra cela, plus en détails, plus loin.)
L’explication de cette particularité grandissante, de notre point de vue, de l’impossibilité de demeurer dans une logique binaire réduite à deux “acteurs” entre le Système et ceux qui s’opposent à lui selon la seule dénonciation de ce que produit le Système, notamment en fait d’information, – notre explication “opérationnelle”, par conséquent, tient en ceci :
• Si ces deux “acteurs” eux-mêmes tiennent des positions différentes voire antagonistes, il reste qu’ils se trouvent exclusivement dans l’un ou l’autre “camp” selon les circonstances. Par conséquent, ils ne sortent pas du cadre du Système, puisque les deux camps sont définis exclusivement selon leurs positions par rapport au Système. (Pour ceux qui s’opposent au Système en répliquant aux seules interventions du Système, ils ressortent d’une certaine façon du phénomène de ce que nous nommons “antiSystème”, sans pour cela illustrer, et de beaucoup, la seule signification de l’antiSystème qui est beaucoup plus vaste et qui comprend des domaines réellement hors de Système. Il s’agit du cas où l’on voit des personnes, des groupes, des institutions, etc., évoluer dans des positions différentes selon au moins les circonstances, se retrouvant parfois en position antiSystème, même pour ceux qui font partie du Système.)
• Il n’y a pas que deux “acteurs”, le Système et ses adversaires, les méchant et les gentils, les 1% et les 99%, etc… On peut et on doit, pour élargir et enrichir le champ de la pensée, avancer l’hypothèse qu’il existe des forces collectives, des forces de pression constituées aussi bien à l’occasion d’événements humains que rassemblées selon les normes et la puissance de courants se situant hors du contrôle humain. (Champ de la métahistoire.) Nous parlons si souvent du Système en tant que tel qu’on doit bien comprendre, en plus des textes directs à cet égard, que notre religion, – oups, lapsus…, – est faite à ce propos. Cette remarque vaut également pour le sapiens lui-même, celui qui comprend et accepte cette situation, qui doit parvenir à trouver une position antiSystème d’un autre type que celui signalé plus haut, c’est-à-dire absolument hors du Système, – et l’inconnaissance en est l’exemple typique, et même archétypique pour le sapiens.
Ceci, qui concerne les deux constats, est certes le point le plus important : le désordre est si considérables, les lignes de force et les références si imprécises, que des circonstances essentielles échappant complètement à la raison et à la perception qui sert à la raison ; ces circonstances sont finalement quasiment invisibles à nos regards, insaisissables pour nos perceptions, ou bien elles le sont si fortement en vérité qu’elles peuvent révéler pour qui se tient hors du Système la vérité du monde, qui est pure invisibilité et insaisissabilité des choses pour la perception intra-Système. Ce qui nous est apparent et objectivement saisissable, nécessairement dans le cadre du Système, nous restitue un bouleversement de désordre, d’incertitude, d’hésitations, de velléités et de contradictions, à la fois tourbillon fou et situation figée d’impuissance… Si l’on veut un exemple “opérationnel” : après deux ans de désordre en Syrie et surtout autour de la Syrie (de la part des pays du bloc BAO), une analyse de Samer Araabi (IPS.News et Antiwar.com, le 15 février 2013) nous révèle involontairement l’état de désordre complet de la politique US, donc sa situation de complète incohérence… On y voit chacun des acteurs principaux de l’administration Obama de ces deux dernières années dire le contraire les uns des autres, et chacun pensant peut-être, sans doute, dans le secret de lui-même le contraire de ce qu'il dit, et cela étant conclu par une affirmation de l’un d’entre eux que “toutes les options sont sur la table”, – signifiant par là que tout est possible et que, par conséquent, rien n’est vraiment fait sinon dans tous les sens, que nul ne sait ce qui est vraiment fait et ce qui sera vraiment fait… (Et d’ailleurs, nul ne sait si l’expression “vraiment fait” a encore quelque signification, après tout, – car le “rien du tout n’a été fait” du point de vue d’une politique effective définit certainement le mieux l’option choisie par défaut.)
«The recent statements by Clinton and Panetta [ openly called for a more militant role], therefore, still reveal little about the actual relationship between the White House and the Syrian rebels. President Obama openly criticises the idea of armed assistance but has been silently supporting the rebels, while his administration’s liberal interventionists who have openly called for a more militant role have also expressed grave reservations about the ideology and direction of the very people they hope to arm. These varied opinions and perspectives leave the door open for any number of policies toward Syria. “No one has taken any option off the table in any conversation in which I’ve been involved,” said [JCS President, General] Dempsey…»
Il n’est pas dans notre intention de dire que cette analyse est mauvaise et sans intérêt, parce qu’elle est existe et qu’elle a quelque intérêt sans aucun doute, du point de vue de l’observation comme en laboratoire à partir de la position d’inconnaissance… Mais elle ne nous dit rien sur la situation en Syrie et elle nous dit que connaître la “réalité” de la situation en Syrie n’a en vérité aucun intérêt pour comprendre la situation du monde. Finalement, même quand nous allons au cœur du monde officiel, lorsque nous prenons les positions officielles et les confrontons aux positions réelles, voire secrètes, qui les contredisent, donc ayant fait objectivement un travail de déconstruction antiSystème, nous n’aboutissons nulle part sinon au nième constat du désordre.
L’inconnaissance et la vérité du monde
Nous travaillons depuis longtemps autour de ce thème, nos lecteurs le savent. D’une part, la profusion extraordinaire de l’information, mais aussi, et nécessairement, sa fluidité et son insaisissabilité… Plus nous savons, moins nous comprenons. D’autre part, la nécessité de rompre, de refuser certaines connaissances, y compris la connaissance du “réel”, – bref, l’inconnaissance. Récemment, nous avons publié deux textes qui avancent notre propos dans le sens, non plus de l’inconnaissance qui est maintenant un principe acquis pour nous, mais dans le sens de l’“opérationnalité de l’inconnaissance”, c’est-à-dire la mise en œuvre de l’inconnaissance dans notre travail d’information, – ce qui semblerait à première vue et apparemment, une contradiction : mise en œuvre d’une “doctrine” du refus de “tout savoir” pour faire “mieux savoir”. Mais l’on sait bien que cette apparente contradiction n’en est pas une, qu’elle est au contraire une doctrine pour déjouer les tendances irrépressibles du Système dans sa propre manipulation inconsciente du système de la communication. Le système de la communication étant malléable dans tous les sens, y compris un sens antiSystème fondamental et hors-Système, notre tâche à cet égard est évidente.
Revenons à nos deux textes récemment publiés, pour en rappeler la substance. Le premier est du 8 février 2013, sous forme d’un F&C qui se donnait pour but d’exposer ce qui nous paraît essentiel aujourd’hui, – travailler dans le sens de faire réaliser la crise et le dire («savoir la crise et dire la crise»), au nom de l’affirmation que la crise d’effondrement se déroule aujourd’hui, sous nos yeux, sous nos pieds, – donc que l’essentiel est bien une révolution psychologique qu’il faut favoriser.
«…Notre hypothèse n’est donc pas de dire “une catastrophe va arriver” mais bien que nous allons devoir admettre que la “catastrophe” (la crise générale de l’effondrement) est en cours et qu'elle est quasiment en nous, que nous la vivons littéralement “semaine après semaine, jour après jour”. Notre hypothèse est bien que l’effondrement est en cours sous la forme de la crise générale de l’impuissance des directions politiques et de toute politique en général, avec le désordre qui s’ensuit, et que le seul événement rupturiel qui puisse donner corps à cette crise est l’acceptation par la psychologie de sa réalité, de sa puissance, de son inéluctabilité, sous une forme telle que se crée un courant collectif, lui-même psychologique certes, dans ce sens de l’acceptation collective de la chose. […]
»Il s’agit donc de savoir la crise puis de dire la crise pour ouvrir les psychologies à la réalité. Il y a, selon nous, la probabilité quasiment inéluctable qu’un tel événement constituerait un bouleversement tel pour la conscience et pour l’esprit, que se créeraient nécessairement des conditions absolument nouvelles, qui donneraient effectivement toute sa dimension à la crise en mettant en place les conditions psychologiques non seulement pour accepter, mais pour susciter les changements que cela implique. Il s’agit donc d’une libération du Système, d’une révolte psychologique inconsciente contre le Système en voie d’autodestruction par ceux-là même qui, jusqu’ici, en acceptent la loi et la servitude...»
Dans le second texte, du 13 février 2013, nous citions deux textes venus d’horizons différents, qui pouvaient sembler par rapport aux normes du genre journalistique ou analytique, farfelus, hasardeux, insubstantivés y compris par des précisions de type antiSystème (“complotiste” éventuellement), etc. Nous n’en faisions nullement la promotion ni n’en affirmions en quelque façon que ce soit la justesse, ni quelque jugement de cette sorte, ni sur la forme ni sur le fond, – tout cela, d’aucun intérêt pour nous en vérité… Simplement, nous offrions des constats et posions des questions, – dont les réponses, bien entendu, sont pour nous évidentes…
«[…N]ous voulons prendre ces deux texte pour du comptant et ainsi apprécier combien il devient de plus en plus difficile,sinon impossible, de faire un commentaire de quelque intérêt sans utiliser des références qui dépassent largement les lignes habituelles du commentaire politique. Le fait est qu’après tout, en lisant ces deux textes, on en vient à la conclusion qu’ils ne sont pas plus stupides, pas plus incroyables, que les commentaires que nous sert la presse-Système sur le désordre formidable du monde courant en nous le présentant comme complètement ordonné, et qu’ils sont, d’un certain point de vue de plus en plus insistant, plus intéressants et éventuellement plus stimulants. Une fois écartées les réserves du conformisme et de l’alignement-Système des raisons subverties si inclinées par leur subversion à accepter ce rangement inepte du monde en cours, ces deux textes sont évidemment plus intéressants et plus stimulants que les productions écrasantes de monotonie et surréalistes de fausse raison et de raison subvertie, de la presse-Système.»
Au-delà, et sautant quelques paragraphes, nous en venions à cette conclusion qui concerne plus une méthodologie de l’“information” (ce terme a-t-il encore sa place ?) ; et, cette fois, nous ajoutons un souligné d’une partie du texte en gras, qui n’est pas dans l’original, nous en sommes sûr sans que l’auteur ne s’en offusque… : « Cette évolution de la perception, puis de l’analyse et de l’interprétation des événements, constitue un problème fondamental pour bien apprécier l’évolution du Système. Mais surtout, elle répond à une nécessité, qui est justement l’évolution du Système, et aussi l’évolution de la situation générale, – évolution du Système et évolution des forces antiSystème qui se manifestent indépendamment de l’organisation humane. Il s’agit d’un défi considérable à relever, si l’on entend poursuivre la démarche générale de tenter d’appréhender la véritable signification de l’évolution de la situation du monde. Dans ce cas, – cette tentative de relever le défi, – il s’agit d’un énorme effort d’adaptation, à la fois des commentateurs, à la fois de ceux qui les lisent, avec certainement la réduction accélérée, dans certains cas la disparition des références qu’on avait coutume d’utiliser pour cette sorte de démarche.»
Nous nous trouvons dans des temps, – «une époque», dirions-nous également, – où il est extrêmement difficile de distinguer la réalité même quand on dispose de tous les éléments constitutifs de cette réalité. En fait, lorsque nous disposons de tous ces éléments constitutifs de cette réalité, nous en avons en réalité (!) bien plus et il faut alors déterminer lesquels sont appropriés. Nous dirions qu’il s’agit là d’une question de choix (de notre part), mais un choix extraordinairement difficile à faire parce qu’il doit se placer au-dessus des pressions qui s’exercent dans tous les sens, tout en tenant compte de ces pressions. Ce choix est nécessairement restrictif, éliminatoire, impitoyable, et il ne peut être justifié que par le but poursuivi, qui doit être le fondement qui structurera notre jugement général de la situation. Ce choix doit être justifié par l’exploitation, la mise à nu d’une perspective d’un événement traité d’une façon spécifique, en fonction d’une vision, qui est aussi le fondement de la pensée qui juge.
Ce fondement est connu pour notre cas, il s’exprime bien entendu par l’affirmation péremptoire que notre Système est en train de s’effondrer, “sous nos yeux et sous nos pieds”, et même, et surtout peut-être, que cette crise est en nous... «…Notre hypothèse n’est donc pas de dire “une catastrophe va arriver” mais bien que nous allons devoir admettre que la “catastrophe” (la crise générale de l’effondrement) est en cours et qu'elle est quasiment en nous, que nous la vivons littéralement “semaine après semaine, jour après jour”…».
Pour suivre cette ligne, il faut en arriver au point où le fait d’espérer, de prévoir, de croire, d’attendre que le Système va s’effondrer, se transmue dans le fait indiscutable de savoir que le Système va s’effondrer et s’effondre en vérité dans le temps présent où nous écrivons. Il est évident qu’il y a dans cette sorte d’injonction une dimension qui échappe au circuit habituel de la raison (lequel circuit est aujourd’hui percé de multitudes de trous, à l’image du degré de perversion de la raison par le Système, à l’image de conduites pourries, bouffées par les termites). Pour autant, et pour montrer l’intérêt de la référence historique bien choisie, il y a aussi des expériences historiques qui se rapprochent de cette situation, comme nous le rappelions dans le même texte F&C du 8 février 2013, qu’il est utile de citer pour y trouver quelques outils de compréhension pour le temps présent… «Au reste, c’est en revenir à une autre sorte de “modèle russe”, dans sa version gorbatchévienne, ou “modèle Gorbatchev” : le fait pour le dirigeant soviétique des années 1980 de “savoir la crise” le conduisit à “dire la crise” (la glasnost). On connaît la suite, la substantivation de la crise, son accélération phénoménale par rapport à ce qu’on en pouvait attendre, si rapide que l’effet produit fut une implosion plus qu’une explosion…»
Ce que nous voulons ajouter à cette rapide description, c’est la perception et l’information de ce processus. Nous avons vécu (notamment) ces six années de 1985 à 1991 et ne cessons de rappeler chaque fois que l’occasion nous en est donnée que, malgré l’empilement d’événements extraordinaires à partir de mai 1985 (deux mois après la nomination de Gorbatchev à la fonction de Premier Secrétaire du PC de l’URSS), personne de sérieux et de responsable n’avait prévu l’événement fondamental de la fin du communisme lié expressément à l’“expérience Gorbatchev” spécifiquement considérée, avec sa glasnost, – aussi bien publiquement que d’une façon non officielle, que sous la forme d’une confidence chuchotée. Nous rappelons souvent qu’à la fin septembre 1989, à quarante jours de la chute du Mur de Berlin et alors que les Allemands de l’Est se précipitaient en Hongrie où un régime libéral était déjà installé, que la Pologne avait connu ses premières élections démocratiques avec l’arrivée au pouvoir des gens de Solidarnosc, que le régime est-allemand s’effondrait dans le désordre, que Gorbatchev conseillait à tous les “satellites” (les ex-“satellites”) de laisser faire (les foules et le désordre, accessoirement les projets de “réformes”), pas un seul dirigeant occidental ou autre, ou communiste, ne prévoyait la chute du communisme “dans un futur prévisible” ou pas, – simplement, cette question constituait une hypothèse absurde ; et tous les dirigeants occidentaux et autres ne commençaient à envisager la possibilité d’une réunification allemande, sujet devenu d’actualité avec la rapide désintégration de la RDA, que “pour au-delà de 2000” (un seul d’entre eux, l’ambassadeur US à Bonn, et colonel Vernon Walters, envisageait, ce même mois de septembre 1989, la réunification allemande “pour dans très peu d’années, d’ici deux à quatre ans”). Dieu sait pourtant que les dirigeants d’alors étaient d’un autre calibre que ceux que nous avons aujourd’hui, mais non, ils ne voyaient rien… Dieu sait que les conditions et les événements étaient bien plus et bien mieux contrôlés qu’ils ne sont aujourd’hui, et que l’information échappait encore en partie au carcan général des narrative qui, aujourd’hui, affecte jusqu’aux esprits de ces élites-Système à la psychologie si affaiblie, – mais non, ils ne voyaient rien…
Observer et rappeler tout cela, ce n’est certainement pas critiquer ceux qui ne virent rien venir (c’est-à-dire tous, y compris Gorbatchev), car l’histoire devenue Histoire suivait sa propre pente, et à quelle vitesse, sans prendre le temps d’en informer sapiens. Observer et rappeler tout cela, c’est directement impliquer que nous tenons les événements actuels comme devant être considérés d’une façon parallèle et similaire à ceux de 1985-1991, mais dans un cadre et dans une dynamique d’une puissance infiniment plus considérables, au point que l’on peut avancer le constat que leur action transforme la nature même de l’époque et notre perception également, passant à la perception immédiate et directe de la métahistoire ; et que nous tenons les événements actuels à l’image de ceux de 1985-1991, mais également dans un cadre et dans une dynamique d’une puissance bien plus considérables, – nous allons vers une fin alors que la chute du communisme n’était qu’une étape, – accouchant d’un flux événementiel singulièrement imprévisible et exceptionnellement développé hors de toutes les normes courantes. Par conséquent et au-delà des similitudes, il s’agit d’une «époque» ouverte à toutes les embardées et à tous les effets, y compris et surtout dans le domaine de notre psychologie, dans une mesure bien plus grande jusqu’à un changement de nature qu’en 1985-1991.
Forts de ce point de vue, nous sommes conduits indirectement à annoncer, ou plutôt à confirmer une tendance déjà largement engagée et perceptible dans les textes de ce site, les commentaires. Il s’agit de tenir la “réalité” que nous offre le système de la communication, avec son flux d’information, comme une “matière” impossible à fixer d’une façon satisfaisante, parce que devenue un état désormais trop fluide et insaisissable, à la fois dans une situation de déstructuration affirmée, à la fois dans une dynamique de constante dissolution accélérée. (Chaque événement signalé et observé, apparaît dans cette situation de déstructuration et dans cette dynamique de dissolution.) Il s’agit désormais de tenir la “réalité” comme un facteur absolument relatif et ne proposant lui-même aucune assurance ; s’en tenir à lui pour tenter de comprendre les situations et d’identifier les choses, même et surtout d’une façon radicalement critique, c’est soumettre la perception à des tensions insupportables et gravement dommageables jusqu’à précipiter la psychologie dans la pathologie, – c’est aggraver encore sa situation. On doit retrouver cette démarche de rupture radicale avec leur “réalité” dans tout notre travail, notamment celui qui tente d’interpréter les événements courants, selon notre processus rigoureux de sélection, à la lumière générale que nous définissons ; on y ajoute les analyses fondamentales (le 14 février 2013, par exemple) qui permettent de placer notre pensée dans le cadre plus large de la recherche directe de la vérité du monde, hors-Système, pour en proposer des synthèses.
La critique nécessaire et destructrice du Système doit nécessairement prendre ses distances des seuls faits de la “réalité”, même s’ils ne sont pas déformés, parce que ces “faits” eux-mêmes sont imprégnés de la pathologie et de l’hystérie qui enrobe la dynamique d’autodestruction du Système. (C’est bien une des fonctions primordiales de l’inconnaissance, qui tient les “faits” à distance, en choisit quelques-uns et écartent les autres, d’abord pour conserver l’équilibre et la puissance de compréhension du sujet, en même temps que l’ouvrir d’autant mieux à l’intuition haute qui structure cet équilibre et cette puissance.)
Cette préoccupation “opérationnelle” est partout présente dans nos textes, désormais, et d’une façon explicite. Il nous semble ainsi approprié de revenir à un autre texte, mis en ligne le 18 février 2013. Voici un extrait de la conclusion de cette Note d’analyse qui nous emmenait en vrac, de l’explosion d’un météorite à un vol de Tu-95, en passant par Kerry au téléphone, Lavrov qui ne répond pas au téléphone, Jirinovski qui fulmine, Nuland qui complote, Sorcha qui met en ligne et ainsi de suite… Nous nous posâmes alors cette question, qui était plus proche d’une apostrophe insistante et furieuse : “Alors, que devient la réalité dans tout cela ?”
«La réponse à cette dernière question est bien dans un autre enchaînement, un enchaînement de questions : est-il utile de distinguer la réalité ? Y a-t-il encore une “réalité” au sens classique et courant de la chose, qui mérite qu’on cherche à la distinguer ? Ne faut-il pas s’attacher à distinguer d’autres “réalités” qui n’en sont pas vraiment selon l’entendement habituel, mais plus proches de la vérité que la “‘réalité’ au sens classique et courant de la chose” ?
»Dans une critique élogieuse de la série House of Cards, – sur laquelle, nous le répétons, nous reviendrons, – Ari Melber disserte (The Atlantic du 12 février 2013) à propos de critiques qu’on pourrait faire sur des situations et des actes prêtées aux personnages, par rapport à la situation de la direction politique du Système, à Washington. Puis il tranche, net et clair : «But that would miss the point. House of Cards is aiming for truth, not accuracy.» C’est cela : la précision des situations et des faits (accuracy) constitue la “réalité”, qui, elle, n’a rien à voir avec la vérité (truth). Cette conception résumée par l’apostrophe de Melber est plus que jamais, elle, constitutive de notre époque, à un point où la nature des concepts est transformée et que la “réalité” restituée d’une façon que les esprits courts jugeraient parfaitement précise est souvent, de plus en plus souvent jusqu’à former sa nature propre nouvelle, une tromperie faussaire de la vérité. Il faut s’accommoder de ce constat qui ne définit pas un monde nouveau mais qui caractérise un passage du monde (ou une «époque»), une crise d’effondrement où le système de la communication tient un rôle si essentiel…»
C’est exactement de cela qu’il s’agit dans ce commentaire (le texte présent) où nous entendons exposer l’évolution de notre travail à la lumière des conditions évolutives du système de la communication que nous identifions. Ce sont les conditions de l’inconnaissance développées d’une façon “opérationnelle“, où l’information devient un facteur dépendant, pour le jugement qu’on porte sur lui, à la fois de l’intuition (haute) et de l’expérience historique, à la fois d’une raison “réparée” qui s’exerce non plus selon les impulsions extérieures (les informations perçues comme des faits et qui ne sont que des “narrativede faits”) mais en traitant ces impulsions extérieures à la lumière de l’intuition et de l’expérience historique qui ont déjà largement constitué dans l’esprit et son jugement une vision générale de la situation caractérisée par le phénomène considérable et quasiment exclusif de la crise de l’effondrement du Système. Cette vision générale constitue la référence de la vérité dans notre perception, tandis que la réalité doit être impitoyablement traitée comme un facteur contingent parmi d’autres (d’autres “réalités” éventuellement), soumis à une critique intuitive de plus en plus pressante et exigeante, pour n’être utilisée qu’avec méfiance, parcimonie et prudente mesure, et traitée selon nos conceptions à nous. Cette démarche implique le constat décisif que l’action humaine (du sapiens), de laquelle dépend la “réalité” fournie par le système de la communication et les “informations” qu’il nous offre, ne constitue qu’une faible part de l’action métahistorique générale dépendant principalement de courants supérieurs et extra-humains. Ce constat qui ne cesse de s’affirmer dans notre jugement suggère désormais l’accessibilité à la vérité du monde, comme production décisive de l’inconnaissance par rapport à la relativité le plus souvent faussaire représentée par la “réalité”, cette relativité faussaire telle que le Système dans sa phase finale d’autodestruction l’a transformée, telle que nous la déterminons de plus en plus précisément.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 mars 2013
Le retour en force du solidarisme
Le retour en force du solidarisme
par Georges FELTIN-TRACOL
 Le solidarisme est une notion tombée en déshérence depuis longtemps. En 1896, l’homme politique français, Léon Bourgeois, publia Solidarité qui jetait les bases de la première doctrine solidariste. Responsable radical-socialiste, républicain et laïque farouche, Bourgeois s’inquiétait du succès du socialisme « utopique », du catholicisme social et du marxisme et tâchait d’y répondre. Dès 1907, sur les traces de Bourgeois, Célestin Bouglé écrivait Le solidarisme tandis que le sociologue Émile Durkheim le reprenait à son compte. S’inscrivant dans le grand courant mutualiste, le solidarisme émerge aussi hors de France. Ainsi, préoccupé par le sort des ouvriers, l’ingénieur allemand Rudolf Diesel publie-t-il Solidarismus en 1903. Cependant le mot et sa signification demeurent confinés à des cercles restreints : le solidarisme de Bourgeois ne connut aucune notoriété.
Le solidarisme est une notion tombée en déshérence depuis longtemps. En 1896, l’homme politique français, Léon Bourgeois, publia Solidarité qui jetait les bases de la première doctrine solidariste. Responsable radical-socialiste, républicain et laïque farouche, Bourgeois s’inquiétait du succès du socialisme « utopique », du catholicisme social et du marxisme et tâchait d’y répondre. Dès 1907, sur les traces de Bourgeois, Célestin Bouglé écrivait Le solidarisme tandis que le sociologue Émile Durkheim le reprenait à son compte. S’inscrivant dans le grand courant mutualiste, le solidarisme émerge aussi hors de France. Ainsi, préoccupé par le sort des ouvriers, l’ingénieur allemand Rudolf Diesel publie-t-il Solidarismus en 1903. Cependant le mot et sa signification demeurent confinés à des cercles restreints : le solidarisme de Bourgeois ne connut aucune notoriété.
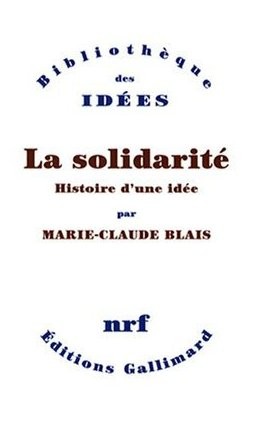 Ce néo-solidarisme exprime sa dette à l’égard du nationalisme français dont il se veut l’héritier, mais pas seulement, parce qu’il « accepte notre histoire en bloc (p. 17) ». « En tant que nationalisme d’émancipation, le solidarisme pose naturellement que le nom de Français n’est pas qu’une imposture verbale (pp. 13 – 14). » Que cela signifie-t-il ? « Formalisation théorique d’un effort profond, celui de lutter contre l’oppression de notre peuple (p. 13) », ce nouveau solidarisme se veut nationaliste et révolutionnaire. En effet, dans le contexte de la mondialisation ultra-libérale, « le nationalisme devient dialectiquement une force de justice sociale anticapitaliste. Anticapitaliste au sens où elle lutte contre la forme actuelle et par suite réelle du capitalisme dominant, financier et mondialisée (p. 26) ». Hugo Lesimple le conçoit même comme « la pensée du Français radical, du Français en guerre pour préserver ce qu’il est et ce qu’il a gagné ou hérité des combats de ses ancêtres. C’est la pensée du Français qui refuse de crever pour rien parce que le monde “ va ainsi ”. C’est la pensée du résistant qui ne croit pas en la grande Allemagne, la pensée du communard qui se moque des magouilles diplomatiques de Thiers, la pensée du poilu, de Cambronne et des sans-culottes (p. 13) ». Pourtant, sans généraliser, cette résistance populaire, voire populiste, se retrouve ailleurs, en Argentine par exemple avec le péronisme ou justicialisme.
Ce néo-solidarisme exprime sa dette à l’égard du nationalisme français dont il se veut l’héritier, mais pas seulement, parce qu’il « accepte notre histoire en bloc (p. 17) ». « En tant que nationalisme d’émancipation, le solidarisme pose naturellement que le nom de Français n’est pas qu’une imposture verbale (pp. 13 – 14). » Que cela signifie-t-il ? « Formalisation théorique d’un effort profond, celui de lutter contre l’oppression de notre peuple (p. 13) », ce nouveau solidarisme se veut nationaliste et révolutionnaire. En effet, dans le contexte de la mondialisation ultra-libérale, « le nationalisme devient dialectiquement une force de justice sociale anticapitaliste. Anticapitaliste au sens où elle lutte contre la forme actuelle et par suite réelle du capitalisme dominant, financier et mondialisée (p. 26) ». Hugo Lesimple le conçoit même comme « la pensée du Français radical, du Français en guerre pour préserver ce qu’il est et ce qu’il a gagné ou hérité des combats de ses ancêtres. C’est la pensée du Français qui refuse de crever pour rien parce que le monde “ va ainsi ”. C’est la pensée du résistant qui ne croit pas en la grande Allemagne, la pensée du communard qui se moque des magouilles diplomatiques de Thiers, la pensée du poilu, de Cambronne et des sans-culottes (p. 13) ». Pourtant, sans généraliser, cette résistance populaire, voire populiste, se retrouve ailleurs, en Argentine par exemple avec le péronisme ou justicialisme.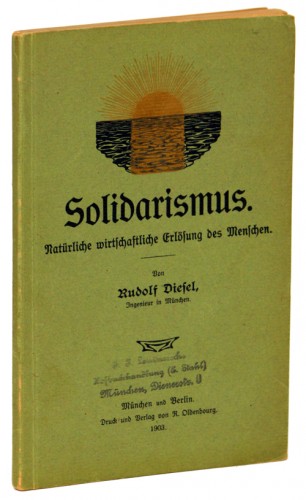 Prenant acte qu’une « lutte des classes existe : celle des travailleurs contre l’hyper-classe mondialiste (p. 84) », le néo-solidarisme désigne clairement que « son ennemi est la Banque, soit l’ensemble des puissances financières parasitant les États et affaiblissant leur puissance pour canaliser le maximum de bénéfices vers les actionnaires de cette économie financière (p. 25) ». Hugo Lesimple estime que « face à cette hyper-classe, le solidarisme est la doctrine des sans-culottes modernes. Il est dans une lutte pour une égalité réelle, concrète, nationale, à mille lieues d’un égalitarisme d’imposture qui permet de payer le travailleur français et l’immigré au même salaire, pour le compte d’un actionnaire cent fois plus riche qu’eux (p. 19) ». Par conséquent, « le solidarisme est républicain, il met la res publica, l’intérêt public, au dessus des intérêts particuliers d’une élite, d’un groupe ou d’une région (p. 19) ».
Prenant acte qu’une « lutte des classes existe : celle des travailleurs contre l’hyper-classe mondialiste (p. 84) », le néo-solidarisme désigne clairement que « son ennemi est la Banque, soit l’ensemble des puissances financières parasitant les États et affaiblissant leur puissance pour canaliser le maximum de bénéfices vers les actionnaires de cette économie financière (p. 25) ». Hugo Lesimple estime que « face à cette hyper-classe, le solidarisme est la doctrine des sans-culottes modernes. Il est dans une lutte pour une égalité réelle, concrète, nationale, à mille lieues d’un égalitarisme d’imposture qui permet de payer le travailleur français et l’immigré au même salaire, pour le compte d’un actionnaire cent fois plus riche qu’eux (p. 19) ». Par conséquent, « le solidarisme est républicain, il met la res publica, l’intérêt public, au dessus des intérêts particuliers d’une élite, d’un groupe ou d’une région (p. 19) ».
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2906
18:09 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, solidarisme, solidarité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 mars 2013
Sur la notion de patrie charnelle

Robert STEUCKERS:
Causerie à bâtons rompus sur la notion de patrie charnelle
Conférence prononcée à Nancy, à la tribune de “Terre & Peuple” (Lorraine), le 10 mars 2012
La notion de patrie charnelle nous vient de l’écrivain et militant politique Marc Augier, dit “Saint-Loup”, dont le monde de l’édition —en particulier les “Presses de la Cité”— a surtout retenu les récits de son aventure militaire sur le Front de l’Est pendant la seconde guerre mondiale. Mais l’oeuvre de Saint-Loup ne se résume pas à cette seule aventure militaire, ses récits de fiction, son évocation des “Cathares de Montségur” ou de la Terre de Feu argentine le hissent au niveau d’un très grand écrivain, ce qu’il serait devenu indubitablement pour la postérité s’il n’avait traîné une réputation de “réprouvé” donc de “pestiféré”. Dans les écrits de ce Français très original, il y a beaucoup plus à glaner que ces seules péripéties militaires dans un conflit mondial du passé qui ne cesse de hanter les esprits, comme le prouve l’existence de belles revues sur papier glacé, comme “39-45” ou “Ligne de front”, par exemple. Il faut se rappeler, entre bien d’autres choses, qu’il a été l’initiateur des auberges de jeunesse sous le “Front Populaire”, lorsqu’il était un militant socialiste, incarnant un socialisme fort différent de celui des avocats aigris, “maçonneux”, encravatés et radoteurs-rationalistes: le socialisme du camarade Marc Augier (qui n’est pas encore Saint-Loup) est joyeux et juvénile, c’est un socialisme de l’action, du grand “oui” à la Vie. Saint-Loup, que je n’ai rencontré que deux fois, en 1975, était effectivement un homme affable et doux mais amoureux de l’action, de toute action amenant des résultats durables, hostile aux chichis et aux airs pincés des psycho-rigides qui ont incarné les établissements successifs dont la France a été affligée.
Un monde qui devrait être tissé de fraternité
 Le terme “action”, en politique, dans l’espace linguistique francophone, possède une genèse particulière. Maurras utilise le mot dans le nom de son mouvement, l’Action Française, sans nécessairement se référer à la philosophie du catholique Maurice Blondel, auteur d’un solide traité philosophique intitulé “L’Action”, pour qui l’engagement pour la foi devait être permanent et inscrit dans des “oeuvres”, créées pour le “Bien commun” et qu’il fallait perpétuer en offrant ses efforts, sans tenter de les monnayer, sans espérer une sinécure comme récompense. En Belgique, le Cardinal Mercier, correspondant de Blondel, donnera une connotation politisée, sans nul doute teintée de maurrassisme, à des initiatives comme l’Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dont émergeront deux phénomènes marquants de l’histoire et de l’art belges du 20ème siècle: 1) le rexisme de Degrelle en tant que dissidence contestatrice fugace et éphémère du “Parti Catholique”, et, 2) dans un registre non politicien et plus durable, la figure de Tintin, qui agit dans ses aventures pour que le Bien platonicien ou la justice (divine?) triomphe, sans jamais faire état de ses croyances, de ses aspirations religieuses, sans jamais montrer bondieuseries ou affects pharisiens. Cette dimension aventurière, Saint-Loup l’a très certainement incarnée, comme Tintin, même si son idiosyncrasie personnelle ne le rapprochait nullement du catholicisme français de son époque, amoureux des productions graphiques d’Hergé via la revue “Coeurs Vaillants”; en effet, Saint-Loup est né dans une famille protestante, hostile à l’Eglise en tant qu’appareil trop rigide. Ce protestantisme se muera en un laïcisme militant, exercé dans un cadre politique socialiste, se voulant détaché de tout appareil clérical, au nom du laïcisme révolutionnaire. Saint-Loup crée en effet ses auberges de jeunesse dans le cadre d’une association nommée “Centre laïque des Auberges de Jeunesse”. Dans cette optique, qui est la sienne avant-guerre, le monde idéal, s’il advenait, devrait être tissé de fraternité, ce qui exclut tout bigotisme et tout alignement sur les manies des bien-pensants (et là il rejoint un catholique haut en couleurs, Georges Bernanos...).
Le terme “action”, en politique, dans l’espace linguistique francophone, possède une genèse particulière. Maurras utilise le mot dans le nom de son mouvement, l’Action Française, sans nécessairement se référer à la philosophie du catholique Maurice Blondel, auteur d’un solide traité philosophique intitulé “L’Action”, pour qui l’engagement pour la foi devait être permanent et inscrit dans des “oeuvres”, créées pour le “Bien commun” et qu’il fallait perpétuer en offrant ses efforts, sans tenter de les monnayer, sans espérer une sinécure comme récompense. En Belgique, le Cardinal Mercier, correspondant de Blondel, donnera une connotation politisée, sans nul doute teintée de maurrassisme, à des initiatives comme l’Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dont émergeront deux phénomènes marquants de l’histoire et de l’art belges du 20ème siècle: 1) le rexisme de Degrelle en tant que dissidence contestatrice fugace et éphémère du “Parti Catholique”, et, 2) dans un registre non politicien et plus durable, la figure de Tintin, qui agit dans ses aventures pour que le Bien platonicien ou la justice (divine?) triomphe, sans jamais faire état de ses croyances, de ses aspirations religieuses, sans jamais montrer bondieuseries ou affects pharisiens. Cette dimension aventurière, Saint-Loup l’a très certainement incarnée, comme Tintin, même si son idiosyncrasie personnelle ne le rapprochait nullement du catholicisme français de son époque, amoureux des productions graphiques d’Hergé via la revue “Coeurs Vaillants”; en effet, Saint-Loup est né dans une famille protestante, hostile à l’Eglise en tant qu’appareil trop rigide. Ce protestantisme se muera en un laïcisme militant, exercé dans un cadre politique socialiste, se voulant détaché de tout appareil clérical, au nom du laïcisme révolutionnaire. Saint-Loup crée en effet ses auberges de jeunesse dans le cadre d’une association nommée “Centre laïque des Auberges de Jeunesse”. Dans cette optique, qui est la sienne avant-guerre, le monde idéal, s’il advenait, devrait être tissé de fraternité, ce qui exclut tout bigotisme et tout alignement sur les manies des bien-pensants (et là il rejoint un catholique haut en couleurs, Georges Bernanos...).
Contre la “double désincarnation”
Les linéaments idiosyncratiques de la pensée émergente du jeune Marc Augier conduisent bien entendu à une rupture bien nette avec l’ordre établi, parce que l’ordre est désormais désincarné et qu’il faut le réincarner. Comment? En recréant de la fraternité, notamment par le biais des auberges de jeunesse. Aussi en revenant aux sources de toutes les religions, c’est-à-dire au paganisme (option également partagée par Robert Dun). Sur le plan politique, les options de Saint-Loup sont anti-étatistes, l’Etat étant une rigidité, comme l’Eglise, qui empêche toute véritable fraternité de se déployer dans la société. Saint-Loup ne sera donc jamais l’adepte d’un nationalisme étatique, partageant cette option avec le Breton Olier Mordrel, qui fut, lui, condamné à mort par l’Etat français en 1940: le militant de la Bretagne libre va alors condamner à mort en esprit l’instance (de pure fabrication) qui l’a condamné à mort, lui, le Breton de chair et de sang. Chez Saint-Loup, ces notions de fraternité, de paganisme, d’anti-étatisme postulent en bout de course 1) une vision de l’espace français comme tissu pluriel, dont il ne faut jamais gommer la diversité, et 2) une option européenne. Mais l’Europe, telle qu’elle était, telle qu’elle est aujourd’hui, aux mains des bien-pensants, n’était et n’est plus elle-même; elle est coupée de ses racines par un christianisme étranger à ses terres et par la modernité qui est un avatar laïcisé de ce christianisme éradicateur. Constater que l’Europe est malade et décadente revient donc à constater une “double désincarnation”.
Les deux axiomes de la pensée charnelle
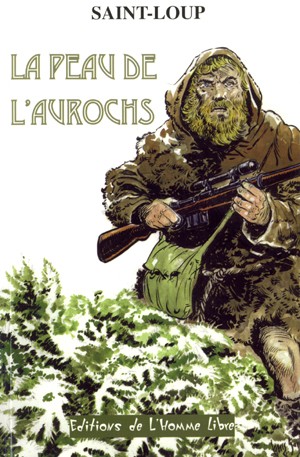 Cette perception de l’Europe, de nos sociétés européennes, se révèle dans le roman “La peau de l’aurochs”, géographiquement situé dans une vallée valdotaine. Les Valdotains de “La peau de l’aurochs” se rebiffent contre l’industrialisation qui détruit les traditions populaires (ce n’est pas toujours vrai, à mon sens, car dans des régions industrielles comme la Lorraine, la Ruhr ou la Wallonie du sillon Sambre-Meuse sont nées des cultures ouvrières et populaires riches, d’où les sculpteurs Constantin Meunier et Georges Wasterlain ont tiré leurs créations époustouflantes de beauté classique). Et les Valdotains du roman de Saint-Loup veulent aussi préserver les cultes ancestraux, ce qui est toujours plus aisé dans les régions montagneuses que dans les plaines, notamment en Suisse, où les dialectes des vallées se maintiennent encore, ainsi que dans tout l’arc alpin, notamment en Italie du Nord où une revue comme “Terra Insubre” défend et illustre les résidus encore bien vivants de la culture populaire lombarde et cisalpine. “La peau de l’aurochs” est un roman qui nous permet de déduire un premier axiome dans le cadre de la défense de toutes les identités charnelles: la PRESERVATION DE NOTRE IDENTITE = la GARANTIE DE NOTRE ETERNITE. Cet axiome pourrait justifier une sorte de quiétisme, d’abandon de toute revendication politique, un désintérêt pour le monde. Ce pourrait être le cas si on se contentait de ne plus faire que du “muséisme”, de ne recenser que des faits de folklore, en répétant seulement des traditions anciennes. Mais Saint-Loup, comme plus tard Jean Mabire, ajoute à cette volonté de préservation un sens de l’aventure. Nos deux auteurs s’interdisent de sombrer dans toute forme de rigidité conceptuelle et privilégient, comme Olier Mordrel, le vécu. Le Breton était très explicite sur ce recours permanent au “vécu” dans les colonnes de sa revue “Stur” avant la seconde guerre mondiale. De ce recours à l’aventure et au vécu, nous pouvons déduire un second axiome: les RACINES SONT DANS LES EXPERIENCES INTENSES. Ce deuxième axiome doit nous rendre attentifs aux oppositions suivantes: enracinement/déracinement, désinstallation/installation. Avec Saint-Loup et Mabire, il convient donc de prôner l’avènement d’une humanité enracinée et désinstallée (aventureuse) et de fustiger toute humanité déclinante qui serait déracinée et installée.
Cette perception de l’Europe, de nos sociétés européennes, se révèle dans le roman “La peau de l’aurochs”, géographiquement situé dans une vallée valdotaine. Les Valdotains de “La peau de l’aurochs” se rebiffent contre l’industrialisation qui détruit les traditions populaires (ce n’est pas toujours vrai, à mon sens, car dans des régions industrielles comme la Lorraine, la Ruhr ou la Wallonie du sillon Sambre-Meuse sont nées des cultures ouvrières et populaires riches, d’où les sculpteurs Constantin Meunier et Georges Wasterlain ont tiré leurs créations époustouflantes de beauté classique). Et les Valdotains du roman de Saint-Loup veulent aussi préserver les cultes ancestraux, ce qui est toujours plus aisé dans les régions montagneuses que dans les plaines, notamment en Suisse, où les dialectes des vallées se maintiennent encore, ainsi que dans tout l’arc alpin, notamment en Italie du Nord où une revue comme “Terra Insubre” défend et illustre les résidus encore bien vivants de la culture populaire lombarde et cisalpine. “La peau de l’aurochs” est un roman qui nous permet de déduire un premier axiome dans le cadre de la défense de toutes les identités charnelles: la PRESERVATION DE NOTRE IDENTITE = la GARANTIE DE NOTRE ETERNITE. Cet axiome pourrait justifier une sorte de quiétisme, d’abandon de toute revendication politique, un désintérêt pour le monde. Ce pourrait être le cas si on se contentait de ne plus faire que du “muséisme”, de ne recenser que des faits de folklore, en répétant seulement des traditions anciennes. Mais Saint-Loup, comme plus tard Jean Mabire, ajoute à cette volonté de préservation un sens de l’aventure. Nos deux auteurs s’interdisent de sombrer dans toute forme de rigidité conceptuelle et privilégient, comme Olier Mordrel, le vécu. Le Breton était très explicite sur ce recours permanent au “vécu” dans les colonnes de sa revue “Stur” avant la seconde guerre mondiale. De ce recours à l’aventure et au vécu, nous pouvons déduire un second axiome: les RACINES SONT DANS LES EXPERIENCES INTENSES. Ce deuxième axiome doit nous rendre attentifs aux oppositions suivantes: enracinement/déracinement, désinstallation/installation. Avec Saint-Loup et Mabire, il convient donc de prôner l’avènement d’une humanité enracinée et désinstallée (aventureuse) et de fustiger toute humanité déclinante qui serait déracinée et installée.
On ne peut juger avec exactitude l’impact de la lecture de Nietzsche sur la génération de Saint-Loup en France. Mais il est certain que la notion, non théorisée à l’époque, de “désinstallation”, est une notion cardinale de la “révolution conservatrice” allemande, relayée par Ernst Jünger à l’époque de son militantisme national-révolutionnaire puis, après 1945, par Armin Mohler et, à sa suite, par la “nouvelle droite”, via les thèses “nominalistes” qu’il avait exposées dans les colonnes de la revue munichoise “Criticon”, en 1978-79. La personnalité volontariste et désinstallée, en retrait (“withdrawal”, disait Toynbee) par rapport aux établissements installés, est celle qui, si la chance lui sourit, impulse aux cycles historiques de nouveaux infléchissements, lors de son retour (“return” chez Toynbee) sur la scène historico-politique. Cette idée, exposée dans la présentation que faisait Mohler de la “révolution conservatrice” dans sa célèbre thèse de doctorat, a été importée dans le corpus de la “nouvelle droite” française par Giorgio Locchi, qui a recensé cet ouvrage fondamental pour la revue “Nouvelle école”.
Saint-Loup, Tournier: la fascination pour l’Allemagne
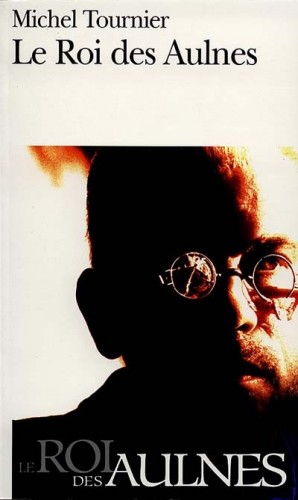 Le socialiste Marc Augier, actif dans le cadre du “Front populaire” français de 1936, découvrira l’Allemagne et tombera sous son charme. Pourquoi l’Allemagne? Dans les années 30, elle exerçait une véritable fascination, une fascination qui est d’abord esthétique, avec les “cathédrales de lumière” de Nuremberg, qui s’explique ensuite par le culte de la jeunesse en vigueur au cours de ces années. Les auberges et les camps allemands sont plus convaincants, aux yeux de Marc Augier, que les initiatives, somme toute bancales, du “Front populaire”. Il ne sera pas le seul à partager ce point de vue: Michel Tournier, dans “Le Roi des Aulnes”, partage cette opinion, qui s’exprime encore avec davantage de brio dans le film du même titre, réalisé par Volker Schlöndorff. Le célèbre créateur de bandes dessinées “Dimitri”, lui aussi, critique les formes anciennes d’éducation, rigides et répressives, dans sa magnifique histoire d’un pauvre gamin orphelin, devenu valet de ferme puis condamné à la maison de correction pour avoir tué le boucher venu occire son veau favori, confident de ses chagrins, et qui, extrait de cette prison pour aller servir la patrie aux armées, meurt à la bataille de Gallipoli. Le héros naïf Abel dans “le Roi des Aulnes” de Schlöndorff, un Abel, homme naïf, naturel et intact, jugé “idiot” par ses contemporains est incarné par l’acteur John Malkovich: il parle aux animaux (le grand élan, la lionne de Goering, les pigeons de l’armée française...) et communique facilement avec les enfants, trouve que la convivialité et la fraternité sont réellement présentes dans les camps allemands de la jeunesse alors qu’elles étaient totalement absentes, en tant que vertus, dans son école française, le collège Saint-Christophe. Certes Schlöndorff montre, dans son film, que cette convivialité bon enfant tourne à l’aigreur, la crispation et la fureur au moment de l’ultime défaite: le visage du gamin qui frappe Abel d’un coup de crosse, lui brise les lunettes, est l’expression la plus terrifiante de cette rage devenue suicidaire.Tournier narre d’ailleurs ce qui le rapproche de l’Allemagne dans un petit essai largement autobiographique, “Le bonheur en Allemagne?” (Folio, n°4366).
Le socialiste Marc Augier, actif dans le cadre du “Front populaire” français de 1936, découvrira l’Allemagne et tombera sous son charme. Pourquoi l’Allemagne? Dans les années 30, elle exerçait une véritable fascination, une fascination qui est d’abord esthétique, avec les “cathédrales de lumière” de Nuremberg, qui s’explique ensuite par le culte de la jeunesse en vigueur au cours de ces années. Les auberges et les camps allemands sont plus convaincants, aux yeux de Marc Augier, que les initiatives, somme toute bancales, du “Front populaire”. Il ne sera pas le seul à partager ce point de vue: Michel Tournier, dans “Le Roi des Aulnes”, partage cette opinion, qui s’exprime encore avec davantage de brio dans le film du même titre, réalisé par Volker Schlöndorff. Le célèbre créateur de bandes dessinées “Dimitri”, lui aussi, critique les formes anciennes d’éducation, rigides et répressives, dans sa magnifique histoire d’un pauvre gamin orphelin, devenu valet de ferme puis condamné à la maison de correction pour avoir tué le boucher venu occire son veau favori, confident de ses chagrins, et qui, extrait de cette prison pour aller servir la patrie aux armées, meurt à la bataille de Gallipoli. Le héros naïf Abel dans “le Roi des Aulnes” de Schlöndorff, un Abel, homme naïf, naturel et intact, jugé “idiot” par ses contemporains est incarné par l’acteur John Malkovich: il parle aux animaux (le grand élan, la lionne de Goering, les pigeons de l’armée française...) et communique facilement avec les enfants, trouve que la convivialité et la fraternité sont réellement présentes dans les camps allemands de la jeunesse alors qu’elles étaient totalement absentes, en tant que vertus, dans son école française, le collège Saint-Christophe. Certes Schlöndorff montre, dans son film, que cette convivialité bon enfant tourne à l’aigreur, la crispation et la fureur au moment de l’ultime défaite: le visage du gamin qui frappe Abel d’un coup de crosse, lui brise les lunettes, est l’expression la plus terrifiante de cette rage devenue suicidaire.Tournier narre d’ailleurs ce qui le rapproche de l’Allemagne dans un petit essai largement autobiographique, “Le bonheur en Allemagne?” (Folio, n°4366).
Une vision “sphérique” de l’histoire
Toutes ces tendances, perceptibles dans la France sainement contestatrice des années 30, sont tributaires d’une lecture de Nietzsche, philosophe qui avait brisé à coups de marteau les icônes conventionnelles d’une société qui risquait bien, à la fin du “stupide 19ème siècle”, de se figer définitivement, comme le craignaient tous les esprits non conformes et aventureux. Le nietzschéisme, via les mouvements d’avant-gardes ou via des séismographes comme Arthur Moeller van den Bruck, va compénétrer tout le mouvement dit de la “révolution conservatrice” puis passer dans le corpus national-révolutionnaire avec Ernst Jünger, tributaire, lui aussi, du nietzschéisme ambiant des cercles “jungkonservativ” mais tributaire également, dans les traits tout personnels de son style et dans ses options intimes, de Barrès et de Bloy. Quand Armin Mohler, secrétaire d’Ernst Jünger après la seconde guerre mondiale, voudra réactiver ce corpus qu’il qualifiera de “conservateur” (ce qu’il n’était pas aux sens français et britannique du terme) ou de “nominaliste” (pour lancer dans le débat une étiquette nouvelle et non “grillée”), il transmettra en quelque sorte le flambeau à la “nouvelle droite”, grâce notamment aux recensions de Giorgio Locchi, qui résumera en quelques lignes, mais sans grand lendemain dans ces milieux, la conception “sphérique” de l’histoire. Pour les tenants de cette conception “sphérique” de l’histoire, celle-ci n’est forcément pas “linéaire”, ne s’inscrit pas sur une ligne posée comme “ascendante” et laissant derrière elle tout le passé, considéré sans la moindre nuance comme un ballast devenu inutile. L’histoire n’est pas davantage “cyclique”, reproduisant un “même” à intervalles réguliers, comme pourrait le faire suggérer la succession des saisons dans le temps naturel sous nos latitudes européennes. Elle est sphérique car des volontés bien tranchées, des personnalités hors normes, lui impulsent une direction nouvelle sur la surface de la “sphère”, quand elles rejettent énergiquement un ronron répétitif menaçant de faire périr d’ennui et de sclérose un “vivre-en-commun”, auparavant innervé par les forces vives de la tradition. S’amorce alors un cycle nouveau qui n’a pas nécessairement, sur la sphère, la même trajectoire circulaire et rotative que son prédécesseur.
Le nietzschéisme diffus, présent dans la France des années 20 et 30, mais atténué par rapport à la Belle Epoque, où des germanistes français comme Charles Andler l’avaient introduit, ensuite l’idéal de la jeunesse vagabondante, randonneuse et proche de la nature, inauguré par les mouvements dits du “Wandervogel”, vont induire un engouement pour les choses allemandes, en dépit de la germanophobie ambiante, du poids des formes mortes qu’étaient le laïcardisme de la IIIème République ou le nationalisme maurassien (contesté par les “non-conformistes” des années 30 ou par de plus jeunes éléments comme ceux qui animaient la rédaction de “Je suis partout”).
BHL: exécuteur testamentaire de Mister Yahvé
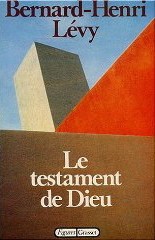 Je répète la question: pourquoi l’Allemagne? Malgré la pression due à la propagande revancharde d’avant 1914 et l’hostilité d’après 1918, la nouvelle Allemagne exerce,comme je viens de le dire, une fascination sur les esprits: cette fascination est esthétique (les “cathédrales de lumière”); elle est due aussi au culte de la jeunesse, présent en marge du régime arrivé au pouvoir en janvier 1933. L’organisation des auberges et des camps de vacances apparait plus convaincante aux yeux de Saint-Loup que les initiatives du Front Populaire, auquel il a pourtant adhéré avec enthousiasme. La fascination exercée par la “modernité nationale-socialiste” (à laquelle s’opposera une décennie plus tard la “modernité nord-américaine” victorieuse du conflit) va bien au-delà du régime politique en tant que tel qui ne fait que jouer sur un filon ancien de la tradition philosophique allemande qui trouve ses racines dans la pensée de Johann Gottfried Herder (1744-1803), comme il jouera d’ailleurs sur d’autres filons, secrétant de la sorte diverses opportunités politiques, exploitables par une propagande bien huilée qui joue en permanence sur plusieurs tableaux. Herder, ce personnage-clef dans l’histoire de la pensée allemande appartient à une tradition qu’il faut bien appeler les “autres Lumières”. Quand on évoque la philosophie des “Lumières” aujourd’hui, on songe immédiatement à la soupe que veulent nous servir les grands pontes du “politiquement correct” qui sévissent aujourd’hui, en France avec Bernard-Henri Lévy et en Allemagne avec Jürgen Habermas, qui nous intiment tous deux l’ordre de penser uniquement selon leur mode, sous peine de damnation, et orchestent ou font orchestrer par leurs larbins frénétiques des campagnes de haine contre tous les contrevenants. On sait aussi que pour Lévy, les “Lumières” (auxquelles il faut adhérer!) représentent une sorte de pot-pourri où l’on retrouve les idées de la révolution française, la tambouille droit-de-l’hommiste cuite dans les marmites médiatiques des services secrets américains du temps de la présidence de Jimmy Carter (un Quaker cultivateur de cacahouètes) et un hypothétique “Testament de Dieu”, yahvique dans sa définition toute bricolée, et dont ce Lévy serait bien entendu l’unique exécuteur testamentaire. Tous ceux qui osent ne pas croire que cette formule apportera la parousie ou la fin de l’histoire, tous les déviants, qu’ils soient maurassiens, communistes, socialistes au sens des non-conformistes français des années 30, néo-droitistes, gaullistes, économistes hétérodoxes et j’en passe, sont houspillés dans une géhenne, celle dite de l’ “idéologie française”, sorte de cloaque nauséabond, selon Lévy, où marineraient des haines cuites et recuites, où les spermatozoïdes et les ovaires de la “bête immonde” risqueraient encore de procréer suite à des coïts monstrueux, comme celui des “rouges-bruns” putatifs du printemps et de l’été 1993. Il est donc illicite d’aller remuer dans ce chaudron de sorcières, dans l’espoir de faire naître du nouveau.
Je répète la question: pourquoi l’Allemagne? Malgré la pression due à la propagande revancharde d’avant 1914 et l’hostilité d’après 1918, la nouvelle Allemagne exerce,comme je viens de le dire, une fascination sur les esprits: cette fascination est esthétique (les “cathédrales de lumière”); elle est due aussi au culte de la jeunesse, présent en marge du régime arrivé au pouvoir en janvier 1933. L’organisation des auberges et des camps de vacances apparait plus convaincante aux yeux de Saint-Loup que les initiatives du Front Populaire, auquel il a pourtant adhéré avec enthousiasme. La fascination exercée par la “modernité nationale-socialiste” (à laquelle s’opposera une décennie plus tard la “modernité nord-américaine” victorieuse du conflit) va bien au-delà du régime politique en tant que tel qui ne fait que jouer sur un filon ancien de la tradition philosophique allemande qui trouve ses racines dans la pensée de Johann Gottfried Herder (1744-1803), comme il jouera d’ailleurs sur d’autres filons, secrétant de la sorte diverses opportunités politiques, exploitables par une propagande bien huilée qui joue en permanence sur plusieurs tableaux. Herder, ce personnage-clef dans l’histoire de la pensée allemande appartient à une tradition qu’il faut bien appeler les “autres Lumières”. Quand on évoque la philosophie des “Lumières” aujourd’hui, on songe immédiatement à la soupe que veulent nous servir les grands pontes du “politiquement correct” qui sévissent aujourd’hui, en France avec Bernard-Henri Lévy et en Allemagne avec Jürgen Habermas, qui nous intiment tous deux l’ordre de penser uniquement selon leur mode, sous peine de damnation, et orchestent ou font orchestrer par leurs larbins frénétiques des campagnes de haine contre tous les contrevenants. On sait aussi que pour Lévy, les “Lumières” (auxquelles il faut adhérer!) représentent une sorte de pot-pourri où l’on retrouve les idées de la révolution française, la tambouille droit-de-l’hommiste cuite dans les marmites médiatiques des services secrets américains du temps de la présidence de Jimmy Carter (un Quaker cultivateur de cacahouètes) et un hypothétique “Testament de Dieu”, yahvique dans sa définition toute bricolée, et dont ce Lévy serait bien entendu l’unique exécuteur testamentaire. Tous ceux qui osent ne pas croire que cette formule apportera la parousie ou la fin de l’histoire, tous les déviants, qu’ils soient maurassiens, communistes, socialistes au sens des non-conformistes français des années 30, néo-droitistes, gaullistes, économistes hétérodoxes et j’en passe, sont houspillés dans une géhenne, celle dite de l’ “idéologie française”, sorte de cloaque nauséabond, selon Lévy, où marineraient des haines cuites et recuites, où les spermatozoïdes et les ovaires de la “bête immonde” risqueraient encore de procréer suite à des coïts monstrueux, comme celui des “rouges-bruns” putatifs du printemps et de l’été 1993. Il est donc illicite d’aller remuer dans ce chaudron de sorcières, dans l’espoir de faire naître du nouveau.
Habermas, théoricien de la “raison palabrante”

Pour Habermas —dont, paraît-il, le papa était Kreisleiter de la NSDAP dans la région de Francfort (ce qui doit nous laisser supposer qu’il a dû porter un beau petit uniforme de membre du Jungvolk et qu’on a dû lui confier une superbe trompette ou un joli petit tambour)— le fondement du politique n’est pas un peuple précis, un peuple de familles plus ou moins soudées par d’innombrables liens de cousinage soit, en bref, une grande famille concrète; il n’est pas davantage une communauté politique et/ou militaire partageant une histoire ou une épopée commune ni une population qui a, au fil de l’histoire, généré un ensemble d’institutions spécifiques (difficilement exportables parce que liées à un site précis et à une temporalité particulière, difficilement solubles aussi dans une panade à la BHL ou à la Habermas). Pour Jürgen Habermas, le fiston du Kreisleiter qui ne cesse de faire son Oedipe, le fondement du politique ne peut être qu’un système abstrait (abstrait par rapport à toutes les réalités concrètes et charnelles), donc une construction rationnelle (Habermas étant bien entendu, et selon lui-même, la seule incarnation de la raison dans une Allemagne qui doit sans cesse être rappelée à l’ordre parce qu’elle aurait une tendance irrépressible à basculer dans ses irrationalités), c’est-à-dire une constitution basée sur les principes des Lumières, que Habermas se charge de redéfinir à sa façon, deux siècles après leur émergence dans la pensée européenne. Dans cette perspective, même la constitution démocratique adoptée par la République Fédérale allemande en 1949 est suspecte: en effet, elle dit s’adresser à un peuple précis, le peuple allemand, et évoque une vieille vertu germanique, la “Würde”, qu’il s’agit de respecter en la personne de chaque citoyen. En ce sens, elle n’est pas universaliste, comme l’est la version des “Lumières” redéfinie par Habermas, et fait appel à un sentiment qui ne se laisse pas enfermer dans un corset conceptuel de facture rationnelle.
Dans la sphère du politique, l’émergence des principes des Lumières, revus suite aux cogitations de Jürgen Habermas, s’effectue par le “débat”, par la perpétuelle remise en question de tout et du contraire de tout. Ce débat porte le nom pompeux d’ “agir communicationnel”, que le philosophe Gerd Bergfleth avait qualifié, dans un solide petit pamphlet bien ficelé, de “Palavernde Vernunft”, de “raison palabrante”, soit de perpétuel bavardage, critique pertinente qui a valu à son auteur, le pauvre Bergfleth, d’être vilipendé et ostracisé. Notons que Habermas a fabriqué sa propre petite géhenne, qu’il appelle la “pensée néo-irrationnelle” où sont jetés, pêle-mêle, les tenants les plus en vue de la philosophie française contemporaine comme Derrida (!), Foucault, Deleuze, Guattari, Bataille, etc. ainsi que leur maître allemand, le bon philosophe souabe Martin Heidegger. Si l’on additionne les auteurs jetés dans la géhenne de l’ “idéologie française” par Lévy à ceux que fustige Habermas, il ne reste plus grand chose à lire... Il n’y a plus beaucoup de combinatoires possibles, et tenter encore et toujours de “combiner” les ingrédients (“mauvais” selon Lévy et Habermas) pour faire du neuf, pour faire éclore d’autres possibles, serait, pour nos deux inquisiteurs, se placer dans une posture condamnable que l’on adopterait que sous peine de devenir immanquablement, irrémédiablement, inexorablement, un “irrationaliste”, donc un “facho”, d’office exclu de tous débats...
Jean-François Lyotard, critique des “universaux” de Habermas
 Avec un entêtement qui devient tout-à-fait navrant au fil du temps, Habermas veut conserver dans sa philosophie et sa sociologie, dans sa vision du fonctionnement optimal de la politique quotidienne au sein des Etats occidentaux, posés comme modèles pour le reste du monde, une forme procédurière à la manière de Kant, gage d’appartenance aux Lumières et de “correction politique”, une forme procédurière qui deviendrait le fondement intangible des mécanismes politiques, un fondement privé désormais de toute la transcendance qui les chapeautait encore dans la pensée kantienne. Ce sont ces procédures, véritables épures du réel, qui doivent unir les citoyens dans un consensus minimal, obtenu par un “parler” ininterrompu, par un usage “adéquat” de la parole, conditionné par des universaux linguistiques que Habermas pose comme inamovibles (“Kommunikativa”, “Konstativa”, “Repräsentativa/Expressiva”, “Regulativa”). Bref, le Dieu piétiste kantien remplacé par le blabla des baba-cools ou des députés moisis ou des avocaillons militants, voir le “moteur immobile” d’Aristote remplacé par la fébrilité logorrhique des nouvelles “clasas discutidoras”... Le philosophe français Jean-François Lyotard démontre que de tels universaux soi-disant pragmatiques n’existent pas: les jeux de langage sont toujours producteurs d’hétérogénéité, se manifestent selon des règles qui leur sont propres et qui suscitent bien entendu des inévitables conflits. Il n’existe donc pas pour Lyotard quelque chose qui équivaudrait à un “télos du consensus général”, reposant sur ce que Habermas appelle, sans rire, “les compétences interactionnelles post-conventionnelles”; au contraire, pour Lyotard, comme, en d’autres termes, pour Armin Mohler ou l’Ernst Jünger national-révolutionnaire des années 20, il faut constater qu’il y a toujours et partout “agonalité conflictuelle entre paroles diverses/divergentes”; si l’on s’obstine à vouloir enrayer les effets de cette agonalité et à effacer cette pluralité divergente, toutes deux objectives, toutes deux bien observables dans l’histoire, on fera basculer le monde entier sous la férule d’un “totalitarisme de la raison”, soit un “totalitarisme de la raison devenue folle à force d’être palabrante”, qui éliminera l’essence même de l’humanité comme kaléidoscope infini de peuples, de diversités d’expression; cette essence réside dans la pluralité ineffaçable des jeux de paroles diverses (cf. Ralf Bambach, “Jürgen Habermas”, in J. Nida-Rümelin (Hrsg.), “Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis v. Wright”, Kröner, Stuttgart, 1991; Yves Cusset, “Habermas – L’espoir de la discussion”, Michalon, coll. “Bien commun”, Paris, 2001).
Avec un entêtement qui devient tout-à-fait navrant au fil du temps, Habermas veut conserver dans sa philosophie et sa sociologie, dans sa vision du fonctionnement optimal de la politique quotidienne au sein des Etats occidentaux, posés comme modèles pour le reste du monde, une forme procédurière à la manière de Kant, gage d’appartenance aux Lumières et de “correction politique”, une forme procédurière qui deviendrait le fondement intangible des mécanismes politiques, un fondement privé désormais de toute la transcendance qui les chapeautait encore dans la pensée kantienne. Ce sont ces procédures, véritables épures du réel, qui doivent unir les citoyens dans un consensus minimal, obtenu par un “parler” ininterrompu, par un usage “adéquat” de la parole, conditionné par des universaux linguistiques que Habermas pose comme inamovibles (“Kommunikativa”, “Konstativa”, “Repräsentativa/Expressiva”, “Regulativa”). Bref, le Dieu piétiste kantien remplacé par le blabla des baba-cools ou des députés moisis ou des avocaillons militants, voir le “moteur immobile” d’Aristote remplacé par la fébrilité logorrhique des nouvelles “clasas discutidoras”... Le philosophe français Jean-François Lyotard démontre que de tels universaux soi-disant pragmatiques n’existent pas: les jeux de langage sont toujours producteurs d’hétérogénéité, se manifestent selon des règles qui leur sont propres et qui suscitent bien entendu des inévitables conflits. Il n’existe donc pas pour Lyotard quelque chose qui équivaudrait à un “télos du consensus général”, reposant sur ce que Habermas appelle, sans rire, “les compétences interactionnelles post-conventionnelles”; au contraire, pour Lyotard, comme, en d’autres termes, pour Armin Mohler ou l’Ernst Jünger national-révolutionnaire des années 20, il faut constater qu’il y a toujours et partout “agonalité conflictuelle entre paroles diverses/divergentes”; si l’on s’obstine à vouloir enrayer les effets de cette agonalité et à effacer cette pluralité divergente, toutes deux objectives, toutes deux bien observables dans l’histoire, on fera basculer le monde entier sous la férule d’un “totalitarisme de la raison”, soit un “totalitarisme de la raison devenue folle à force d’être palabrante”, qui éliminera l’essence même de l’humanité comme kaléidoscope infini de peuples, de diversités d’expression; cette essence réside dans la pluralité ineffaçable des jeux de paroles diverses (cf. Ralf Bambach, “Jürgen Habermas”, in J. Nida-Rümelin (Hrsg.), “Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis v. Wright”, Kröner, Stuttgart, 1991; Yves Cusset, “Habermas – L’espoir de la discussion”, Michalon, coll. “Bien commun”, Paris, 2001).
En France, les vitupérations de Lévy dans “L’idéologie française” empêchent, in fine, de retourner, au-delà des thèses de l’Action Française, aux “grandes idées incontestables” qu’entendait sauver Hauriou (et qui suscitaient l’intérêt de Carl Schmitt), ce qui met la “République”, privée d’assises solides issues de son histoire, en porte-à-faux permanent avec des pays qui, comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Turquie ou la Chine façonnent leur agir politique sur l’échiquier international en se référant constamment à de “grandes idées incontestables”, semblables à celles évoquées par Hauriou. Ensuite, l’inquisition décrétée par ce Lévy, exécuteur testamentaire de Yahvé sur la place de Paris, interdit de (re)penser une économie différente (historique, institutionnaliste et régulationniste sur le plan de la théorie) au profit d’une population en voie de paupérisation, de déréliction et d’aliénation économique totale; une nouvelle économie correctrice ne peut que suivre les recettes issues des filons hétérodoxes de la pensée économique et donc de parachever certaines initiatives avortées du gaullisme de la fin des années 60 (idée de “participation” et d’”intéressement”, sénat des régions et des professions, etc.). Les fulminations inquisitoriales des Lévy et Habermas conduisent donc à l’impasse, à l’impossibilité, tant que leurs propagandes ne sont pas réduites à néant, de sortir des enlisements contemporains. De tous les enlisements où marinent désormais les régimes démocratiques occidentaux, aujourd’hui aux mains des baba-cools sâoulés de logorrhées habermassiennes et soixante-huitardes.
Habermas: contre l’idée prussienne et contre l’Etat ethnique
Habermas, dans le contexte allemand, combat en fait deux idées, deux visions de l’Etat et de la politique. Il combat l’idée prussienne, où l’Etat et la machine administrative, le fonctionnariat serviteur du peuple, dérivent d’un principe de “nation armée”. Notons que cette vision prussienne de l’Etat ne repose sur aucun a priori de type “ethnique” car l’armée de Frédéric II comprenait des hommes de toutes nationalités (Finnois, Slaves, Irlandais, Allemands, Hongrois, Huguenots français, Ottomans d’Europe, etc.). Notons également que Habermas, tout en se revendiquant bruyamment des “Lumières”, rejette, avec sa critique véhémente de l’idée prussienne, un pur produit des Lumières, de l’Aufklärung, qui avait rejeté bien des archaïsmes, devenus franchement inutiles, au siècle de son triomphe. Cette critique vise en fait toute forme d’Etat encadrant et durable, rétif au principe du bavardage perpétuel, pompeusement baptisé “agir communicationnel”. Simultanément, Habermas rejette les idéaux relevant des “autres Lumières”, celles de Herder, où le fondement du politique réside dans la “populité”, la “Volkheit”, soit le peuple (débarrassé d’aristocraties aux moeurs artificielles, déracinées et exotiques). Habermas, tout en se faisant passer pour l’exécuteur testamentaire des “philosophes des Lumières”, à l’instar de Bernard-Henri Lévy qui, lui, est l’exécuteur testamentaire de Yahvé en personne, jette aux orties une bonne partie de l’héritage philosophique du 18ème siècle. Avec ces deux compères, nous faisons face à la plus formidable escroquerie politico-philosophique du siècle! Ils veulent nous vendre comme seul produit autorisé l’Aufklärung mais ce qu’ils placent sur l’étal de leur boutique, c’est un Aufklärung homogénéisé, nettoyé des trois quarts de son contenu, cette tradition étant plurielle, variée, comme l’ont démontré des auteurs, non traduits, comme Peter Gay en Angleterre et Antonio Santucci en Italie (cf. Peter Gay, “The Enlightenment: An Interpretation – The Rise of Modern Paganism”, W. W. Norton & Company, New York/London, 1966-1977; Peter Gay, “The Enlightenment: An Interpretation – The Science of Freedom, Wildwood House, London, 1969-1979; Antonio Santucci (a cura di), “Interpretazioni dell’Illuminismo”, Il Mulino, Bologna, 1979; on se réfèrera aussi aux livres suivants: Léo Gershoy, “L’Europe des princes éclairés 1763-1789”, Gérard Montfort éd., Brionne, 1982; Michel Delon, “L”idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820)”, PUF, Paris, 1988).
Deux principes kantiens chez Herder
Cette option de Herder, qui est “populaire” ou “ethnique”, “ethno-centrée”, est aussi corollaire de la vision fraternelle d’une future Europe libérée, qui serait basée sur le pluralisme ethnique ou l’“ethnopluralisme”, où les peuples ne devraient plus passer par des filtres étrangers ou artificiels/abstraits pour faire valoir leurs droits ou leur identité culturelle. La vision herdérienne dérive bien des “Lumières” dans la mesure où elle fait siens deux principes kantiens; premier principe de Kant: “Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’autrui te fasse”; ce premier principe induit un respect des différences entre les hommes et interdit de gommer par décret autoritaire ou par manoeuvres politiques sournoises les traditions d’un peuple donné; deuxième principe kantien: “Sapere aude!”, “Ose savoir!”, autrement dit: libère-toi des pesanteurs inutiles, débarrasse-toi du ballast accumulé et encombrant, de tous les filtres inutiles, qui t’empêchent d’être toi-même! Ce principe kantien, réclamant l’audace du sujet pensant, Herder le fusionne avec l’adage grec “Gnôthi seautôn!”, “Connais-toi toi-même”. Pour parfaire cette fusion, il procède à une enquête générale sur les racines de la littérature, et de la culture de son temps et des temps anciens, en n’omettant pas les pans entiers de nos héritages qui avaient été refoulés par le christianisme, le dolorisme chrétien, la scolastique figée, le cartésianisme abscons, le blabla des Lumières palabrantes, le classicisme répétitif et académique, etc., comme nous devrions nous aussi, sans jamais nous arrêter, procéder à ce type de travail archéologique et généalogique, cette fois contre la “pensée unique”, le “politiquement correct” et le pseudo-testament de Yahvé.

Définition de la “Bildung”
Dans la perspective ouverte par Herder, les fondements de l’Etat sont dès lors le peuple, héritier de son propre passé, la culture et la littérature que ce peuple a produites et les valeurs éthiques que cette culture transmet et véhicule. En bref, nous aussi, nous sommes héritiers des Lumières, non pas de celles du jacobinisme ou celles que veut nous imposer le système aujourd’hui, mais de ces “autres Lumières”. Saint-Loup, en critiquant le christianisme et le modèle occidental (soit, anticipativement, les “Lumières” tronquées de BHL et d’Habermas) s’inscrit dans le filon herdérien, sans jamais retomber dans des formes sclérosantes de “tu dois!”. “Sapere aude!” est également pour lui un impératif, lié à la belle injonction grecque “Gnôthi seautôn!”. Toujours dans cette perspective herdérienne, l’humanité n’est pas une panade zoologique d’êtres humains homogénéisés par la mise en oeuvre, disciplinante et sévère, d’idées abstraites, mais un ensemble de groupes humains diversifiés, souvent vastes, qui explorent en permanence et dans la joie leurs propres racines, comme les “humanités” gréco-latines nous permettent d’explorer nos racines d’avant la chrisitanisation. Pour Herder, il faut un retour aux Grecs, mais au-delà de toutes les édulcorations “ad usum Delphini”; ce retour ne peut donc déboucher sur un culte stéréotypé de la seule antiquité classique, il faut qu’il soit flanqué d’un retour aux racines germaniques dans les pays germaniques et scandinaves, au fond celtique dans les pays de langues gaëliques, aux traditions slaves dans le monde slave. Le processus d’auto-centrage des peuples, de mise en adéquation permanente avec leur fond propre, s’effectue par le truchement de la “Bildung”. Ce terme allemand dérive du verbe “bilden”, “construire”. Je me construis moi-même, et mon peuple se construit lui-même, en cherchant en permanence l’adéquation à mes racines, à ses racines. La “Bildung” consiste à chercher dans ses racines les recettes pour arraisonner le réel et ses défis, dans un monde soumis à la loi perpétuelle du changement.
Pour Herder, représentant emblématique des “autres Lumières”, le peuple, c’est l’ensemble des “Bürger”, terme que l’on peut certes traduire par “bourgeois” mais qu’il faut plutôt traduire par le terme latin “civis/cives”, soit “citoyen”, “membre du corps du peuple”. Le terme “bourgeois”, au cours du 19ème siècle, ayant acquis une connotation péjorative, synonyme de “rentier déconnecté” grenouillant en marge du monde réel où l’on oeuvre et où l’on souffre. Pour Herder, le peuple est donc l’ensemble des paysans, des artisans et des lettrés. Les paysans sont les dépositaires de la tradition vernaculaire, la classe nourricière incontournable. Les artisans sont les créateurs de biens matériels utiles. Les lettrés sont, eux, les gardiens de la mémoire. Herder exclut de sa définition du “peuple” l’aristocratie, parce qu’est s’est composé un monde artificiel étranger aux racines, et les “déclassés” ou “hors classe”, qu’il appelle la “canaille” et qui est imperméable à toute transmission et à toute discipline dans quelque domaine intellectuel ou pratique que ce soit. Cette exclusion de l’aristocratie explique notamment le républicanisme ultérieur des nationalismes irlandais et flamand, qui rejettent tous deux l’aristocratie et la bourgeoisie anglicisées ou francisées. Sa définition est injuste pour les aristocraties liées aux terroirs, comme dans le Brandebourg prussien (les “Krautjunker”), la Franche-Comté (où les frontières entre la noblesse et la paysannerie sont ténues et poreuses) et les Ardennes luxembourgeoises de parlers romans.
Une formidable postérité intellectuelle
 L’oeuvre de Herder a connu une formidable postérité intellectuelle. Pour l’essentiel, toute l’érudition historique du 19ème siècle, toutes les avancées dans les domaines de l’archéologie, de la philologie et de la linguistique, lui sont redevables. En Allemagne, la quête archéo-généalogique de Herder se poursuit avec Wilhelm Dilthey, pour qui les manifestations du vivant (et donc de l’histoire), échappent à toute définition figeante, les seules choses définissables avec précision étant les choses mortes: tant qu’un phénomène vit, il échappe à toute définition; tant qu’un peuple vit, il ne peut entrer dans un corset institutionnel posé comme définitif et toujours condamné, à un moment donné du devenir historique, à se rigidifier. Nietzsche appartient au filon ouvert par Herder dans la mesure où la Grèce qu’il entend explorer et réhabiliter est celle des tragiques et des pré-socratiques, celle qui échappe justement à une raison trop étriquée, trop répétitive, celle qui chante en communauté les hymnes à Dionysos, dans le théâtre d’Athènes, au flanc de l’Acropole, ou dans celui d’Epidaure. Les engouements folcistes (= “völkisch”), y compris ceux que l’on peut rétrospectivement qualifier d’exagérés ou de “chromomorphes”, s’inscrivent à leur tour dans la postérité de Herder. Pour le Professeur anglais Barnard, exégète minutieux de l’oeuvre de Herder, sa pensée n’a pas eu de grand impact en France; cependant, toute une érudition archéo-généalogique très peu politisée (et donc, à ce titre, oubliée), souvent axée sur l’histoire locale, mérite amplement d’être redécouverte en France, notamment à la suite d’une historienne et philologue comme Nicole Belmont (cf. “Paroles païennes – Mythe et folklore”, Imago, Paris, 1986). Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-1895) (photo), selon une méthode préconisée par les frères Grimm, rassemble dans un recueil les chants populaires de Bretagne, sous le titre de “Barzaz Breiz” en 1836. Hippolyte Taine ou Augustin Thierry, quand ils abordent l’histoire des Francs, l’époque mérovingienne ou les origines de la France d’Ancien Régime effectuent un travail archéo-généalogique, “révolutionnaire” dans la mesure où ils lancent des pistes qui dépassent forcément les répétitions et les fixismes, les ritournelles et les rengaines des pensées scolastiques, cartésiennes ou illuministes-républicaines. Aujourd’hui, Micberth (qui fut le premier à utiliser le terme “nouvelle droite” dans un contexte tout à fait différent de celui de la “nouvelle droite” qui fit la une des médias dès l’année 1979) publie des centaines de monographies, rédigées par des érudits du 19ème et du début du 20ème, sur des villages ou de petites villes de France, où l’on retrouve des trésors oubliées et surtout d’innombrables pistes laissées en jachère. Enfin, l’exégète des oeuvres de Herder, Max Rouché, nous a légué des introductions bien charpentées à leurs éditions françaises, parus en édition bilingue chez Aubier-Montaigne.
L’oeuvre de Herder a connu une formidable postérité intellectuelle. Pour l’essentiel, toute l’érudition historique du 19ème siècle, toutes les avancées dans les domaines de l’archéologie, de la philologie et de la linguistique, lui sont redevables. En Allemagne, la quête archéo-généalogique de Herder se poursuit avec Wilhelm Dilthey, pour qui les manifestations du vivant (et donc de l’histoire), échappent à toute définition figeante, les seules choses définissables avec précision étant les choses mortes: tant qu’un phénomène vit, il échappe à toute définition; tant qu’un peuple vit, il ne peut entrer dans un corset institutionnel posé comme définitif et toujours condamné, à un moment donné du devenir historique, à se rigidifier. Nietzsche appartient au filon ouvert par Herder dans la mesure où la Grèce qu’il entend explorer et réhabiliter est celle des tragiques et des pré-socratiques, celle qui échappe justement à une raison trop étriquée, trop répétitive, celle qui chante en communauté les hymnes à Dionysos, dans le théâtre d’Athènes, au flanc de l’Acropole, ou dans celui d’Epidaure. Les engouements folcistes (= “völkisch”), y compris ceux que l’on peut rétrospectivement qualifier d’exagérés ou de “chromomorphes”, s’inscrivent à leur tour dans la postérité de Herder. Pour le Professeur anglais Barnard, exégète minutieux de l’oeuvre de Herder, sa pensée n’a pas eu de grand impact en France; cependant, toute une érudition archéo-généalogique très peu politisée (et donc, à ce titre, oubliée), souvent axée sur l’histoire locale, mérite amplement d’être redécouverte en France, notamment à la suite d’une historienne et philologue comme Nicole Belmont (cf. “Paroles païennes – Mythe et folklore”, Imago, Paris, 1986). Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-1895) (photo), selon une méthode préconisée par les frères Grimm, rassemble dans un recueil les chants populaires de Bretagne, sous le titre de “Barzaz Breiz” en 1836. Hippolyte Taine ou Augustin Thierry, quand ils abordent l’histoire des Francs, l’époque mérovingienne ou les origines de la France d’Ancien Régime effectuent un travail archéo-généalogique, “révolutionnaire” dans la mesure où ils lancent des pistes qui dépassent forcément les répétitions et les fixismes, les ritournelles et les rengaines des pensées scolastiques, cartésiennes ou illuministes-républicaines. Aujourd’hui, Micberth (qui fut le premier à utiliser le terme “nouvelle droite” dans un contexte tout à fait différent de celui de la “nouvelle droite” qui fit la une des médias dès l’année 1979) publie des centaines de monographies, rédigées par des érudits du 19ème et du début du 20ème, sur des villages ou de petites villes de France, où l’on retrouve des trésors oubliées et surtout d’innombrables pistes laissées en jachère. Enfin, l’exégète des oeuvres de Herder, Max Rouché, nous a légué des introductions bien charpentées à leurs éditions françaises, parus en édition bilingue chez Aubier-Montaigne.
Irlande, Flandre et Scandinavie
 Le nationalisme irlandais est l’exemple même d’un nationalisme de matrice “herdérienne”. La figure la plus emblématique de l’ “herdérianisation” du nationalisme irlandais demeure Thomas Davis, né en 1814. Bien qu’il ait été un protestant d’origine anglo-galloise, son nationalisme irlandais propose surtout de dépasser les clivages religieux qui divisent l’Ile Verte, et d’abandonner l’utilitarisme, idéologie dominante en Angleterre au début du 19ème siècle. Le nationalisme irlandais est donc aussi une révolte contre le libéralisme utilitariste; l’effacer de l’horizon des peuples est dès lors la tâche exemplaire qui l’attend, selon Thomas Davis. Ecoutons-le: “L’anglicanisme moderne, c’est-à-dire l’utilitarisme, les idées de Russell et de Peel ainsi que celles des radicaux, que l’on peut appler ‘yankeeïsme’ ou ‘anglichisme’, se borne à mesurer la prospérité à l’aune de valeurs échangeables, à mesurer le devoir à l’aune du gain, à limiter les désirs [de l’homme] aux fringues, à la bouffe et à la [fausse] respectabilité; cette malédiction [anglichiste] s’est abattue sur l’Irlande sous le règne des Whigs mais elle est aussi la malédiction favorite des Tories à la Peel” (cité in: D. George Boyce, “Nationalism in Ireland”, Routledge, London, 1995, 3ème éd.). Comme Thomas Carlyle, Thomas Davis critique l’étranglement mental des peuples des Iles Britanniques par l’utilitarisme ou la “shop keeper mentality”; inspiré par les idées du romantisme nationaliste allemand, dérivé de Herder, il explique à ses compatriotes qu’un peuple, pour se dégager de la “néo-animalité” utilitariste, doit cesser de se penser non pas comme un “agglomérat accidentel” de personnes d’origines disparates habitant sur un territoire donné, mais comme un ensemble non fortuit d’hommes et de femmes partageant une culture héritée de longue date et s’exprimant par la littérature, par l’histoire et surtout, par la langue. Celle-ci est le véhicule de la mémoire historique d’un peuple et non pas un ensemble accidentel de mots en vrac ne servant qu’à une communication élémentaire, “utile”, comme tente de le faire croire l’enseignement dévoyé d’aujourd’hui quand il régule de manière autoritaire (sans en avoir l’air... à grand renfort de justifications pseudo-pédagogiques boiteuses...) et maladroite (en changeant d’avis à tour de bras...) l’apprentissage des langues maternelles et des langues étrangères, réduisant leur étude à des tristes répétitions de banalités quotidiennes vides de sens. Davis: “La langue qui évolue avec le peuple est conforme à ses origines; elle décrit son climat, sa constitution et ses moeurs; elle se mêle inextricablement à son histoire et à son âme...” (cité par D. G. Boyce, op. cit.).
Le nationalisme irlandais est l’exemple même d’un nationalisme de matrice “herdérienne”. La figure la plus emblématique de l’ “herdérianisation” du nationalisme irlandais demeure Thomas Davis, né en 1814. Bien qu’il ait été un protestant d’origine anglo-galloise, son nationalisme irlandais propose surtout de dépasser les clivages religieux qui divisent l’Ile Verte, et d’abandonner l’utilitarisme, idéologie dominante en Angleterre au début du 19ème siècle. Le nationalisme irlandais est donc aussi une révolte contre le libéralisme utilitariste; l’effacer de l’horizon des peuples est dès lors la tâche exemplaire qui l’attend, selon Thomas Davis. Ecoutons-le: “L’anglicanisme moderne, c’est-à-dire l’utilitarisme, les idées de Russell et de Peel ainsi que celles des radicaux, que l’on peut appler ‘yankeeïsme’ ou ‘anglichisme’, se borne à mesurer la prospérité à l’aune de valeurs échangeables, à mesurer le devoir à l’aune du gain, à limiter les désirs [de l’homme] aux fringues, à la bouffe et à la [fausse] respectabilité; cette malédiction [anglichiste] s’est abattue sur l’Irlande sous le règne des Whigs mais elle est aussi la malédiction favorite des Tories à la Peel” (cité in: D. George Boyce, “Nationalism in Ireland”, Routledge, London, 1995, 3ème éd.). Comme Thomas Carlyle, Thomas Davis critique l’étranglement mental des peuples des Iles Britanniques par l’utilitarisme ou la “shop keeper mentality”; inspiré par les idées du romantisme nationaliste allemand, dérivé de Herder, il explique à ses compatriotes qu’un peuple, pour se dégager de la “néo-animalité” utilitariste, doit cesser de se penser non pas comme un “agglomérat accidentel” de personnes d’origines disparates habitant sur un territoire donné, mais comme un ensemble non fortuit d’hommes et de femmes partageant une culture héritée de longue date et s’exprimant par la littérature, par l’histoire et surtout, par la langue. Celle-ci est le véhicule de la mémoire historique d’un peuple et non pas un ensemble accidentel de mots en vrac ne servant qu’à une communication élémentaire, “utile”, comme tente de le faire croire l’enseignement dévoyé d’aujourd’hui quand il régule de manière autoritaire (sans en avoir l’air... à grand renfort de justifications pseudo-pédagogiques boiteuses...) et maladroite (en changeant d’avis à tour de bras...) l’apprentissage des langues maternelles et des langues étrangères, réduisant leur étude à des tristes répétitions de banalités quotidiennes vides de sens. Davis: “La langue qui évolue avec le peuple est conforme à ses origines; elle décrit son climat, sa constitution et ses moeurs; elle se mêle inextricablement à son histoire et à son âme...” (cité par D. G. Boyce, op. cit.).
 Catholique, l’Irlande profonde réagit contre la colonisation puritaine, achevée par Cromwell au 17ème siècle. Le chantre d’un “homo celticus” ou “hibernicus”, différent du puritain anglais ou de l’utilitariste du 19ème siècle, sera indubitablement Padraig Pearse (1879-1916). Son nationalisme mystique vise à faire advenir en terre d’Irlande un homme non pas “nouveau”, fabriqué dans un laboratoire expérimental qui fait du passé table rase, mais renouant avec des traditions immémoriales, celles du “Gaël”. Pearse: “Le Gaël n’est pas comme les autres hommes, la bêche et le métier à tisser, et même l’épée, ne sont pas pour lui. Mais c’est une destinée plus glorieuse encore que celle de Rome qui l’attend, plus glorieuse aussi que celle de Dame Britannia: il doit devenir le sauveur de l’idéalisme dans la vie moderne, intellectuelle et sociale” (cité in: F. S. L. Lyons, “Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939”, Oxford University Press, 1982). Pearse, de parents anglais, se réfère à la légende du héros païen Cuchulainn, dont la devise était: “Peu me chaut de ne vivre qu’un seul jour et qu’une seule nuit pourvu que ma réputation (fama) et mes actes vivent après moi”. Cette concession d’un catholique fervent au paganisme celtique (du moins au mythe de Cuchulainn) se double d’un culte de Saint Columcille, le moine et missionnaire qui appartenait à l’ordre des “Filid” (des druides après la christianisation) et entendait sauvegarder sous un travestissement chrétien les mystères antiques et avait exigé des chefs irlandais de faire construire des établissements pour qu’on puisse y perpétuer les savoirs disponibles; à ce titre, Columcille, en imposant la construction d’abbayes-bibliothèques en dur, a sauvé une bonne partie de l’héritage antique. Pearse: “L’ancien système irlandais, qu’il ait été païen ou chrétien, possédait, à un degré exceptionnel, la chose la plus nécessaire à l’éducation: une inspiration adéquate. Columcille nous a fait entendre ce que pouvait être cette inspiration quand il a dit: ‘si je meurs, ce sera de l’excès d’amour que je porte en moi, en tant que Gaël’. Un amour et un sens du service si excessif qu’il annihile toute pensée égoïste, cette attitude, c’est reconnaître que l’on doit tout donner, que l’on doit être toujours prêt à faire le sacrifice ultime: voilà ce qui a inspiré le héros Cuchulainn et le saint Columcille; c’est l’inspiration qui a fait de l’un un héros, de l’autre, un saint” (cité par F. S. L. Lyons, op. cit.). Chez Pearse, le mysticisme pré-chrétien et la ferveur d’un catholicisme rebelle fusionnent dans un culte du sang versé. La rose noire, symbole de l’Irlande humiliée, privée de sa liberté et de son identité, deviendra rose rouge et vivante, resplendissante, par le sang des héros qui la coloreront en se sacrifiant pour elle. Cette mystique de la “rose rouge” était partagée par trois martyrs de l’insurrection des Pâques 1916: Pearse lui-même, Thomas MacDonagh et Joseph Plunkett. On peut vraiment dire que cette vision mystique et poétique a été prémonitoire.
Catholique, l’Irlande profonde réagit contre la colonisation puritaine, achevée par Cromwell au 17ème siècle. Le chantre d’un “homo celticus” ou “hibernicus”, différent du puritain anglais ou de l’utilitariste du 19ème siècle, sera indubitablement Padraig Pearse (1879-1916). Son nationalisme mystique vise à faire advenir en terre d’Irlande un homme non pas “nouveau”, fabriqué dans un laboratoire expérimental qui fait du passé table rase, mais renouant avec des traditions immémoriales, celles du “Gaël”. Pearse: “Le Gaël n’est pas comme les autres hommes, la bêche et le métier à tisser, et même l’épée, ne sont pas pour lui. Mais c’est une destinée plus glorieuse encore que celle de Rome qui l’attend, plus glorieuse aussi que celle de Dame Britannia: il doit devenir le sauveur de l’idéalisme dans la vie moderne, intellectuelle et sociale” (cité in: F. S. L. Lyons, “Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939”, Oxford University Press, 1982). Pearse, de parents anglais, se réfère à la légende du héros païen Cuchulainn, dont la devise était: “Peu me chaut de ne vivre qu’un seul jour et qu’une seule nuit pourvu que ma réputation (fama) et mes actes vivent après moi”. Cette concession d’un catholique fervent au paganisme celtique (du moins au mythe de Cuchulainn) se double d’un culte de Saint Columcille, le moine et missionnaire qui appartenait à l’ordre des “Filid” (des druides après la christianisation) et entendait sauvegarder sous un travestissement chrétien les mystères antiques et avait exigé des chefs irlandais de faire construire des établissements pour qu’on puisse y perpétuer les savoirs disponibles; à ce titre, Columcille, en imposant la construction d’abbayes-bibliothèques en dur, a sauvé une bonne partie de l’héritage antique. Pearse: “L’ancien système irlandais, qu’il ait été païen ou chrétien, possédait, à un degré exceptionnel, la chose la plus nécessaire à l’éducation: une inspiration adéquate. Columcille nous a fait entendre ce que pouvait être cette inspiration quand il a dit: ‘si je meurs, ce sera de l’excès d’amour que je porte en moi, en tant que Gaël’. Un amour et un sens du service si excessif qu’il annihile toute pensée égoïste, cette attitude, c’est reconnaître que l’on doit tout donner, que l’on doit être toujours prêt à faire le sacrifice ultime: voilà ce qui a inspiré le héros Cuchulainn et le saint Columcille; c’est l’inspiration qui a fait de l’un un héros, de l’autre, un saint” (cité par F. S. L. Lyons, op. cit.). Chez Pearse, le mysticisme pré-chrétien et la ferveur d’un catholicisme rebelle fusionnent dans un culte du sang versé. La rose noire, symbole de l’Irlande humiliée, privée de sa liberté et de son identité, deviendra rose rouge et vivante, resplendissante, par le sang des héros qui la coloreront en se sacrifiant pour elle. Cette mystique de la “rose rouge” était partagée par trois martyrs de l’insurrection des Pâques 1916: Pearse lui-même, Thomas MacDonagh et Joseph Plunkett. On peut vraiment dire que cette vision mystique et poétique a été prémonitoire.
En dépit de son “papisme”, l’Irlande embraye donc sur le renouveau celtique, néo-païen, né au Pays de Galles à la fin du 18ème, où les “identitaires” gallois de l’époque réaniment la tradition des fêtes populaires de l’Eisteddfod, dont les origines remontent au 12ème siècle. Plus tard, les reminiscences celtiques se retrouvent chez des poètes comme Yeats, pourtant de tradition familiale protestante, et comme Padraig Pearse (que je viens de citer et auquel Jean Mabire a consacré une monographie), fusillé après le soulèvement de Pâques 1916. En Flandre, la renaissance d’un nationalisme vernaculaire, le premier recours conscient aux racines locales et vernaculaires via une volonté de sauver la langue populaire du naufrage, s’inscrit, dès son premier balbutiement, dans la tradition des “autres Lumières”, non pas directement de Herder mais d’une approche “rousseauiste” et “leibnizienne” (elle reprend —outre l’idée rousseauiste d’émancipation réinsérée dans une histoire populaire réelle et non pas laissée dans une empyrée désincarnée— l’idée d’une appartenance oubliée à l’ensemble des peuples “japhétiques”, c’est-à-dire indo-européens, selon Leibniz): cette approche est parfaitement décelable dans le manifeste de 1788 rédigé par Jan-Baptist Verlooy avant la “révolution brabançonne” de 1789 (qui contrairement à la révolution de Paris était “intégriste catholique” et dirigée contre les Lumières des Encyclopédistes). L’érudition en pays de langues germaniques s’abreuvera à la source herdérienne, si bien, que l’on peut aussi qualifier le mouvement flamand de “herdérien”. Il tire également son inspiration du roman historique écossais (Walter Scott), expression d’une rébellion républicaine calédonienne, d’inspiration panceltique avant la lettre. En effet, Hendrik Conscience avait lu Scott, dont le style narratif et romantique lui servira de modèle pour le type de roman national flamando-belge qu’il entendait produire, juste avant d’écrire son célèbre “Lion des Flandres” (= “De Leeuw van Vlaanderen”). Les Allemands Hoffmann von Fallersleben et Oetker recueilleront des récits populaires flamands selon la méthode inaugurée par les Frères Grimm dans le Nord de la Hesse, le long d’une route féérique que l’on appelle toujours la “Märchenstrasse” (“La route des contes”). De nos jours encore, il existe toute une érudition flamande qui repose sur les mêmes principes archéo-généalogiques.
L’idéal de l’Odelsbonde
En Scandinavie, la démarche archéo-généalogique de Herder fusionne avec des traditions locales norvégiennes ou danoises (avec Grundvigt, dont l’itinéraire fascinait Jean Mabire). La tradition politique scandinave, avec sa survalorisation du paysannat (surtout en Norvège), dérive directement de postulats similaires, les armées norvégiennes, au service des monarques suédois ou danois, étant constituées de paysans libres, sans caste aristocratique distincte du peuple et en marge de lui (au sens où on l’entendait dans la France de Louis XV, par exemple, quand on ne tenait pas compte des paysannats libres locaux). L’idéal humain de la tradition politique norvégienne, jusque chez un Knut Hamsun, est celui de l’Odelsbonde, du “paysan libre” arcbouté sur son lopin ingrat, dont il tire librement sa subsistance, sous un climat d’une dureté cruelle. Les musées d’Oslo exaltent cette figure centrale, tout en diffusant un ethnopluralisme sainement compris: le même type d’érudition objective est mis au service des peuples non indo-européens de l’espace circumpolaire, comme les Sami finno-ougriens.
L’actualité montre que cette double tradition herdérienne et grundvigtienne en Scandinavie, flanquée de l’idéal de l’Odelsbonde demeure vivace et qu’elle peut donner des leçons de véritable démocratie (il faudrait dire: “de laocratie”, “laos” étant le véritable substantif désignant le meilleur du peuple en langue grecque) à nos démocrates auto-proclamés qui hissent les catégories les plus abjectes de la population au-dessus du peuple réel, c’est-à-dire au-dessus des strates positives de la population qui oeuvrent en cultivant le sol, en produisant de leurs mains des biens nécessaires et de bonne qualité ou en transmettant le savoir ancestral. Seules ces dernières castes sont incontournables et nécessaires au bon fonctionnement d’une société. Les autres, celles qui tiennent aujourd’hui le haut du pavé, sont parasitaires et génèrent des comportements anti-laocratiques: le peuple d’Islande l’a compris au cours de ces deux ou trois dernières années; il a flanqué ses banquiers et les politicards véreux, qui en étaient les instruments, au trou après la crise de l’automne 2008. Résultat: l’Islande se porte bien. Elle a redressé la barre et se développe. Les strates parasitaires ont été matées. Nos pays vont mal: les banquiers et leurs valets politiciens tirent leur révérence en empochant la manne de leurs “parachutes dorés”. Aucun cul de basse-fosse ne leur sert de logis bien mérité. Dès lors tout vaut tout et tout est permis (pourquoi faudrait-il désormais sanctionner l’ado qui pique un portable à l’étal d’un “Media-Markt”, si un patapouf comme Dehaene fout le camp après son interminable cortège de gaffes avec, en son escarcelle, des milliards de dédommagements non mérités?). Les principes les plus élémentaires d’éthique sont foulés aux pieds.
Tradition “herdérienne” dans les pays slaves
 Dans les pays slaves, la tradition archéo-généalogique de Herder s’est maintenue tout au long du 19ème siècle et a même survécu sous les divers régimes communistes, imposés en 1917 ou en 1945-48. Chez les Tchèques, elle a sauvé la langue de l’abâtardissement mais s’est retournée paradoxalement contre l’Allemagne, patrie de Herder, et contre l’Autriche-Hongrie. Chez les Croates et les Serbes, elle a toujours manifesté sa présence, au grand dam des éradicateurs contemporains; en effet, les porteurs de l’idéal folciste sud-slave ont été vilipendés par Alain Finkelkraut lors de la crise yougoslave du début des années 90 du 20ème siècle, sous prétexte que ces érudits et historiens auraient justifié à l’avance les “épurations ethniques” du récent conflit inter-yougoslave, alors que le journaliste et slaviste israélite autrichien Wolfgang Libal considérait dans son livre “Die Serben”, publié au même moment, que ces figures, vouées aux gémonies par Finkelkraut et les autres maniaques parisiens du “politiquement correct” et du “prêt-à-penser”, étaient des érudits hors pair et des apôtres de la libération laocratique de leurs peuples, notamment face à l’arbitraire ottoman... Vous avez dit “bricolage médiatique”? En Russie, l’héritage de Herder a donné les slavophiles ou “narodniki”, dont la tradition est demeurée intacte aujourd’hui, en dépit des sept décennies de communisme. Des auteurs contemporains comme Valentin Raspoutine ou Alexandre Soljénitsyne en sont tributaires. Le travail de nos amis Ivanov, Avdeev et Toulaev également.
Dans les pays slaves, la tradition archéo-généalogique de Herder s’est maintenue tout au long du 19ème siècle et a même survécu sous les divers régimes communistes, imposés en 1917 ou en 1945-48. Chez les Tchèques, elle a sauvé la langue de l’abâtardissement mais s’est retournée paradoxalement contre l’Allemagne, patrie de Herder, et contre l’Autriche-Hongrie. Chez les Croates et les Serbes, elle a toujours manifesté sa présence, au grand dam des éradicateurs contemporains; en effet, les porteurs de l’idéal folciste sud-slave ont été vilipendés par Alain Finkelkraut lors de la crise yougoslave du début des années 90 du 20ème siècle, sous prétexte que ces érudits et historiens auraient justifié à l’avance les “épurations ethniques” du récent conflit inter-yougoslave, alors que le journaliste et slaviste israélite autrichien Wolfgang Libal considérait dans son livre “Die Serben”, publié au même moment, que ces figures, vouées aux gémonies par Finkelkraut et les autres maniaques parisiens du “politiquement correct” et du “prêt-à-penser”, étaient des érudits hors pair et des apôtres de la libération laocratique de leurs peuples, notamment face à l’arbitraire ottoman... Vous avez dit “bricolage médiatique”? En Russie, l’héritage de Herder a donné les slavophiles ou “narodniki”, dont la tradition est demeurée intacte aujourd’hui, en dépit des sept décennies de communisme. Des auteurs contemporains comme Valentin Raspoutine ou Alexandre Soljénitsyne en sont tributaires. Le travail de nos amis Ivanov, Avdeev et Toulaev également.
En Bretagne, le réveil celtique, après 1918, s’inscrit dans le sillage du celtisme irlandais et de toutes les tentatives de créer un mouvement panceltique pour le bien des “Six Nations” (Irlandais, Gallois, Gaëliques écossais, Manxois, Corniques et Bretons), un panceltisme dûment appuyé, dès le lendemain de la défaite allemande de 1945, par le nouvel Etat irlandais dominé par le Fianna Fail d’Eamon de Valera et par le ministre irlandais Sean MacBride, fils d’un fusillé de 1916. La tradition archéo-généalogique de Herder, d’où dérive l’idéal de “patrie charnelle” et le rejet de tous les mécanismes anti-laocratiques visant à infliger aux peuples une domination abstraite sous un masque “démocratique” ou non, est immensément riche en diversités. Sa richesse est même infinie. Tout mouvement identitaire, impliquant le retour à la terre et au peuple, aux facteurs sang et sol de la méthode historique d’Hyppolite Taine, à l’agonalité entre “paroles diverses” (Lyotard), est un avatar de cette immense planète de la pensée, toute tissée d’érudition. Si un Jean Haudry explore la tradition indo-européenne et son émergence à l’ère proto-historique, si un Pierre Vial exalte les oeuvres de Jean Giono ou d’Henri Vincenot ou si un Jean Mabire évoque une quantité impressionnante d’auteurs liés à leurs terres ou chante la geste des “éveilleurs de peuple”, ils sont des disciples de Herder et des chantres des patries charnelles. Ils ne cherchent pas les fondements du politique dans des idées figées et toutes faites ni n’inscrivent leurs démarches dans une métapolitique aggiornamenté, qui se voudrait aussi une culture du “débat”, un “autre débat” peut-être, mais qui ne sera jamais qu’une sorte d’ersatz plus ou moins “droitisé”, vaguement infléchi de quelques misérables degrés vers une droite de conviction, un ersatz à coup sûr parisianisé de ces “palabres rationnels” de Habermas qui ont tant envahi nos médias, nos hémicycles politiques, nos innombrables commissions qui ne résolvent rien.
Robert STEUCKERS.
Avec la nostalgie du “Grand Lothier”, Forest-Flotzenberg & Nancy, mars 2012.
00:15 Publié dans Définitions, Nouvelle Droite, Philosophie, Révolution conservatrice, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : patrie charnelle, saint-loup, herder, habermas, bernard henri lévy, nouvelle droite, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, racines, terroirs, glèbe, enracinement, robert steuckers |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 mars 2013
Roberto Michels: un socialismo verdaderamente superador de las oligarquías
Roberto Michels: un socialismo verdaderamente superador de las oligarquías
Alessandro Campi
http://alternativaeuropeaasociacioncultural.wordpress.com/
1. Roberto Michels, un hombre, una carrera
Recientemente (1), pudimos celebrar el cincuenta aniversario de la muerte de Roberto Michels, el gran sociólogo italo-germano, principal representante, junto a Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, de la escuela “elitista” italiana. Michels nació en Colonia (Köln) en 1876, en el seno de una familia de ricos comerciantes de ascendencia alemana, flamenca y francesa. Tras los estudios iniciados en el Liceo francés de Berlín y proseguidos en Inglaterra, en Francia y en la capital de Baviera, Munich, obtiene su doctorado en Halle en 1900, bajo la égida de Droysen, gracias a una tesis entorno a la argumentación histórica. Desde su primera juventud, milita activamente en el seno del partido socialista, lo cual le granjea la hostilidad de las autoridades académicas y dificulta considerablemente su inserción en los medios universitarios. En 1901, gracias al apoyo de Max Weber, obtiene su primer puesto de profesor en la Universidad de Marburgo.
Sus contactos con los medios socialistas belgas, italianos y franceses son numerosos y estrechos. Entre 1904 y 1908, colabora en el mensual francés Le Mouvement socialiste (“El Movimiento socialista”) y participa, en calidad de delegado, en diversos congresos social-demócratas. Este período resulta decisivo para Michels, pues entra en contacto con Georges Sorel, Edouard Berth y los sindicalistas revolucionarios italianos Arturo Labriola y Enrico Leone. Bajo su influencia, empieza a perfilarse el proceso de revisión del marxismo teórico así como la crítica del reformismo de los dirigentes socialistas. La concepción activista, voluntarista y antiparlamentaria que Michels tiene del socialismo no se concilia en absoluto con la involución parlamentarista y burocrática del movimiento social-demócrata. Este hiato le lleva a abandonar gradualmente la política activa y a intensificar sus investigaciones científicas. A partir de 1905, Max Weber le invita para que colabore en la prestigiosa revista Archiv tur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. En 1907, obtiene una cátedra en la Universidad de Turín, en la cual entra en contacto con Mosca, con el economista Einaudi y con el antropólogo Lombroso. En este fecundo clima universitario, va tomando cuerpo el proyecto de su obra fundamental, Zur Soziologie des Parteiwesens. Durante la guerra de Trípoli, Michels toma partido a favor de los proyectos imperiales de Italia y contra el expansionismo alemán. De este modo, empieza su acercamiento hacia el movimiento nacionalista italiano; si bien, obviamente, no es de extrañar, sus relaciones con Max Weber se deterioran irremediablemente.
• Un trabajo fecundo, durante el período italiano
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, en 1914, se instala en la Universidad de Basilea, Suiza. Es el período durante el cual Michels estrecha sus lazos con Pareto y con el economista Maffeo Pantaleoni. En 1922, saluda con simpatía la victoria de Benito Mussolini y del Fascismo. Vuelve definitivamente a Italia en 1928 para asumir la cátedra de Economía General en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Perugia. Al mismo tiempo, imparte como enseñante en el Instituto Cesare Alfieri de Florencia. Además, en aquella época, ofrece numerosas conferencias y cursos tanto en Italia como allende las fronteras de ésta, por toda Europa. Sus artículos aparecen en la famosa Encyclopaedia of the Social Sciences (1931). Finalmente, muere en Roma a la edad de sesenta años, el 2 de Mayo de 1936.
Hombre de una vastísima cultura, educado en un medio cosmopolita, atento observador de los diversos movimientos políticos y sociales europeos habidos a caballo entre los siglos XIX y XX, Michels fue, por otra parte, un historiador del socialismo europeo, un crítico de la democracia parlamentaria y un analista de los distintos tipos de organización social, un teórico del sindicalismo revolucionario y del nacionalismo, así como un historiador de la economía y del imperialismo italiano. Del mismo modo, sus inquietudes e intereses le llevaron a estudiar el Fascismo, los fenómenos de la emigración, el pensamiento corporativista y los orígenes del capitalismo. A su manera, continuó en el proceso de profundización de la psicología política creado por Gustave Le Bon y se interesó, a este respecto, por el comportamiento de las masas obreras politizadas. Igualmente, abordó ciertos temas que, en su época, pasaban por ser más bien excéntricos o heterodoxos, tales como el estudio de las relaciones entre moral sexual y clases sociales, de los lazos entre la actividad laboriosa y el espíritu de la raza, de la nobleza europea, del comportamiento de los intelectuales y esbozó, asimismo, un primer cuadro del movimiento feminista. Además, no olvidemos en esta enumeración, mencionar sus estudios estadísticos, tanto en economía como en demografía, notablemente con respecto al control de los nacimientos y otras cuestiones interrelacionadas.
2. El redescubrimiento de una obra
Como he señalado anteriormente, su libro más importante y más conocido lleva por título, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie; fue publicado por primera vez en 1911 y por segunda vez en 1925 (siendo esta edición la edición definitiva). Se trata de un estudio sistemático, consagrado a las relaciones entre la democracia y los partidos, a la selección de las clases políticas, a las relaciones entre las minorías activas y las masas y al “leadership”. La bibliografía de Michels comprende treinta libros y cerca de 700 artículos y ensayos, de los cuales muchísimos merecerían volver a ser reeditados (2). Su principal libro ha sido traducido a lo largo del tiempo al castellano, al francés, al inglés, al italiano, etc.
A pesar de la amplitud temática, la profundidad y la actualidad de un buen número de los análisis de Michels, su obra, en general, no ha gozado del éxito que se merece. En muchos países europeos, se la cita mal a propósito y faltan las obras críticas válidas. Sin embargo, para compensar tal situación, diversos han sido los estudios serios que han aparecido en los Estados Unidos, especialmente versados entorno a las aportaciones de Michels a la teoría del partido político y a la definición del Fascismo (3). Sus simpatías por el movimiento de Mussolini son, evidentemente, uno de los (principales) motivos que han llevado a la ‘ostracización’ de su obra a lo largo de toda nuestra postguerra. Es un destino que ha compartido con otros intelectuales, como, por ejemplo y entre otros muchos, Giovanni Gentile (4). Otro motivo: la difusión en Europa de métodos sociológicos americanos, de carácter empírico, descriptivo, estadístico o crítico/utópico y que no prestan demasiada atención al análisis de los conceptos y a las dimensiones históricas e institucionales de los fenómenos sociales. El estilo científico de Michels, de carácter realista/’realitario’, anti-ideológico, desmitificante y dinámico, ha sido injustamente considerado como desfasado, como la expresión anacrónica de una actitud eminentemente conservadora (5).
• Se anuncia un regreso de Michels
Sin embargo, desde hace algunos años (relativamente recientemente), la situación ha empezado a cambiar, sobretodo en Italia, país que Michels consideraba como su “nueva patria”. En 1966, se publica, junto a un estudio preliminar de Juan Linz, una traducción de Zur Soziologie des Parteiwesens (6). En 1979, aparece una selección de ensayos bajo la dirección del especialista americano James Gregor (7). Asimismo, una antología de escritos relativos a la sociología aparece en 1980 (8). Dos años más tarde, la Universidad de Perugia organiza un coloquio sobre el tema “Michels entre la política y la sociología”, con la participación de los más eminentes sociólogos italianos (9). Con ocasión del cincuenta aniversario de su muerte, otras de sus publicaciones son incluidas en los programas de los editores. Las ediciones ‘UTET’ anunciaron una amplia colección de “escritos políticos”. La editorial ‘Giuffré’ previo, dentro de su prestigiosa colección Arcana Imperii, una antología dirigida por Ettore Albertoni y G. Sola, que llevaría por título Dottrine et istituzioni politiche (“Doctrina e instituciones políticas”). Este mismo editor tenía igualmente en mente la publicación de una traducción italiana de Sozialismus und Faschismus in Italien (“Socialismo y Fascismo en Italia”), obra que apareció inicialmente en 1925.
Una contribución reciente en el redescubrimiento de Michels puede encontrarse en el libro del profesor israelita Zeev Sternhell, consagrado a la génesis de la ideología fascista en Francia (10). Según Sternhell, Michels, al igual que Sorel, Lagardelle y De Man, encarnan en sí la corriente “revisionista”, que, entre 1900 y 1930, aporta una decisiva contribución a la demolición de los fundamentos mecanicistas y deterministas del marxismo teórico y, a la crítica del economicismo y del reduccionismo materialista. Michels favorece de este modo la difusión de una concepción de la acción política fundada sobre la idea de nación y no en la de clase, conectada a una ética fuerte y a una visión libre de la dinámica histórica y social. Según numerosos autores, es ahí donde residen los fundamentos en los cuales maduró el Fascismo con su programa de organización corporativa, de justicia social, de encuadramiento jerárquico de las instituciones políticas y de limitación de las corrupciones debidas al parlamentarismo y al pluralismo partitocrático.
Michels estuvo en contacto con las más eminentes personalidades políticas e intelectuales de su época, tales como Brentano, Werner Sombart, Mussolini, Pareto, Mosca, Lagardelle, Sorel, Schmoller, Niceforo, etc. Lo que sin embargo y en consecuencia nos falta todavía, es pues, una buena biografía. A este respecto, sería muy interesante publicar sus cartas y su diario personal; estos dos elementos contribuirían enormemente a iluminar un período harto significativo de la cultura europea enmarcado en estos últimos cien años.
3. La fase sindicalista
Dentro del pensamiento de Michels, podemos distinguir claramente dos fases. La primera coincide con el abandono de la ortodoxia marxista inicial y con una aproximación al sindicalismo revolucionario y al revisionismo teórico. La segunda, la más fecunda desde el punto de vista científico, coincide con el descubrimiento de la teoría de Mosca sobre la “clase política” y la de Pareto sobre la inevitable “circulación de las élites”. Vamos, a continuación, a examinar brevemente, aunque con toda la atención necesaria, estas dos fases.
Tras haber publicado numerosos artículos de prensa y pronunciado numerosas alocuciones durante diversos congresos y debates políticos, los primeros estudios importantes de Michels aparecen entre 1905 y 1908 en la (excelente) revista “Archiv”, dirigida por Max Weber. Particularmente significativos son los artículos consagrados a “La social-democracia, sus militantes y sus estructuras” y a las “Asociaciones. Investigaciones críticas”, aparecidos en lengua alemana, respectivamente en 1906 y en 1907. En ellos Michels analiza la hegemonía de la social-democracia alemana sobre los movimientos obreros internacionales y también contempla a través de ellos la posibilidad de una unificación ideológica entre los diversos componentes del socialismo europeo. Este proceder, inscribe simultáneamente las contradicciones teóricas y prácticas del partido obrero alemán: de un lado, la retórica revolucionaria y el reconocimiento de la huelga general como forma privilegiada de lucha y, por otro lado, la táctica parlamentaria, el legalismo, el oportunismo y la vocación por el compromiso. Michels critica el “prudencialismo” de los jefes social-demócratas, sin por lo tanto favorecer la espontaneidad popular o las formas de autogestión obrera de la lucha sindicalista. Según Michels, la acción revolucionaria debe ser dirigida y organizada y, desde este punto de vista, los intelectuales detentan una función decisiva. Pues decisivo es el trabajo pedagógico de unificar el partido político. El movimiento obrero se presenta como una rica constelación de intereses económicos y de visiones idealistas que debe ser sintetizada en el seno de un proyecto político común.
En su primer libro, II proletariado e la borghesia nel movimento socialista (“El proletariado y la burguesía en el movimiento socialista”), publicado en italiano en 1907, Michels percibe perfectamente los peligros de degenerescencia, de oligarquización y de burocratización, intrínsecos a las estructuras de los partidos y de los sindicatos. En esta primera fase de su pensamiento, Michels contempla una “posibilidad” [involutiva] que debe ser conjurada a través del recurso de la acción directa del sindicalismo. Para él, la virtual involución del socialismo político no revela todavía su verdadero sentido que no hace sino encerrar en sí una inexorable fatalidad sociológica.
4. La fase sociológica
En 1911, aparece, tal y como hemos señalado, su importante “summa” entorno al partido político (11), la obra que indica claramente su paso definitivo del sindicalismo revolucionario a la sociología política. La influencia de Mosca sobre su método histórico y positivo fue, a decir verdad, determinante. A partir de un estudio de la social-democracia alemana, como caso particular, Michels termina enunciando una ley social general, una regla del comportamiento político. Michels descubrió que, en toda organización, existe necesariamente una serie de jefes preparados para la acción y élites de profesionales competentes (tecnócratas. N.d.T.); descubrió igualmente la necesidad de una “minoría creativa” que se impulsa por sí misma a la cabeza de la dinámica histórica; descubrió la dificultad que existe para conciliar, en el cuadro de la democracia parlamentaria, competencia técnica y representatividad. La tesis general de Michels es la siguiente: “En toda organización de carácter instrumental (Zweckorganisation), los riesgos de oligarquización se hallan siempre inmanentes” (12). Denuncia a continuación la insuficiencia definitiva del marxismo: “Ciertamente los marxistas poseen una gran doctrina económica y un sistema histórico y filosófico fascinante; pero, una vez penetramos en el terreno de la psicología, el marxismo revela ciertas lagunas conceptuales enormes, incluso en los niveles más elementales”. Realmente, su libro es muy rico en tesis y en argumentos. Si bien, juzguémoslo sobre el propio terreno:
1) La lucha política democrática posee necesariamente un carácter demagógico. En apariencia, todos los partidos luchan por el bien de la humanidad, por el interés general y por la abolición definitiva de las desigualdades. Pero, más allá de la retórica sobre el bien común, sobre los derechos del hombre y sobre la justicia social se presiente cómo despunta una voluntad por conquistar el poder y se perfila el deseo impetuoso por imponerse a la cabeza del Estado, en interés de la minoría organizada que se representa. A este respecto, Michels enuncia una “ley de expansión”, según la cual todo partido tiende a convertirse en Estado, a extenderse más allá de la esfera social que le estaba inicialmente asignada o que había conquistado gracias a su programa fundamental (13).
2) Las masas son incapaces de auto-gobernarse. Sus decisiones jamás responden a criterios racionales y están influidas por sus propias emociones, por toda suerte de azares de diverso orden, por la fascinación carismática que ejerce un jefe bien determinante e influyente, que se destaca de la masa para asumir la dirección de una manera dictatorial. Tras la llegada de la sociedad de masas y del desarrollo de los grandes centros industriales, cualquier posibilidad de re-instaurar una democracia directa pasa en lo sucesivo a extinguirse definitivamente. La sociedad moderna no puede funcionar sin dirigentes y sin representantes. En lo que respecta a estos últimos, Michels escribe: “una representación duradera significa, en cualquier caso, una dominación de los representantes sobre los representados” (14). En la opinión de Michels, este juicio no significa precisamente el rechazo de la representación, sino más bien la necesidad de encontrar los mecanismos necesarios que podrán transformar las relaciones entre las clases políticas y la sociedad civil, de la manera más orgánica posible. Hoy, el verdadero problema de la ciencia política consiste en escoger nuevas formas 1) de representación y 2) de transmisión de las voluntades y de los intereses políticos, que se fundamentan sobre criterios orgánicos, en un espíritu de solidaridad y de colaboración, orientados en un sentido pragmático y no inspirados por esos mitos de extracción mecanicista, que no conducen más que al poder de los partidos y no al gobierno eficaz de la nación.
3) En la era contemporánea, la fe política ha tomado el relevo a la fe religiosa. Michels escribe: “En medio de las ruinas de la cultura tradicional de masas, la estela triunfante de la necesidad de religión ha permanecido en pie, intacta” (15). He aquí una anticipación inteligente de la interpretación contemporánea del carácter mesiánico y religioso/secular, tan característico de la política de masas moderna, como es el caso destacado de los regímenes totalitarios.
4) “La competencia es poder”, “la especialización significa autoridad”. Estas dos expresiones recapitulan para Michels la esencia del “leadership”. En consecuencia, la tesis según la cual el poder y la autoridad se determinan con relación a las masas, o en el cuadro de los conflictos políticos con los otros partidos, es insostenible. Para Michels, son, en todo caso, las minorías preparadas, aguerridas y poderosas las que entran en lucha para tomar la dirección de un partido y para gobernar un país.
5) Analizando dos fenómenos históricos como son el Cesarismo y el Bonapartismo, Michels desvela las relaciones de parentesco entre democracia y tiranía y aboga en el sentido del origen democrático de ciertas formas de dictadura. “El Cesarismo -escribe- es todavía democracia y, al menos, puede reivindicar su nombre, puesto que obtiene su fuente directamente de la voluntad popular” (16). Y añade: “El Bonapartismo es la teorización de la voluntad individual, surgida inicialmente de la voluntad colectiva, pero emancipada de ésta, con el tiempo, para convertirse a su vez en soberana” (17).
6) Carl Schmitt, en su ya clásico libro Legalität und Legitimität (“Legalidad y Legitimidad”) (18), desarrolla un análisis profundo entorno a la “plusvalía política adicional” que asume aquel que detenta legalmente la palanca del poder político; se trata de una especie de suplemento del poder. Michels tuvo una intuición parecida al escribir: “Los líderes, al disponer de instrumentos de poder y, en virtud de este hecho, del mismo poder en sí mismo, tienen como ventaja la posibilidad de aparecer siempre al amparo de la legalidad” (19).
7) El principal libro de Michels contiene muchísimas otras observaciones sociológicas: sobre las diferenciaciones de competencias; sobre los gustos y los comportamientos, los cuales, en tanto que consecuencias de la industrialización, han logrado alcanzar a los obreros y quebrado la unidad de clase; sobre las mutaciones sociales como el aburguesamiento de los jefes y la aproximación entre los niveles de vida del proletariado y de la pequeña burguesía; sobre la posibilidad de prever y de limitar el poder de las oligarquías a través del procedimiento técnico que supone el referéndum y mediante el recurso del instrumento teórico y práctico del sindicalismo.
8) la sexta parte del libro es central y está dedicada explícitamente a la tendencia oligárquica de las organizaciones. En ella, Michels enuncia la más celebre de sus leyes sociales, la que evoca la “perversión” que sufren todas las organizaciones: con el incremento del número de las funciones y de los miembros, la organización, “de medio para alcanzar un fin, se convierte en un fin en sí misma. El órgano finaliza por prevalecer sobre el organismo” (20). Es ahí donde se halla la “ley de la oligarquía” de la cual se desprende que la oligarquía es la “forma establecida de avance de la convivencia humana en el seno de las organizaciones de gran dimensión” (21).
9) El libro de Michels contiene, en su conclusión, una voluntad de lucha que recuerda, parcialmente, la visión histórica trágica de Max Weber y de Georg Simmel; se trata de una voluntad por profundizar el choque inevitable entre la vida y sus formas constituidas, entre la libertad y la cristalización de las instituciones sociales, las cuales caracterizan la vida moderna.
5. La historia
Con la publicación en lengua italiana del libro titulado L’imperialismo italiano. Studio político e demográfico (“El imperialismo italiano. Estudio político y demográfico”) (1914), el “giro” de Michels es definitivo. Con la aparición de esta obra, se hunde un mito, el del internacionalismo y del universalismo humanitarista. En la obra de Michels, aparece el nacionalismo como el nuevo motor ideal de la acción política, como un sentimiento capaz de movilizar a las masas y de favorecer la integración de éstas en las estructuras del Estado. El análisis sociológico del sentimiento nacional será profundizado en un volumen posterior, inicialmente aparecido en alemán (1929) y, después en italiano (1933), bajo el título de Prolegomeni sul patriotismo (“Prolegómenos sobre el patriotismo”).
A partir de 1913, aparecen en Italia diversos estudios importantes sobre economía: Saggi economici sulle classi popolari (“Ensayos económicos sobre las clases populares”) (1913), La teoría di Marx sulla povertà crescente e le sue origini (“La teoria de Marx sobre el crecimiento de la pobreza y sus orígenes”) (1920). La aproximación que Michels intenta hacia la economía no es más que de naturaleza rigurosamente histórica. Según él, es mucho más importante tener en cuenta la utilidad práctica de una teoría económica que sus correcciones especulativas puramente formales. La interpretación de Michels es pragmática y concreta. Critica la inconsistencia del “homo oeconomicus” liberal, porque a su juicio, no existen sujetos económicos abstractos, sino actores concretos, portadores de intereses específicos. A continuación critica la interpretación del marxismo, la cual establece la existencia de un conflicto insuperable en el seno de las sociedades. Michels reconoce con ello la función reguladora y equilibrante del Estado y la necesidad de una colaboración estrecha entre las diversas categorías sociales. Por esta razón, considera que el modelo corporativo constituye una solución. Su valoración del corporativismo se halla contenida en el opúsculo Note storiche sui sistemi sindicali corporativi (“Notas históricas entorno al sistema sindicalista corporativo”), publicado en lengua italiana en 1933.
6. El Fascismo
En esta fase de su obra, su actividad como historiador, queda consignada en diversos libros, escritos originalmente en alemán y, posteriormente traducidos al italiano: Socialismo e Fascismo in Italia (“Socialismo y Fascismo en Italia”) (2 volúmenes, 1925); Psicologia degli uomini significativi. Studi caratteriologici (“Psicologia de los hombres significativos. Estudio caracterológico”) (1927),
Movimenti anticapitalisti di massa (“Movimientos anticapitalistas de masa”) (1927); y después en varios escritos redactados directamente en italiano: Francia contemporánea (1926) y Storia critica del movimento socialista italiano (1926). Entre las personalidades “significativas” de las cuales traza su biografía, figuran Bebel, De Amicis, Lombroso, Schmoller, Weber, Pareto, Sombart y W. Müller. En 1926, Michels imparte una serie de lecciones en la Universidad de Roma; éstas serán reunidas un año más tarde en un volumen, redactado en italiano: Corso di sociologia politica (“Curso de sociología política”), una buena introducción a esta disciplina que demuestra ser todavía útil en la actualidad. En este trabajo, traza las grandes líneas de su visión elitista de los procesos políticos, emite una teorización de la institución en la que se ha convertido el “Duce” y desarrolla una nueva teoría de las minorías. El “Duce”, que obtiene su poder directamente del pueblo, extiende su legitimidad al conjunto del régimen político. Esta idea constituye en sí, total y verdaderamente, un paralelismo sociológico con la teoría elaborada simultáneamente en Alemania por los teóricos nacional-socialistas del denominado “Führerprinzip”.
Esta relativa originalidad de Michels no ha sido jamás puesta suficientemente en evidencia por los críticos, que se han limitado a considerarlo solamente como un genial continuador de la obra de Mosca y de la Pareto. En 1928, en la Rivista internazionale di Filosofía del Diritto (Revista internacional de Filosofía del Derecho), aparece un importante ensayo de Michels: Saggio di classificazione dei partiti politici (“Ensayo de clasificación de los partidos políticos”). A continuación, numerosos escritos italianos fueron reunidos en dos volúmenes: Studi sulla democrazia e l’autorità (“Estudios sobre la democracia y la autoridad”) (1933) y Nuovi studi sulla classe politica (“Nuevos estudios sobre la clase politica”) (1936).
La adhesión explícita de Michels al Fascismo quedó expresada en una obra escrita inicialmente en alemán (L’Italia oggi) en 1930, año durante el cual se afilia al P.N.F. (Partido Nacional Fascista). En sus páginas, Michels hace un elogio del régimen de Mussolini, porque ha contribuido de manera decisiva a la modernización de la nación.
7. Conclusiones
La mayor parte de las notas relativas a la vida de Michels se hallan contenidas en su ensayo autobiográfico, redactado en alemán Una corrente sindicalista sotteranea nel socialismo tedesco fra il 1903 e il 1907 (“Una corriente subterránea en el socialismo alemán entre 1903 y 1907″) y publicado en 1932; este ensayo conserva todavía en la actualidad, y lo seguirá haciendo, toda la utilidad necesaria para reconstruir las diversas fases de su existencia, así como para señalar las diferentes iniciativas políticas y culturales que emprendiera a lo largo de su vida; podemos descubrir así su itinerario que va de la social-democracia alemana al Fascismo, de la ideología marxista al realismo maquiavélico a la italiana, de las ilusiones del revolucionarismo a su credo conservador.
En resumen, se trata de una obra vasta, de gran interés. Esperamos, a modo de conclusión para esta breve introducción, que el cincuenta aniversario de su muerte, contribuirá a redescubrir a este gran sociólogo y a revalorizar de forma equilibrada su trabajo.
Notas
(0) El presente artículo apareció originalmente en la revista florentina Diorama Letterario, siendo traducido al francés para la revista belga Vouloir (B.P.B. 41, B-1970 Wezem-beek-Oppem. Belgie/Belgique), en cuyo número 50/51 (Noviembre-Diciembre de 1988) apareció, por Robert Steuckers. Siendo la versión francesa la utilizada para traducir al castellano el artículo en cuestión.
(1) Al hablar de recientemente, debe de entenderse como relativamente recientemente, pues ha de considerarse que el cincuentenario de la muerte de Roberto Michels se cumplió el 2 de Mayo de 1986 y el artículo que nos ocupa, originalmente y con respecto a este punto concreto, tuvo su máxima vigencia, evidentemente, durante el período vigente entorno a cuatro años atrás (N.d.T.).
(2) Una bibliografía entorno a los trabajos de Michels fue publicada en 1937 por los Annali (“Anales”) de la facultad de jurisprudencia de la Universidad de Perugia.
(3) Por ejemplo, D. Beetham, “From Socialism to Fascism: The Relation Between Theory and Practice in the Work of Robert Michels”, en: Political Studies, XXV, No.’s 1 & 2. Asimismo conviene citar, G. Hands, “Roberto Michels and the Study of Political Parties”, en Bri-tish Journal of Political Science, 1971, No. 2.
(4) Sobre este tema, W. Röhrich, Roberto Michels vom sozialistischsyndikalistischen zum faschistischen Credo, Duncker & Humblot, Berlin, 1972. Citemos igualmente, R. Messeri, “Roberto Michels: crisi della democrazia parlamentare e fascismo”, dentro de la obra colectiva II Fascismo nell’analisi sociologica, Il Mulino, Bologna, 1975.
(5) Destacadamente interesantes son los estudios de E. Ripepe (Gli elitisti italiani, Pacini, Pisa, 1974) y de P. P. Portinaro, “R. Michels e Pareto. La formazione e la crisi della sociologia”, en: Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Torino, XI, 1977.
(6) Roberto Michels, Les Partis Politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Paris, 1971. Traducción de la edición alemana de 1925.
(7) A. James Gregor, Roberto Michels e l’ideologia del Fascismo, Volpe, Roma, 1979. Tras una larga introducción, podremos encontrar en esta obra una amplia serie de textos de Michels.
(8) Roberto Michels, Antologia di scritti sociologici, Il Mulino, Bologna, 1980.
(9) Las contribuciones a este coloquio fueron reunidas por G. B. Furiozzi en el libro Roberto Michels tra politica e sociologia, ETS, Pisa, 1985.
(10) Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche, Seuil, Paris, 1983.
(11) Con respecto a la contribución de Michels a la “stasiología”, o la ciencia que estudia los partidos políticos, es conveniente consultar a G. Fernández de la Mora, La partitocracia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977, páginas 31-42. Con respecto a la influencia de Michels sobre Ortega y Gasset, consúltese a I. Sánchez-Cámara, La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, Madrid, 1986, páginas 124-128.
(12) Roberto Michels, Les partis
politiques…, op. cit.
(13) Ibidem.
(14) Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Ibidem.
(18) Carl Schmitt, Legalität und Legitimität (“Legalidad y Legitimidad”), Duncker & Humblot, Leipzig/München, 1932.
(19) Roberto Michels, op. cit.
(20) Ibidem.
(21) Ibidem.
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, roberto michels, oligarchie, théorie politique, italie, allemagne, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 mars 2013
Catherine Rouvier : « Pour obtenir un résultat politique, il faut une action politique. »

Catherine Rouvier :
« Pour obtenir un résultat politique, il faut une action politique. »
Ex: http://www.lerougeetlenoir.org/
Catherine Rouvier est docteur d’Etat en Droit public et en Sciences politiques de l’Université Paris II (Panthéon-Assas), ancienne élève de Sciences Po Paris et professeur à l’université de Paris XI (Orsay). Sa thèse d’histoire des idées politiques sur Gustave Le Bon, parue initialement en 1986 aux PUF avec une préface d’Edgar Faure et qui a reçu le prix Fabien de morale et de sociologie de l’Académie française, a permis de redécouvrir cet auteur qui fut le père de la psychologie collective et dont l’ouvrage Psychologie des foules, paru en 1895, connut un grand succès. Son ouvrage a été augmenté, enrichi et réédité en 2012 (avec une préface de Paul-Marie Coûteaux).
Bago : Bonjour Madame, qu’a pensé la spécialiste de la psychologie des foules que vous êtes des manifestations contre le « mariage pour tous » ?
Catherine Rouvier : Le déroulement de la manifestation ; la nature même des mots d’ordre et des chants ; la couleur rose apaisante et inoffensive des panneaux, des tee-shirts, des écharpes ; la scission des cortèges, venus de trois endroits différents, ce qui diluait l’effet de masse ; le caractère très lent de la marche, souvent stoppée par de longues minutes passées dans le froid, ce qui minimisait l’échauffement des corps mais aussi des esprits ; tout était fait pour que ne se produise pas de phénomène de foule, c’est-à-dire la fusion des individualités en un « moi collectif » animé d’une pensée commune, et parcouru de sentiments contagieux comme la colère ou l’enthousiasme. Or, seule la puissance invincible d’une véritable "foule" au sens psychosociologique du terme peut faire peur à un gouvernement jusqu’à le faire plier, comme ce fut le cas en 1984.

Bago : Que faudrait-il, le 24 mars, pour que les gentils manifestants se changent en foule ?
Catherine Rouvier : En priorité, il faut deux choses : des mots d’ordres et un chef.
Bago : Les mots d’ordres ne convenaient-ils pas ? [1]
Catherine Rouvier : Le message, pour générer l’action, doit être simple, clair, univoque. On ne peut pas faire dire à une foule qu’on souhaite mobiliser vraiment deux choses à la fois, surtout si elles sont presque exclusives l’une de l’autre. Sinon le message est brouillé, donc inefficace. Ainsi, en l’espèce, on ne pouvait pas, d’un côté, refuser d’appeler « mariage » la légalisation de la vie commune de deux hommes ou de deux femmes et refuser que cette union ait les mêmes conséquences que celle d’un homme et d’une femme ; et, d’un autre coté, reprendre à son compte le terme même qui justifie ces revendications : la lutte contre l’homophobie. Donc mettre sur les tracts appelant à manifester, sous le mot d’ordre principal, « manif’ pour tous » (qui était déjà un clin d’œil amical à l’appellation fallacieuse de « mariage pour tous » des adversaires - ce qui n’est pas très bon), un second mot d’ordre : « lutter contre l’homophobie », lequel brouillait le message.
Bago : Qu’en est-il du chef ?
Catherine Rouvier : Virginie Telenne, alias Frigide Barjot, s’est attirée à juste titre la sympathie et la reconnaissance des catholiques en soutenant le pape Benoît XVI dans les médias à une époque où ceux-ci ne faisaient que relayer les critiques de toutes sortes et les attaques les plus violentes contre le « pape allemand ». Mais elle l’a fait en utilisant le personnage de parodiste, forgé pour elle par son mari Basile de Koch alias Bruno Telenne (qui, lui, reste dans la dérision dans sa manifestation « le mariage pour personne » en marge de la manifestation officielle). Or, ce surnom a une connotation positive, puisqu’il évoque Brigitte Bardot, gloire nationale, très belle actrice, femme attachante, passionnée de la cause animale. Mais dans le même temps, il a la connotation péjorative à cause de deux adjectifs peu valorisants : « frigide » et « barjot ». Or le sujet est grave et comme le notait déjà La Bruyère : « Le caractère des Français demande du sérieux dans le souverain ». Un chef doit être « auréolé de prestige » , ce que la dérision exclut de facto. Il n’est pas là pour plaire, et il ne doit pas craindre d’être accusé de ne pas être « gentil ».

Bago : Pensez-vous à quelqu’un en particulier ?
Catherine Rouvier : Le chef peut être ressenti comme prestigieux à cause d’un titre, d’une fonction, ou d’un exploit passé qui l’a fait connaître et admirer. Mais aussi parce qu’il se sera déjà exprimé fermement sur le sujet. Par exemple, le Rabbin Berheim, ou un évêque, comme ceux de Toulon, de Bayonne, ou de Vannes. Cela pourrait aussi être Marine Le Pen. Elle a refusé de se prêter au « jeu » des précédentes manifestations, comprenant l’intérêt d’être dans le registre sérieux qui la caractérise, mais s’est exprimée fermement, aussi bien contre la récente exhibition des Femen à Notre Dame que contre le « mariage homo », déclarant clairement qu’elle abrogerait le texte sitôt arrivée au pouvoir. Dans les rangs du l’UMP, on nuance, on finasse. Jean-François Copé a manifesté, mais interviewé par les journalistes pendant la manifestation, il a dit que ce qui le gênait surtout, c’était la GPA et la PMA, plus que le texte lui-même : message non clair, là encore. Monsieur Guaino a fait un beau témoignage, émouvant, sur sa propre difficulté à avoir vécu une enfance sans père. Mais il a atténué considérablement l’effet produit en protestant lui aussi longuement contre l’« homophobie » comme s’il était accusé et non accusant. François Fillon a été le plus clair, parlant lui aussi d’abrogation, mais brièvement, dans une intervention liminaire au vote à l’Assemblée, non médiatisée. Quand aux centristes, entre ceux qui « se sont trompés de bouton » et « ceux qui étaient sortis au moment du vote » (zut, pas de chance, c’est déjà voté !), on ne les voit pas en leaders sur ce sujet !
Bago : Quelles sont les autres conditions du succès ?
Catherine Rouvier : Changer de style. Le souci de satisfaire une mode « festive » et son métier, le spectacle, ont conduit Frigide à organiser une sorte de parodie de gay pride avec chars, chants, musique disco et techno, « tubes » de l’été… La scène dressée sur le Champ-de-Mars évoquait un theâtre, une émission de télé-divertissement, pas un meeting politique. Seul le jeune Xavier Bongibault a eu un mot politique. Il a comparé Hollande à Hitler parce qu’il veut « enfermer les homos dans une définition dictée par leurs choix sexuels ». Mais pour cette remarque, à l’efficacité médiatique immédiate, il s’est fait tancer par Frigide, et s’est tout de suite excusé. Ce choix du festif et du non-politique n’est pas mobilisateur, car il maintient les manifestants dans le bien-être des retrouvailles de ceux-qui-pensent-comme-eux, et les bercent de la certitude fallacieuse d’une opinion largement répandue. Se réunir devient alors le but de la réunion. Par ailleurs, à cette foule qui attendait des mots d’ordre parce qu’elle avait reçu un choc - celui d’un projet de loi ouvrant le mariage à deux hommes entre eux ou à deux femmes entre elles - la réponse apportée par Frigide Barjot a été de dire que c’était pas vrai, qu’à un enfant il faut un papa et une maman, que les enfants naissent d’un homme et d’une femme. Et la foule a récité ou chanté cela un peu comme une litanie ou une comptine apaisante et auto-convaincante. Mais on ne lui a pas demandé (et on le lui a même interdit - les mots d’ordre et chants étant limités et imposés) de dire que ce n’est pas bien. Pour obtenir un résultat politique, il faut mener la foule vers une action politique.
Bago : Pensez-vous qu’il serait alors possible de transformer l’essai ?
Catherine Rouvier : Oui, mais à certaines conditions. La foule est « expectante », dit le Bon. Son attente dure-t-elle après cette marche impuissante à modifier le cours des choses ? Là est la vraie question. Le vote mardi dernier [12 février 2013, ndlr] de l’article 1 disposant : « le mariage est ouvert aux personnes de même sexe » a sans doute été un deuxième choc, d’autant plus que l’annonce en a été faite alors que des manifestations avaient lieu en même temps en province devant les préfectures. Alors oui, on peut en effet imaginer qu’une foule immense réunie à nouveau le 24 Mars, sans flons flons, en un immense ruban compact comme en 1984 - et non divisée en trois cortèges, avec des slogans, banderoles et chants non pas imposés par le rose bonbon mais décidés par des chefs d’établissements scolaires, des religieux, des paroissiens, des chefs de syndicats et de partis, qui défileront suivis de leurs adhérents ou ouailles, dans une gravité et une colère véritable contre la dénaturation de notre modèle sociétal. Ceux qui l’imposent pourraient faire changer le cours des choses.
Mais la « réactivation mémorielle » étant une condition de la mobilisation des foules, il faudra que les organisateurs produisent des témoignages, non comme ils l’ont fait jusqu’ici d’enfants heureux d’avoir été adoptés par des parents de sexe opposé (encore une fois là, on n’attaque pas, on oppose une affirmation à une autre) mais des témoignages poignants, révoltants, ceux de ces enfants malheureux parce qu’ignorant leurs origines après PMA et qui ont écrit leur douleur dans des livres, ceux de ces adultes élevés par deux femmes ou deux hommes et qui ont été dans l’incapacité de construire une vie affective et l’ont avoué récemment dans la presse, celui de l’effarant procès de cette femme aux Pays-Bas ayant vendu à trois couples l’enfant qu’elle portait, et des conséquences terribles pour le bébé « ballotté » d’un foyer à l’autre au rythme des décisions de justice. L’empathie est l’autre source du phénomène de foule.
Autre modification nécessaire : il ne faudra pas isoler par un « cordon sanitaire » les manifestants du reste de la rue comme çela a été fait le 13 janvier. Pour que la foule agisse, qu’elle remporte le combat qu’elle livre, il faut que la rue puisse la rejoindre, la suivre, s’y agréger, il faut que la rue réagisse. Pour et contre, pourquoi pas ? La manifestation de Civitas du 18 novembre a été portée à la connaissance du monde entier en moins de 2 heures par les médias à cause de l’attaque des Femen. Il ne s’agit pas de provoquer les incidents, mais il faut laisser les adversaires montrer ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent. La présence de la police doit suffire à éviter les débordements.
Enfin, la présence à cette manifestation du plus grand nombre d’étrangers présents en France, de croyants français non chrétiens - musulmans, voire confucéens - ainsi que des Français d’outre-mer résidant en métropole qui, comme Bruno Nestor Azerot, sont scandalisés par cette loi, est indispensable au succès de ce combat. Comme une majorité écrasante d’entre eux ont voté socialiste et que certains d’entre eux, les étrangers, seront appelés à voter très bientôt par le pouvoir en place, leur présence dans la manifestation interpellera plus sûrement les dirigeants que les gentilles mères de famille versaillaises qui - ils le savent bien - n’ont jamais voté et ne voteront jamais pour eux. Les contrarier, en effet, ne change rien à leurs chances de réélection !
Bago : Quel résultat peut-on attendre ?
Catherine Rouvier : Dans l’Histoire, les foules ont fait des révolutions, des coups d’Etat, mais aussi des obstructions au bon fonctionnement des institutions. Dans le cas présent, des milliers d’officiers municipaux sont opposés à ce projet. Devront-ils se démettre de leurs fonctions, renoncer à leur mandat parce qu’ils se seront mis en infraction en refusant d’appliquer cette loi et donc de « marier » des hommes entre eux ou des femmes entre elles ? Un joli but politique serait alors atteint pour l’actuelle majorité : démission garantie de tous les maires catholiques de droite, et des élus « réfractaires » de gauche ! Ne vaudrait-il pas mieux prendre les devants, et que les maires disent comme Mirabeau qu’ils sont dans leur mairie « par la volonté du peuple et qu’ils n’en sortiront que par la force des baïonnettes », mais qu’on ne les forcera pas à faire cet acte contraire à leur conscience ? Ce sont les communes, ne l’oublions pas, qui se sont insurgées contre le pouvoir excessif du roi et ont obtenu une « chambre » à elles en Angleterre dès le XIIIe siècle. De même, les associations familiales catholiques devront-elles changer de nom et d’objet social parce que la « famille », après le vote de la loi, devra obligatoirement comprendre les unions d’homosexuels et leurs désirs d’enfants ?
Des milliers de prêtres et de religieuses devront-ils tomber sous le coup de la loi, astreints à des amendes conséquentes pour avoir simplement dit ce que la religion qui est leur vocation et leur vie leur enjoint de dire sur ce sujet ? L’Eglise va-t-elle demain être mise hors-la-loi ? Aujourd’hui, elle n’a plus de chef, mais c’est justement cette situation - qui va attirer sur elle tous les projecteurs d’ici à fin mars - qui rendra d’autant plus visibles et d’autant plus efficaces les prises de positions et les actes posés par les évêques résolument opposés a ce projet.
Notes
[1] A ce sujet, nous ne saurions que trop vous conseiller cet article : http://www.lerougeetlenoir.org/les-controverses/que-fera-t-on-de-nos-pieds
00:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, entretien, catherine rouvier, sciences politiques, politologie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Demokratie und Homokratismus
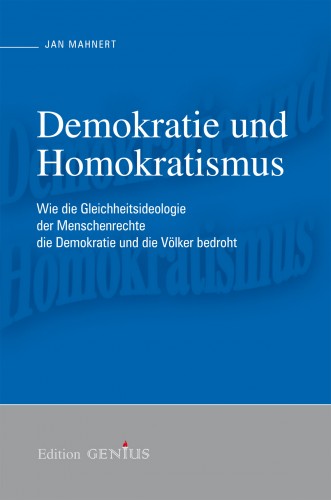
Demokratie und Homokratismus
Demokratie und Homokratismus
Wie die Gleichheitsideologie der Menschenrechte
die Demokratie und die Völker bedroht
Genius Edition, Band 3
Wien, 2011
176 Seiten, 17 x 24 cm
ISBN 978-3-9502238-2-8
Preis: 18,70 Euro
[Buchbestellung]
In unserer heutigen Vorstellungswelt gelten die Begriffe Demokratie und Menschenrechte als miteinander fest verbunden. Doch sind sie das wirklich? Tatsächlich ist die Demokratie weit älter und facettenreicher, als es die viel jüngeren allgemeinen Menschenrechte sind. Zudem stützt sich die Demokratie auf jeweils ein konkretes Volk als Souverän. Hingegen setzt die den Menschenrechten innewohnende universelle Gleichheitsideologie auf beliebig zusammengesetzte Menschenmassen als Substrat für demokratische Organisationsformen. Um die sich daraus real ergebenden Konsequenzen besser verstehen zu können, plädiert das Buch für eine begriffliche Unterscheidung: Jene Demokratien, die sich der universellen Gleichheitsideologie unterwerfen, sollen als Homokratien bezeichnet werden; ihre Ideologie ist der Homokratismus. Diese Sichtweise erlaubt einen erhellenden Durchblick auf die aktuellen politischen Entwicklungen mit deren Stichworten wie: Migration, Multikulturalismus, Pluralismus, Extremismus, Nationalstaat und Globalisierung. Auch der Parteienstaat mit seinen Eliten und Oligarchien wird aus dieser Perspektive analysiert sowie das ambivalente Verhältnis zwischen Diktatur und Demokratie beleuchtet. Die vom homokratischen Gleichheitsgedanken bedrohten Völker Europas stehen vor Herausforderungen historischen Ausmaßes..
Jan Mahnert, Jahrgang 1973, hat nach seiner Jugendzeit in Genf an der Universität Genf Geografie studiert. Sein zweisprachiges Aufwachsen in der Westschweiz stimulierte sein Interesse für Politik ebenso im französischen wie im deutschen Kulturraum. Jan Mahnert leitete von 1999 bis 2003 die französische EU-kritische Zeitschrift L’Esprit Européen und schreibt seit 1999 auch für die in Wien erscheinende Zeitschrift Genius-Lesestücke.
Zum Inhalt (Seite)
Danksagung 7
Einleitung
Krieg der Worte 9
Kapitel 1
Wie viel Gleichheit verträgt die Demokratie? 15
Kapitel 2
Das komplexe Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten 21
Kapitel 3
Neue Begriffe sind gefragt 33
Kapitel 4
Gibt es zwischen Demokratie und Menschenrechten Gegensätze? 41
Kapitel 5
Rechtsschutz im Spannungsfeld zwischen Mensch und Volk 47
Kapitel 6
Welches Denken ist wirklich extremistisch? 69
Kapitel 7
Die Demokratie ist nicht schuld 99
Kapitel 8
Das ambivalente Verhältnis von Diktatur und Demokratie 107
Kapitel 9
Der Pluralismus und seine Grenzen 119
Kapitel 10
Eliten und Oligarchien im Parteienstaat 129
Kapitel 11
Über die Reformfähigkeit von Systemen 145
Literatur 167
Der Autor 173
00:05 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, homocratie, théorie politique, sciences politiques, politologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 février 2013
Hans Freyer: The Quest for Collective Meaning
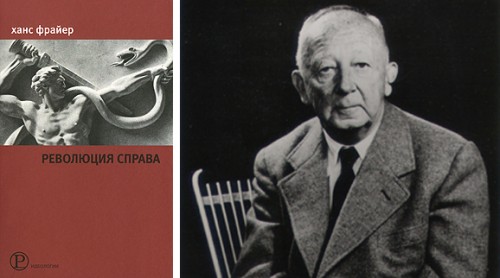
Hans Freyer:
The Quest for Collective Meaning
By Lucian Tudor
Ex: http://www.counter-currents.com/
Hans Freyer was an influential German sociologist who lived during the early half of the 20th century and is associated not only with his role in the development of sociology in German academia but also with the “Far Right.” Freyer was part of the intellectual trend known in Germany during the 1920s and 30s as the Conservative Revolution, and had also worked in universities under the Third Reich government for much of its reign, although it should be clear that Freyer was never an “orthodox” National Socialist.[1] However, outside of Germany he has never been very well known, and it may be of some benefit for the Right today to be more aware of his basic philosophy, for the more aware we become of different philosophical approaches to the problems facing modern society the more prepared we are intellectually to challenge the dominant liberal-egalitarian system.
Community and Society
Classical liberal theory was individualist, holding that the individual human being was the ultimate reality, that individuals existed essentially only as individuals; that is, that they are completely independent from each other except when they choose to “rationally” associate with each other or create a “social contract.” While this notion has been increasingly criticized in more recent times from different academic positions, in much of the 19th and 20th centuries liberal theory was very influential.[2] One of the most important thinkers in early German sociology to provide a social theory which rejected individualism was Ferdinand Tönnies, who was a crucial influence on Hans Freyer.
Tönnies’s work established a fundamental distinction between Gemeinschaft (“Community”) and Gesellschaft (“Society”), a distinction which Freyer and many other German intellectuals would agree with. According to this concept, Gemeinschaft consists of the organic relations and a sense of connection and belonging which arise as a result of natural will, while Gesellschaft consists of mechanical or instrumental relations which are consciously established and thus the result of rational will. As Tönnies wrote:
The theory of Gesellschaft deals with the artificial construction of an aggregate of human beings which superficially resembles the Gemeinschaft insofar as the individuals live and dwell together peacefully. However, in Gemeinschaft they remain essentially united in spite of all separating factors, whereas in Gesellschaft they are essentially separated in spite of all uniting factors.[3]
Tönnies emphasized that in modern urban society the sense of organic solidarity or Gemeinschaft was increasingly reduced (with Gesellschaft having become the more dominant form of relationship), thus harming human social relations. However, it should also be remembered for the sake of clarity that he also clarified that these were types of relationships that are both always present in any human society; the issue was that they existed in varying degrees. Although sociological theory did not reject the importance of the individual person, it clearly revealed that individuals were never completely disconnected, as classical liberal theory so foolishly held, but rather that they always have a social relationship that goes beyond them.
Philosophy of Culture
Hans Freyer’s definition of culture included not only “high culture” (as is the case with Spengler’s work), but as the totality of institutions, beliefs, and customs of a society; that is, the term culture was utilized “in the broadest sense to indicate all the externalized creations of men.”[4] More specifically, Freyer identified culture as “objective spirit,” a concept derived from Simmel’s philosophy. This concept denotes that the creations of human beings – everything which culture comprises, including tools, concepts, institutions, etc. – were created by human minds (the “subjective domain of the psyche”) at some point in history in order to fulfill their needs or desires, and following their creation they obtained an “objective value,” became “objectified.”[5] That is, as a result of being manifested and used over time, concrete cultural creations over time obtained a fixed value independent of the original value given to them by their creator(s) and also of the situation in which they were created.[6]
In Freyer’s theory, culture and its traditions are created, first of all, to provide “stability in the face of the natural flux of life,” for if culture changed as quickly as Life then cultural forms would be constantly replaced and would therefore lose their value for providing stability.[7] Furthermore, traditions gained value with an increase in their “depth” and “weight” (metaphorical terms used by Freyer), i.e. their permanence among the changes of life and human conditions.
Traditions gained “depth” by being re-appropriated over generations; while cultural objects gained a new meaning for each new generation of a people due to changes in life conditions, the subsequent generation still retained an awareness of the older meanings of these objects, thus giving them “weight.” Because of this historical continuity in the re-appropriation of culture, cultural forms or traditions acquire a special meaning-content for the people who bear that culture in the present.
It is also very important to recognize that Freyer asserted that the most crucial purpose of a culture and the social groups associated with it was to “convey a set of delimiting purposes to the individual” in order to provide a sense of “personal meaning,” which was “linked to collective stability, collective integration was linked to collective purpose, and collective purpose was linked to the renewal of tradition.”[8]
Culture, Race, Volk
Additionally, it should be noted that another significant aspect of Freyer’s philosophy is that he held that “the only viable cultural unity in the modern world was the Volk,”[9] which means that although culture exists on multiple levels, the only entity which is a reliable source of cultural identity and which carries relatable traditions is the Volk (a term which is oftentimes translated as “nation” or “people” but is in this sense better rendered as “ethnicity”). The Volk was the collective entity from which particular cultures emerged, which bore the imprint of a particular Volksgeist (technically, “folk spirit”) or collective spirit.
The Volk as an entity was created by an interaction between two forces which Freyer termed Blut (“Blood”) and Heimat (“Home”). Home is the landscape or environment in which the Volk formed, “that place from which we come and which we cannot abandon without becoming sick,” while “Blood is that which comprises our essence, and from which we cannot separate ourselves without degenerating,”[10] meaning the racial constitution of the people whose biological integrity must be upheld. While in order to be healthy, a Volk must have the characteristic of Bodenständigkeit (“groundedness in the soil,” as opposed to the “groundlessness” of liberal society), a key foundation of the Volkstum (“Folkdom”) is race:
It is here [at the Volkstum] that all the talk of race originates and has its truth. When one objects that this is pure biology, that after all spiritual matters cannot be derived from their natural basis, or when one objects that there are no pure races – these objections fail to grasp the concept of race that is a component of the new worldview. Race is understood not in the sense of “mere” biology but rather as the organic involvement of contemporary man in the concrete reality of his Volk, which reaches back through millennia but which is present in its millennial depth; which has deposited itself in man’s bodily and psychic existence, and which confers an intrinsic norm upon all the expressions of a culture, even the highest, most individual creations.[11]
The Loss of Meaning and Particularity
Hans Freyer was, like G. W. F. Hegel and Wilhelm Dilthey (two of his major influences), a historicist, although unlike Hegel he did not believe that history was entirely rational or that positive “progress” would be necessarily determined in history.[12] As a historicist, Freyer believed that all human cultures and values are created by historical circumstances and thus change over time, and also therefore that no Volk or culture is, objectively speaking, superior or inferior to another, and that essentially each culture and tradition is just as valid as any other. That is, “history thinks in plurals, and its teaching is that there is more than one solution for the human equation.”[13]
As result, the question of which cultural tradition would form the basis of collective meaning came into question. Freyer, in the German historicist line of thought, rejected the notion that one could scientifically or rationally choose which culture is better (due to the fact that they are all equally legitimate), and furthermore people in modern times held an awareness of the existence of the multiplicity of human cultures and their historical foundations. This awareness caused many modern people to feel an uncertainty about the full validity of their own culture, something which served as a factor in the loss of a sense of meaning in their own traditions and therefore a loss of a sense of personal meaning in their culture. That is, a loss of that sense of guidance and value in one’s own traditions which was more common in ancient and Medieval societies, where human beings tended to recognize only their own culture as valid. Freyer noted: “We have a bad conscience in regard to our age. We feel ourselves to be unconfirmed, lacking in meaning, unfulfilled, not even obligated.”[14]
However, there was also another source of the lack of a sense of collective meaning in modern societies: the development of industrial society and capitalism. The market economy, without any significant limits placed upon it, along with the emergence of advanced technology, had a universalist thrust, not recognizing national boundaries or cultural barriers. These inherently universalist tendencies in capitalism created another factor in the loss of a sense of cultural uniqueness, collective meaning, and particularity in human beings in the West.
The modern economy was the source of the formation of “secondary systems,” meaning structures which had no connection to any organic ethnic culture and which regarded both the natural world and human beings in a technical manner: as objects to be used as resources or tools to be utilized to increase production and therefore also profit. Because of this, the systems of production, consumption, and administration expanded, resulting in a structure controlled by a complex bureaucracy and in which, “instead of membership in a single community of collective purpose, the individual was associated with others who occupied a similar role in one of the secondary systems. But these associations were partial, shifting, and ‘one-dimensional,’ lacking deeper purpose of commitment… [leaving] the individual lonely and insecure.”[15]
Freyer asserted that history is divisible into three stages of development: Glaube (“Faith”), Stil (“Style”), and Staat (“State”). In the stage known as Glaube, which corresponded to the concept of ancient Gemeinschaft, human beings were “completely surrounded, encircled, and bound up in a culture that ties [them] closely to other members of [their] society.”[16] In the stage known as Stil, society would become hierarchical as a result of the domination of one group over another. While ancestry and a belief in the natural superiority of the ruling class would be valued in the resulting system, in later stages the source of social status would become wealth as a result of the rise of economic motives and capitalistic class society would form. As a result, the loss of meaning previously described occurs and history enters “critical epochs in which the objective cultural forms were unable to contain the flux of life.”[17] This would give rise to the necessity of a revolutionary transformation of the cultural reality: the third impending stage, Staat.
Revolution from the Right
Hans Freyer studied the problem of the failure of radical Leftist socialist movements to overcome bourgeois society in the West, most notably in his Revolution von Rechts (“Revolution from the Right”). He observed that because of compromises on the part of capitalist governments, which introduced welfare policies to appease the workers, many revolutionary socialists had come to merely accommodate the system; that is, they no longer aimed to overcome it by revolution because it provided more or less satisfactory welfare policies. Furthermore, these same policies were basically defusing revolutionary charges among the workers.
Freyer concluded that capitalist bourgeois society could only be overcome by a revolution from the Right, by Right-wing socialists whose guiding purpose would not be class warfare but the restoration of collective meaning in a strong Völkisch (“Folkish” or “ethnic”) state. “A new front is forming on the battlefields of bourgeois society – the revolution from the Right. With that magnetic power inherent in the battle cry of the future even before it has been sounded…”[18] This revolutionary movement would be guided by a utopian vision, yet for Freyer the significance of belief in utopia was not the practicality of fully establishing its vision, “utopia was not a blueprint of the future but the will to actively transform the present… Utopias served to transmute critical epochs into positive ones.”[19]
The primary purpose of the new State which Freyer envisioned was to integrate human beings belonging to the Volk into “a closed totality based upon the reassertion of collective particularity.”[20] Freyer asserted that the only way to restore this sense of collective particularity and a sense of community was to create a closed society in which the state ensures that foreign cultural and ideological influences do not interfere with that of the Volk, for such interferences would harm the unity of the people. As Freyer wrote, “this self-created world should completely, utterly, and objectively enclose a particular group; should so surround it that no alien influences can penetrate its realm.”[21] Freyer’s program also carried with it a complete rejection of all multiculturalism, for the state must be composed solely of one ethnic entity in order to have cultural stability and order.
The state which Freyer anticipated would also not do away with the technological achievements of capitalism but rather make use of them while bringing the economic system under its strict control (essentially “state socialism”), eliminating the existence of the economy as a “secondary system” and reintegrating it into the organic life of the Volk. This Völkisch state also served the necessary purpose of unifying the Volk under a single political force and guidance, for, along with Machiavelli and Carl Schmitt, Freyer believed it was essential that a people is capable and ready to defend itself against the ambitions of other states. For the sake of this unity, Freyer also rejected democracy due to the fact that he believed it inherently harmed the unity of the Volk as a result of the fact that it gave rise to a multiplicity of value systems and interest groups which competed for power; the state must be politically homogeneous. “The state is… the awakening of the Volk out of timeless existence [Dasein] to power over itself and to power in time.”[22]
Freyer also believed in both the inevitability and the importance of conflict in human existence: “War is the father of all things . . . if not in the literal sense then certainly for the thing of all things, the work of all works, that structure in which the creativity of Geist [“Spirit”] reaches its earthly goal, for the hardest, most objective and all-encompassing thing that can ever be created – for the state.”[23] The act of war or the preparation for war also served to integrate the people towards a single purpose, to give meaning to the individual by his duty to a higher power, the State. War was not something to be avoided, for, in Freyer’s philosophy, it had the positive result of intensifying the sense of community and political consciousness, as Freyer himself experienced during his time as a soldier in World War I.[24] Thus, “the state as a state is constituted by war and is continuously reconstituted by the preparation for war.”[25] Of course, this did not imply that the state had to constantly engage in war but rather in the preparation for war; war should be waged when diplomacy and strategy fails to meet the state’s demands.
Freyer’s Later Transformation
Hans Freyer believed, before its rise to power, that Hitler’s National Socialist movement constituted the force which would create the state of which he had written and hoped for. However, by the late 1930s he was disappointed by the repressive and basically “totalitarian” nature of the regime, and after World War II began to advocate a drastically different approach to the problems of modern society. He essentially became a moderate and partially liberal conservative (as opposed to being a “radical conservative,” which is a descriptor for his pre-war views), a change which was probably a result of his disappointment with the Third Reich coupled with the Reich’s downfall and the ensuing political changes thereafter.
Freyer concluded that the state was itself a “secondary system” (like those created by the market economy) and if used to organize the re-appropriation of tradition it would negatively distort cultural life. His new line of thought led him to the conclusion that the state should be limited (hence his subsequent support for democracy) and that welfare-state capitalism should be practiced because “it was less likely to create the degree of concentration of power characteristic of a socialist economy.”[26] Freyer still advocated the necessity of creating a sense of value in one’s own particular culture and traditions and a sense of collective meaning, but he believed that this should be done in the private sphere of life and through “private” institutions such as the family, the church, and local communities. Likewise, he no longer advocated a complete closure of society and he also recognized that the existence of a plurality of groups in the state was unavoidable.
We may conclude by pointing out that this transformation in Freyer’s position, while undoubtedly partly influenced by the existence of a new political regime, was also certainly not unjustified, for there is much to criticize in his earlier work. For example, it is certainly not unreasonable to question whether an authoritarian regime, a constant engagement or preparation for warfare, and a society completely closed to other societies are necessary to restore a sense of community and a value in one’s own culture and ethnicity.[27] On the other hand, one does not necessarily have to agree with all of Freyer’s later conclusions, for one could argue they are also not without imperfections. However, ultimately we gain from a view of his thought and its transformation with a wider, more informed philosophical perspective.
The Relevance of Freyer’s Thought Today
There is much in Freyer’s philosophy which is relevant to the current problems our world is facing (although we make no implication that his ideas are entirely unique to him), in some cases even more relevant today than in the time they were written. While his earlier notion of a complete cultural closure of society may be too extreme, in the face of the complete opening of society experienced in the later 20th Century and early 21st Century, it is quite clear that a partial level of closure, that is some (although not absolute) barriers, are necessary to return to a healthy cultural reality.[28] Likewise, his recognition of the importance of race in the cultural and social realm, going beyond the simplistic notion of race as being merely one’s genetic makeup, is pertinent today as far too many people do not even consciously understand the full role of race in culture and society.
Moreover, in light of the fact that the majority of former radical Leftists in most Western and also some Eastern nations have shifted towards the “Center” and have become merely defenders of the political status quo, Freyer’s commentaries on the compromises made by socialists in his time correspond with the present day situation as well. One may also argue that Freyer’s recognition of the importance of a “utopian” vision to guide political movements is necessary to change societies, for without a dream for a better world to motivate people it is not likely that the status quo could be overcome.
Finally, considering the exacerbated “individualism” (which, we must stress, is not merely recognizing the value of the individual, which is perfectly normal, but rather something extreme and anomalous) common in modern Western societies, Freyer’s stress on “collective meaning,” the most crucial concept at the center of his philosophy, is probably of the greatest importance. For today it is indeed the obsession with the individual, and the placing of the individual over ethnicity and culture, which is undoubtedly one of the most significant roots of the ethnic, cultural, and racial downfall of Europe and European-derived nations. Thus, our own quest corresponds to Freyer’s, for like him we must aim to re-establish collective meaning in order to salvage our ethnic and cultural integrity.
Notes
[1] For more in-depth information on Hans Freyer’s life, see Jerry Z. Muller, The Other God That Failed: Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism (Princeton: Princeton University Press, 1988), p. 93. We should note here to our readers that Muller’s book, despite its liberal bias, constitutes the single most important and extensive work on Freyer in the English language thus far.
[2] For an explanation of classical liberal theory concerning the individual as well as a critique of it, see Michael O’Meara, New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe. (Bloomington, Ind.: 1stBooks, 2004), pp. 57 ff. On the forms of liberalism through history, see also Paul Gottfried, After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State (Princeton: Princeton University Press, 2001).
[3] Ferdinand Tönnies, Community and Society (London and New York: Courier Dover Publications, 2002), pp. 64–65.
[4] Muller, The Other God That Failed, p. 93.
[5] Hans Freyer, Theory of Objective Mind: An Introduction to the Philosophy of Culture (Athens: Ohio University Press, 1999), p. 79. This is the only book by Freyer to be translated into English.
[6] Note that this entire general theory was expounded by Freyer in Theory of Objective Mind.
[7] Muller, The Other God That Failed, p. 94. Note that this notion is comparable to the theory of culture and the nature of human beings provided by Arnold Gehlen, who was one of Freyer’s students. See Arnold Gehlen’s Man: His Nature and Place in the World (New York: Columbia University Press, 1988) and also his Man in the Age of Technology (New York: Columbia University Press, 1980).
[8] Muller, The Other God That Failed, pp. 93 and 96.
[9] Colin Loader and David Kettler, Karl Mannheim’s Sociology as Political Education (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002), p. 123.
[10] Hans Freyer, Der Staat (Leipzig, 1925), p. 151. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 99.
[11] Hans Freyer, “Tradition und Revolution im Weltbild,” Europäische Revue 10 (1934) pp. 74–75. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 263.
[12] On Freyer’s concept of progress as well as some of his thoughts on economics, see Volker Kruse, Methodology of the Social Sciences, Ethics, and Economics in the Newer Historical School: From Max Weber and Rickert to Sombart and Rothacker (Hannover: Springer, 1997), pp. 196 ff.
[13] Hans Freyer, Prometheus: Ideen zur Philosophie der Kultur (Jena, 1923), p. 78. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 96.
[14] Freyer, Prometheus, p. 107. Quoted in Muller, The Other God That Failed, pp. 100–101.
[15] Muller, The Other God That Failed, p. 345.
[16] Ibid., p. 101.
[17] Loader and Kettler, Mannheim’s Sociology, p. 131.
[18] Hans Freyer, “Revolution from the Right,” in: The Weimar Republic Sourcebook, edited by Anton Kaes, Martin Jay, and Edward Dimendberg (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995), p. 347.
[19] Loader and Kettler, Mannheim’s Sociology, pp. 131–32.
[20] Muller, The Other God That Failed, p. 106.
[21] Freyer, Der Staat, p. 99. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 110.
[22] Hans Freyer, Revolution von Rechts (Jena: Eugen Diederich, 1931), p. 37. Quoted in Loader and Kettler, Mannheim’s Sociology, p. 126.
[23] Freyer, Der Staat, p. 143. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 113.
[24] See Muller, The Other God That Failed, p. 64.
[25] Freyer, Der Staat, p. 143. Quoted in Muller, The Other God That Failed, p. 113.
[26] Muller, The Other God That Failed, p. 348.
[27] On a “right-wing” perspective in contradistinction with Freyer’s earlier positions on the issue of democracy and social closure, see as noteworthy examples Alain de Benoist, The Problem of Democracy (London: Arktos, 2011) and Pierre Krebs, Fighting for the Essence (London: Arktos, 2012).
[28] On the concept of a balance between total closure and total openness, see also Alain de Benoist, “What is Racism?” Telos, Vol. 1999, No. 114 (Winter 1999), pp. 11–48. Available online here: http://www.alaindebenoist.com/pdf/what_is_racism.pdf [2].
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/02/hans-freyer-the-quest-for-collective-meaning/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/02/freyer1crop.jpg
[2] http://www.alaindebenoist.com/pdf/what_is_racism.pdf: http://www.alaindebenoist.com/pdf/what_is_racism.pdf
00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, révolution conservatrice, hans freyer, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 février 2013
Know Your Gnostics

Know Your Gnostics
Eric Voegelin diagnosed the neoconservatives' disease
Eric Voegelin often is regarded as a major figure in 20th-century conservative thought—one of his concepts inspired what has been a popular catchphrase on the right for decades, “don’t immanentize the eschaton”—but he rejected ideological labels. In his youth, in Vienna, he attended the famous Mises Circle seminars, where he developed lasting friendships with figures who would be important in the revival of classical liberalism, such as F.A. Hayek, but he later rejected their libertarianism as yet another misguided offshoot of the Enlightenment project. Voegelin has sometimes been paired with the British political theorist Michael Oakeshott, who greatly admired his work, but he grounded his political theorizing in a spiritual vision in a way that was quite foreign to Oakeshott’s thought. Voegelin once wrote, “I have been called every conceivable name by partisans of this or that ideology… a Communist, a Fascist, a National Socialist, an old liberal, a new liberal, a Jew, a Catholic, a Protestant, a Platonist, a neo-Augustinian, a Thomist, and of course a Hegelian.”
But whatever paradoxes he embodied, Voegelin was, first and foremost, a passionate seeker for truth. He paid no attention to what party his findings might please or displease, and he was willing to abandon vast amounts of writing, material that might have enhanced his reputation as scholar, when the development of his thought led him to believe that he needed to pursue a different direction. As such, his ideas deserve the attention of anyone who sincerely seeks for the origins of political order. And they have a timely relevance given recent American ventures aimed at fixing the problems of the world through military interventions in far-flung regions.
Voegelin was born in Cologne, Germany in 1901. His family moved to Vienna when he was nine, and there he earned a Ph.D. in political science in 1922, under the dual supervision of Hans Kelsen, the author of the constitution of the new Austrian republic, and the economist Othmar Spann. He subsequently studied law in Berlin and Heidelberg and spent a summer at Oxford University mastering English. (He commented that his English was so poor when he arrived that he spent some minutes wondering why a street-corner speaker was so enthusiastic about the benefits of cheeses, before he realized the man was preaching about Jesus.) He then traveled to the United States, where he took courses at Columbia with John Dewey, Harvard with Alfred North Whitehead, and Wisconsin with John R. Commons, where he said he first discovered “the real, authentic America.”
Upon returning to Austria, he resumed attending the Mises Seminar, and he published two works critical of the then ascendant doctrine of racism. These made him a target of the Nazis and led to his dismissal from the University of Vienna after the Anschluss. As with many other Austrian intellectuals, the onslaught of Nazism made him leave Austria. (He and his wife managed to obtain their visas and flee to Switzerland on the very day the Gestapo came to seize his passport.) Voegelin eventually settled at Louisiana State University, where he taught for 16 years, before coming full circle and returning to Germany to promote American-style constitutional democracy in his native land. The hostility generated by his declaration that the blame for the rise of Nazism could not be pinned solely on the Nazi Party elite, but must be shared by the German people in general, led him to return to the United States, where he died in 1985.
During his lifelong search for the roots of social order, Voegelin came to understand politics not as an autonomous sphere of activity independent of a nation’s culture, but as the public articulation of how a society conceives the proper relationship of its members both to one another and to the rest of the cosmos. Only when a society’s political institutions are an organic product of a widely shared and existentially workable conception of mankind’s place in the universe will they successfully order social life. As a corollary of his understanding of political life, Voegelin rejected the contemporary, rationalist faith in the power of “well-designed,” written constitutions to ensure the continued existence of a healthy polity. He argued that “if a government is nothing but representative in the constitutional sense, a [truly] representational ruler will sooner or later make an end of it… When a representative does not fulfill his existential task, no constitutional legality of his position will save him.”
For Voegelin, a truly “representative” government entails, much more crucially than the relatively superficial fact that citizens have some voice in their government, first of all that a government addresses the basic needs of “securing domestic peace, the defense of the realm, the administration of justice, and taking care of the welfare of the people.” Secondly, a political order ought to represent its participants’ understanding of their place in the cosmos. It may help in grasping Voegelin’s meaning here to think of the Muslim world, where attempts to create liberal, constitutional democracies can result in Islamic theocracies instead: the first type of government is “representative” in the narrow, constitutional sense, while the second actually represents those societies’ own understanding of their place in the world.
Voegelin undertook extensive historical analysis to support his view of the representative character of healthy polities, analysis that appeared chiefly in his great, multi-volume works History of Political Ideas—which was largely unpublished during Voegelin’s life because his scholarship prompted him to change the focus of his research—and Order and History. This undertaking was more than merely illustrative of his ideas, since he understood political representation itself not as a timeless, static construct but as an ongoing historical process, so that an adequate political representation for one time and place will fail to be representative in a different time or for a different people.
The earliest type of representation Voegelin described is that characterizing the ancient “cosmological empires,” such as those of Egypt and the Near East. Their imperial governments succeeded in organizing those societies for millennia because they were grounded in cosmic mythologies that, while containing cyclical phenomena like day and night and the seasons, depicted the sequence of such cycles as eternal and unchanging. They “symbolized politically organized society as a cosmic analogue… by letting vegetative rhythms and celestial revolutions function as models for the structural and procedural order of society.”
The sensible course for members of a society with such a self-understanding was to reconcile themselves to their fixed roles in the functioning of this implacable, if awe-inspiring, universe. The emperor or pharaoh was a divine being, the representative for his society of the ruling god of the cosmic order, and as remote and unapproachable as was that god. The demise of the cosmological empires in the Mediterranean world came with Alexander the Great’s conquests. After his empire was divided among his generals following his death, the new monarchs could not plausibly claim the divine mandate that native rulers had asserted as the basis of their authority since their ascension was so clearly based on military conquest and not on some ancient act of a god seeking to provide the now-conquered peoples with a divine guide.
The basis of the Greek polis was the Hellenic pantheon. When the faith in that pantheon was undermined by the work of philosophers, the polis ceased to be a viable form of polity, as those resisting its passing recognized when they condemned Socrates to death for not believing in the civic gods. The Romans, a people not generally prone to theoretical speculation, managed to sustain their republican city-state model of politics far longer than had the Greeks but eventually the stresses produced by the spoils of possessing a vast empire and the demands of ruling it—as well as the increasing influence of Greek philosophical thought in Rome—proved fatal to that republic as well.
Mediterranean civilization then entered a period of crisis characterized by cynical, imperial rule by the Roman emperors and an urgent search for a new ordering principle for social existence among their subjects, which produced the multitude of cults and creeds that proliferated during the imperial centuries. The crisis was finally resolved when Christianity, institutionalized in the Catholic Church, triumphed as the new basis for organizing Western society, while the Orthodox Church, centered in Constantinople, played a similar role in the East.
Voegelin contends that this medieval Christian order began to fracture due to the de-spiritualization of the Church that resulted from its increasing focus on power over secular affairs. Having succeeded in restoring civil order to Western Europe during the several centuries following the fall of Rome, the Church would have done best, as Voegelin saw it, to have withdrawn voluntarily “from its material position as the greatest economic power, which could be justified earlier by the actual civilizing performance.” Furthermore, the new theories of natural philosophy produced by the emerging “independent, secular civilization… required a voluntary surrender on the part of the Church of those of its ancient civilizational elements which proved incompatible with the new Western civilization… [but] again the Church proved hesitant in adjusting adequately and in time.”
The crisis caused by the Church’s failure to adjust its situation to the new realities came to a head with the splintering of Western Christianity during the Protestant Reformation and the ascendancy of the authority the nation-state over that of the Church.
The newly dominant nation-states energetically and repeatedly attempted to create novel myths that could ground their rule over their subjects. But these were composed from what Voegelin called “hieroglyphs,” superficial invocations of a pre-existing concept that failed to embody its essence because those invoking it had not themselves experienced the reality behind the original concept. As hieroglyphs, the terms were adopted because of the perceived authority they embodied. But as they were being employed without the context from which their original validity arose, none of these efforts created a genuine basis for a stable and humane order.
The perception of the hollow core of the new social arrangements became the motivation for and the target of a series of modern utopian and revolutionary ideologies, culminating in fascism and communism. These movements evoked what had been living symbols for medieval Europe—such as “salvation,” “the end times,” and the “communion of the saints”—but as the revolutionaries had lost touch with the spiritual foundation of those symbols, they perverted them into political slogans, such as “emancipation of the proletariat,” “the communist utopia,” and “the revolutionary vanguard.”
This analysis is the source of the phrase “immanentize the eschaton”: as Voegelin understood it, these revolutionary movements had mistaken a spiritual symbol, that of the ultimate triumphant kingdom of heaven (the eschaton), for a possible goal of mundane politics, and they were attempting to create heaven on earth (the immanentizing) through revolutionary action. He sometimes described this urge to create heaven on earth by political means as “Gnostic,” especially in what remains his most popular work, The New Science of Politics. (Voegelin later came to question the historical accuracy of his choice of terminology.)
But communism and fascism were not the only options on the table when Voegelin was writing: the constitutional liberal democracies, especially those of the Anglosphere, resisted the revolutionary movements. While Voegelin was not a modern liberal, his attitude towards these regimes was considerably more sympathetic than it was towards communism or fascism. He saw certain tendencies in the Western democracies, such as the near worship of material well-being and the attempted cordoning off of religious convictions into a purely private sphere, as symptoms of the spiritual crisis unfolding in the West. On the other hand, he believed that in places like Britain and the United States there had been less destruction of the West’s classical and Christian cultural foundations, so that the liberal democracies had retained more cultural resources with which to combat the growing disorder than was present elsewhere in Europe.
As a result, he firmly supported the liberal democracies in their effort to resist communism and fascism, and his return to Germany after the war was prompted by the hope of promoting an American-inspired political system in his native land. We can best understand Voegelin’s attitude towards liberal democracy as being, “Well, this is the best we can do in the present situation.”
He saw the pendulum of order and decay as always in motion, and he was convinced that one day a new cosmology would arise that would be the basis for a new civilizational order. In the meantime, the Western democracies had at least worked out a way for people with profoundly divergent understandings of their place in the cosmos to live decently ordered lives in relative peace. Always a realist, Voegelin was not one to look down his nose at whatever order it is really possible to achieve in our actual circumstances.
But the liberal democracies are liable to fall victim to their own form of “immanentizing the eschaton” if they mistake the genuinely admirable, albeit limited, order they have been able to achieve for the universal goal of all history and all mankind. That error, I suggest, lies behind the utopian adventurism of America’s recent foreign policy, in both its neoconservative and liberal Wilsonian forms. Voegelin’s analysis of “Gnosticism” can help us to understand better the nature of that tendency in Western foreign policy. (We can still use his term “Gnostic” while acknowledging, as he did, its questionable historical connection to ancient Gnosticism.)
Voegelin was no pacifist—for instance, he was committed to the idea that the West had a responsibility to militarily resist the expansive barbarism of the Soviet Union. Yet it is unlikely that he would have had any patience for the utopian Western triumphalism often exhibited by neoconservatives and Wilsonians.
What Voegelin called “the Gnostic personality” has great difficulty accepting that the impermanence of temporal existence is inherent in its nature. Therefore, as he wrote, the Gnostic seeks to freeze “history into an everlasting final realm on this earth.” The common view that any nation not embracing some form of liberal, constitutional democracy is in need of Western re-education, by force if necessary, and the consequent fixation on installing such regimes wherever possible, displays a faith that we in the West have achieved the pinnacle of social arrangements and should “freeze history.”
One of the chief vices Voegelin ascribes to Gnosticism is the will to live in a dream world and the reluctance to allow reality to intrude upon the dream. During the many years of chaotic violence following America’s “victory” in Iraq, the difficulty of continuously evading the facts on the ground compelled some who supported the war to admit that things did not proceed as envisioned in their prewar fantasy. Even so, few of these reluctant realists are moved to concede that launching the war was a mistake. A popular dodge they engage in is to ask critics, “So, you’d prefer it if Hussein was still in power and still oppressing the Iraqi people?”
That riposte assumes that, if a goal is laudable when evaluated in a vacuum from which contraindications have been eliminated, then pursuing it is fully justified. Unfortunately, as the post-invasion years in Iraq demonstrate, it was quite possible to depose Hussein while creating greater misfortunes for Iraqis. The Western moral tradition developed primarily by the Greek philosophers and Christian theologians denied that a claim of good intentions was a sufficient defense of the morality of an action. This tradition held that anyone seeking to pursue the good was obligated to go further, giving as much prudent consideration to the likely ramifications of a choice as circumstances allowed.
But in the Gnostic dream world, the question of whether the supposed beneficiaries of one’s virtuously motivated crusade realistically can be expected to gain or lose as a result of it is dismissed as an unseemly compromise with reality. What matters to the Gnostic revolutionary is that his scheme intends a worthy outcome; that alone justifies undertaking it. Such contempt for attending to the messy and complex circumstances of the real world is exemplified in the account of George W. Bush’s foreign policy that one of his advisers provided to a puzzled journalist, Ron Suskind, who described their encounter in the New York Times Magazine:
The aide said that guys like me were ‘in what we call the reality-based community,’ which he defined as people who ‘believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality.’ I nodded and murmured something about enlightenment principles and empiricism. He cut me off. ‘That’s not the way the world really works anymore,’ he continued. ‘We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality—judiciously, as you will—we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors… and you, all of you, will be left to just study what we do.’
As it became obvious that their Iraq adventure was not living up to its promise of rapidly and almost without cost producing a stable, democratic, and pro-Western regime in the midst of the Arab world, supporters of the war were loath to entertain the possibility that its failure was due to their unrealistic understanding of the situation. Instead, they often sought to place the blame on the shortcomings of those they nobly had attempted to rescue, namely, the people of Iraq. Voegelin had noted this Gnostic tendency several decades earlier: “The gap between intended and real effect will be imputed not to the Gnostic immorality of ignoring the structure of reality but to the immorality of some other person or society that does not behave as it should according to the dream conception of cause and effect.”
Much more could be said concerning the relevance of Voegelin’s political philosophy to our recent foreign policy, but the brief hints offered above should be enough to persuade those open to such realistic analysis to read The New Science of Politics and draw further conclusions for themselves.
While it is true that Voegelin resisted being assigned to any ideological pigeonhole, there are important aspects of his thought that are conservative in nature. He rejected the notion, sometimes present in romantic conservatism, that the solution to our present troubles can lie in the recreation of some past state of affairs: he was too keenly aware that history moves ever onward, and the past is irretrievably behind us, to fall prey to what we might call “nostalgic utopianism.” Nevertheless, he held that our traditions must be studied closely and adequately understood because, while it is nonsensical to try to duplicate the past, still it is only by understanding the insights achieved by our forebears that we can move forward with any hope of a happy outcome.
While historical circumstances never repeat, Voegelin understood human nature and its relation to the eternal to create a similar ground in all times and places, an insight that surely is at the core of any genuine conservatism. Thus, it is our task to recreate, in our own minds, the brilliant advances in understanding the human condition that were achieved by such figures as Plato, Aristotle, Augustine, and Aquinas. Those advances serve as the foundation for our efforts to respond adequately to the novel conditions of our time. Voegelin’s message is one that any thoughtful conservative must try heed.
Gene Callahan teaches economics at SUNY Purchase and is the author of Oakeshott on Rome and America.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric voegelin, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, états-unis, gnosticisme, gnoses, gnoses politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 février 2013
Kartographie als imperiale Raumgestaltung
Ute SchneiderKartographie als imperiale Raumgestaltung
|
|
Gliederung:
|
1. Der Kartograph Alexander (Sándor) Radó: Grenzgänger und Spion 2. Die Atlanten und ihre politischen Botschaften 3. Fazit: Überlegungen zur Rezeption und Bedeutung der Karten Anmerkungen Angaben zur Autorin Zitierempfehlung |
| Text: |
|
„[...] an der Wand rechts eine Karte des Gebiets, von einem deportierten früheren Offizier gezeichnet, an der linken Wand die Karte der Kommission für wirtschaftliche Planung; auf dieser Karte waren die Plätze der künftigen Fabriken, der Eisenbahnen, des Kanals, der drei Arbeitersiedlungen, der Bäder, der Schulen, der Sportplätze zu sehen, die in der Stadt errichtet werden sollten.“1 |
|
„L’Affaire Toulaêv“ nannte Victor Serge seinen 1948 in Frankreich publizierten Roman, in dem er den Terror in der Sowjetunion Stalins literarisch verarbeitete. Thema des Romans ist eine sich ins Hysterische steigernde bürokratische Untersuchung als Reaktion auf die Ermordung eines kommunistischen Politikers, die sich bald in die tiefsten Provinzen des Imperiums ausweitete. Maßgebliche Elemente des Romans sind die geopolitischen Bedingungen der Sowjetunion, ihre territoriale Ausdehnung, die Landschaft und die Topographie, die die „Verortungen“ und das Handeln der Akteure leiten und bestimmen. Ein Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit: Die Sowjetunion als Raum politischer Gestaltung wird nicht nur in Diskursen, Wirtschaftsplänen und theoretischen Schriften entworfen, sondern auch visuell erzeugt und genutzt. Die Karte als Repräsentation des Raumes, die einzelne Städte abbildet, aber weitaus häufiger das gesamte Staatsgebiet, liefert den Protagonisten einen „Möglichkeitsraum“,2 in den sie ihre Pläne und damit die Zukunft der Sowjetunion einschrieben. |
|
Die nicht wenigen Hinweise auf Karten in diesem Roman werfen verschiedene Fragen nach der Bedeutung von Karten in der Sowjetunion auf, aber auch nach ihrer Rolle bei der Entstehung und Repräsentation von Imperien im Allgemeinen. Beide Aspekte sind von der historischen Forschung noch kaum untersucht worden. Dies hängt - und die Sowjetunion stellt keineswegs einen Einzelfall dar - einerseits mit einer Vernachlässigung des Raumes und seiner kartographischen Repräsentationen auch von Seiten der zeithistorischen Forschung zusammen. Obgleich Karten zur Illustration und Veranschaulichung in der Geschichtswissenschaft weit verbreitet sind, spielen Karten als historische Quellen eine bisher völlig nachgeordnete Rolle. 2 |
|
Mehr als ein illustrativer Charakter kommt ihnen auch in der gegenwärtigen Debatte über Imperien in aktueller und historischer Perspektive selten zu. Das ist insofern verwunderlich, als gerade die Raumbeherrschung und die Konkurrenz um den Raum zu den zentralen Charakteristika von Imperien zählen.3 So finden sich bei Herfried Münkler zwar insgesamt elf historische Karten, die etwa die Ausdehnung des Seeimperiums der Athener, das russische Imperium und die gegenwärtige globale amerikanische Militärpräsenz abbilden. Im Text gibt es jedoch keine Verweise; und die Tatsache, dass dem Kartographen nirgendwo gedankt wird, legt die Vermutung nahe, dass der Verlag die Karten zur Veranschaulichung ergänzt hat. |
|
Spiel(t)en Karten in der Neuzeit in Europa - und diese Einschränkung ist wichtig, solange wir so wenig über die Kartenverwendung in früheren und gegenwärtigen Gesellschaften wissen - für Herrscher und Politiker beim Aufbau eines Imperiums und als Medium der Integration der Bevölkerung eine Rolle? Obgleich Münkler über die Ausbildung von Identität, über Bildungsprogramme sowie den Ausbau von Informations- und Mediensystemen spricht, werden Karten als Instrument, um in den Köpfen der Menschen eine Vorstellung vom Imperium und seiner Bedeutung oder Bedrohung zu verankern, überhaupt nicht thematisiert. Inwieweit stell(t)en Karten ein Mittel der Mobilisierung dar, und welches Bild vermittel(te)n sie? |
|
Dass die Bedeutung von Karten im Konstituierungsprozess von Imperien in der Neuzeit nicht gering veranschlagt werden darf, zeigen neuere Untersuchungen zum British Empire. Der Raum des Empire war seit dem frühen 19. Jahrhundert auf Weltkarten projiziert worden, lange bevor eine flächendeckende staatliche Durchdringung erreicht worden war. Durch eine monochrome Markierung in der Signalfarbe Rot oder aus Gründen der Handkolorierung in Rosa war eine Homogenität antipiziert worden, die anfänglich die christlichen Missionen und im späten 19. Jahrhundert Imperialisten wie Cecil Rhodes zur Erschließung und Inbesitznahme neuer Räume antrieb. Der Kartentypus fand weite Verbreitung über Zeitungen und andere Medien, so dass sich das Bild in den Köpfen aller Bewohner des Empire und nicht nur in Großbritannien einprägte. Als kognitive Karte oder mental map fanden Karten des British Empire Eingang in die Memoirenliteratur, Prosa und Poesie und damit in das kulturelle Gedächtnis, so dass man von einem britischen Erinnerungsort sprechen kann.4 3 |
|
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum Stellenwert von Karten als politischem und kulturellem Gestaltungsraum bei der Konstruktion des British Empire gewinnt die Frage nach ihrer Rolle bei dem Aufbau anderer Imperien wie etwa der Sowjetunion nach 1917 weitere Relevanz. Dass die Sowjetunion der Kartographie besondere Bedeutung beimaß, brachte sie 1934 durch die Gründung des „Instituts des großen Sowjet-Atlas“ in Moskau zum Ausdruck. Aufgabe dieses Instituts war es, den „größten Atlas“ der Welt zu schaffen.5 Ein Stab von 200 Mitarbeitern und eine Vielzahl von Wissenschaftlern waren mit dem Projekt befasst, das auf drei Bände angelegt war. Die ersten beiden Bände erschienen 1937 und fanden in Deutschland eine gemischte Aufnahme. Der dritte Band, der „Übersichts- und Wirtschaftskarten der ausländischen Staaten“ enthalten sollte, konnte wegen des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erscheinen. Der Redakteur dieses dritten Bandes war der Kartograph Alexander (Sándor) Radó (1899-1981), der nach eigenen Angaben auch an den Arbeiten der anderen Bände beteiligt war und sich seit den frühen 1920er-Jahren mit der Herstellung und Verbreitung eines kartographischen Bildes der Sowjetunion befasste.6 Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag in der thematischen Kartographie, und das Spektrum reichte von historischen Prozessen bis hin zu wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen der damaligen Gegenwart. Dass seine Karten dabei immer auch propagandistische Funktionen erfüllten, stellte nicht nur die Kritik fest, sondern war durchaus beabsichtigt.7 Die Kunst des Kartographen lag für Radó gerade darin, die Botschaft mit geeigneten technischen Mitteln so in die Karte zu zeichnen, dass sie vom Leser verstanden werden konnte. „Durch die Kombination von Zeichengrößen und beabsichtigten Kontrastwirkungen kann im Kartenbenutzer ein ‚furchterregendes‘ oder als Gegenteil ein ‚beruhigendes‘ psychisches Gefühl geweckt werden. Deshalb muß bei der Schaffung dieser Karten mit solchen beim Kartenbenutzer unbewußt auftretenden psychologischen Wirkungen gerechnet werden.“8 |
|
Radó wollte mit seinen Karten ein Bild der jungen Sowjetunion kreieren, das darauf zielte, im In- und Ausland ihre politisch-historische Entwicklung, ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen und nicht zuletzt ihre Rolle als politisches Imperium in der Welt hervorzuheben. Da aber jede Karte durch die Standortgebundenheit des Kartographen beeinflusst wird, selbst wenn sie nicht dezidiert zum Zweck der Propaganda entsteht, spiegeln seine Karten auch die wechselvolle Politik der Sowjetunion nach der Revolution wider. Zusammen mit weiteren Karten kam ihnen sogar eine prominente Rolle in der Minderheitenpolitik zu, mit all ihren gewaltsamen Folgen unter Stalin. Bevor einzelne dieser Karten vorgestellt werden, sei kurz ein Blick auf das Leben Radós geworfen, weil es sein Werk beeinflusste und zudem charakteristisch für zahlreiche Biographien des 20. Jahrhunderts ist. 4 |
1. Der Kartograph Alexander (Sándor) Radó: Grenzgänger und Spion |
|
Im Sommer 1968 fertigte der amerikanische Geheimdienst CIA ein geheimes Dossier über Alexander Radó an. Nicht ohne Bewunderung sprach sich der Autor dafür aus, Radó einen Platz im „pantheon of major intelligence figures of the times“ einzuräumen.9 Das Dossier stellt die wesentlichen Etappen im Leben Radós vor, wie sie wenige Jahre später auch in seiner Autobiographie zu lesen waren.10 Diese Memoiren, die unter dem Titel „Deckname Dora“ in West- bzw. „Dora meldet“ in Ostdeutschland erschienen, sind eines der wenigen Selbstzeugnisse, die von Radó bisher zugänglich sind. Das hängt mit seinem Leben in verschiedenen Diktaturen und einer generellen Furcht zusammen, unter diesen politischen Umständen persönliche Dokumente zu hinterlassen. Auch Radós Erinnerungen wurden in der Sowjetunion zensiert und korrigiert, sieht man einmal von den Glättungen ab, die er selbst vorgenommen hat.11 |
|
Der 1899 in Budapest geborene Alexander Radó entstammte dem vermögenden jüdischen Bürgertum. Als „Sohn bemittelter Eltern“ konnte er nicht nur das Gymnasium besuchen, sondern auch zur „Sommerfrische“ nach Italien und Österreich reisen.12 1918 wurde er einberufen, begann aber parallel dazu ein Jurastudium in Budapest und machte während der Revolution von 1918 die Bekanntschaft revolutionärer Sozialisten. Ende des Jahres trat er der Kommunistischen Partei Ungarns bei. Einer Leidenschaft seiner Kindheit folgend, begann er als Politkommissar für die ungarische „Rote Armee“ Landkarten zu zeichnen, für die es nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Armee großen Bedarf gab.13 Mit dem Ende der Räterepublik im Jahr 1919 floh Radó nach Wien und später nach Deutschland, wo er in Jena ein Studium der Kartographie begann. Unterbrochen durch mehrfache Reisen in die Sowjetunion, die er immer auch zum Kartographieren und Sammeln von Landkarten nutzte, beendete er sein Studium im Jahr 1924. In diesem Jahr erschien seine erste Karte der Sowjetunion im Braunschweiger Westermann-Verlag. Es folgten weitere Arbeiten über die Sowjetunion für zahlreiche große deutsche Atlanten. Nach eigenen Angaben war es Radó, der „für die Gebiete der UdSSR die sowjetische politische und geographische Einteilung und Terminologie“ einführte.14 Radó verfasste außerdem einen Reiseführer durch die Sowjetunion, der zu einem Standardwerk wurde, und war einer der ersten Kartographen, der die Luftfahrt für die Kartographie nutzte.15 1933 emigrierte Radó mit seiner Familie nach Paris und bereits drei Jahre später in die Schweiz. Jeden Ortswechsel verband Radó jeweils mit der Gründung einer geographischen Nachrichtenagentur, die die europäische Presse mit politischen und wirtschaftlichen Karten belieferte. Die Niederlassung in der Schweiz geschah auf Wunsch Moskaus und mit dem Ziel der Übernahme einer Spionagetätigkeit, zumal Radó „kein Neuling in der konspirativen Tätigkeit“ war.16 Unter dem Decknamen „Dora“ sammelte er militärische Informationen für die Sowjetunion und informierte sie während des Zweiten Weltkrieges etwa über die deutschen Pläne und Truppenbewegungen im Zusammenhang mit dem geplanten Angriff auf die Sowjetunion. Kurz vor der Enttarnung gelang es ihm unterzutauchen, und 1944 floh er schließlich nach Paris. |
|
Dort endet die Geschichte von Radós Spionagetätigkeit, und das Buch „Dora meldet“ schließt mit einem Ausblick auf die Schicksale seiner Weggefährten und Mitarbeiter. Den Faden seiner eigenen Biographie knüpft Radó erst mit dem Jahr 1955 an, in dem er „nach langen und schweren Prüfungen [...] endlich in meine Heimat zurückkehren“ konnte.17 Über sein Schicksal zwischen Kriegsende und der Rückkehr nach Ungarn im Jahr 1955 erfahren wir nur, dass er „1948 infolge des Stalinschen Personenkults spurlos verschwunden war“.18 Ihm erging es so wie zahlreichen anderen Kommunisten, die in Spanien und an anderen Fronten für ihre Überzeugung gekämpft hatten. Viele von ihnen waren ebenfalls jüdischer Herkunft, doch nur wenige hatten wie er das Glück, die Straflager zu überleben.19 Die CIA wusste über den Verbleib Radós immerhin zu berichten, dass er in Moskau zu 15 Jahren Arbeitslager in Sibirien verurteilt worden war. Inwieweit es gute Beziehungen oder seine fachlichen Kenntnisse waren, die ihn in ein geophysikalisches Observatorium in die Nähe von Moskau brachten, war auch der CIA nicht bekannt. Der US-Geheimdienst wusste aber, dass Radó dort ein „prisoner with privileges“ war, der sich mit Kartenproblemen und militärischen Navigationssystemen befasste.20 5 |
|
Im Zuge der Entstalinisierung konnte Radó 1955 nach Ungarn zurückkehren. Beruflich begann er eine neue Karriere in der staatlichen Kartographie, und er zeichnete fortan mit der ungarischen Variante seines Namens: Sándor. Der kommunistische Kosmopolit Radó, der 1920 der sowjetischen KP beigetreten war, setzte mit diesem Wechsel ein Zeichen des Neuanfangs unter Betonung seiner ungarischen Herkunft und Verbundenheit. In beruflicher Hinsicht knüpfte Radó in Ungarn an beide Stränge seines Lebens vor 1945 an - er setzte sowohl seine kartographischen Projekte als auch seine geheimdienstliche Tätigkeit fort. Von letzterem ging zumindest die CIA aus, die Ungarn als eine Art geographisches Spionagezentrum betrachtete. Sukzessive strukturierte Radó die ungarische Kartographie und ihre Publikationen um und machte etwa die dreisprachig erscheinende Zeitschrift „Cartactual“ zu einem vor allem im westlichen Ausland angesehenen Organ.21 1967 begann Radó mit der Erstellung von Karten für die politische Schulung und die Propagandaarbeit. Innerhalb weniger Jahre erschienen mehr als 200 verschiedene Plakatkarten und Kartenblattserien, die in Schulen, Betrieben und Bibliotheken Verwendung fanden. Die Karten informierten über ein breites Themenspektrum, das von den „Überschwemmungen in Ungarn im Jahr 1970“ bis zu den „Errungenschaften und Aufgaben der Industrieentwicklung 1971-1975“ reichte. Der Schwerpunkt lag bei nationalen Themen und den sozialistischen Staaten; einzelne Karten befassten sich aber auch mit dem nichtsozialistischen Ausland.22 |
|
Seine kartographischen Fähigkeiten und seine Sprachkompetenzen - Radó sprach mindestens sechs Sprachen fließend - beförderten sein internationales Ansehen und seine Macht.23 Mit zahlreichen Ehren ausgezeichnet starb Radó im Jahr 1981. Viele seiner Projekte wurden weit über seinen Tod hinaus fortgeführt, und in Ungarn gilt er bis heute als der Begründer der nationalen und politischen Kartographie.24 Neben seiner politischen Überzeugung, an der Radó sein Leben lang festhielt - er nutzte keine seiner zahlreichen Westreisen zur Flucht -, war es die fachliche Kompetenz, die sein Überleben und eine zweite Karriere ermöglichte. Die Biographie Radós ist insofern nicht untypisch für das 20. Jahrhundert, als es in den sozialistischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Intellektuelle gab, deren Leben durch die Diktaturen mehrfache Brüche erfahren hatte. György Konrád und Iván Szelényi, die sich intensiv mit der osteuropäischen Intelligenz und ihren Mechanismen des Machterhalts und -ausbaus befasst haben, bezeichneten diesen Intellektuellentypus als „Doppelstaatsbürger von Partei und Fach“. „Ideologische Vertrauenswürdigkeit“ und die fachliche Qualifikation sicherten langfristig die Position dieser Doppelstaatsbürger, unabhängig von politischen Konjunkturen und Richtungswechseln.25 6 |
|
2.1. Der „Atlas für Politik Wirtschaft Arbeiterbewegung“. Im Jahr 1930 erschien in Deutschland und ein Jahr später in Japan der erste von drei geplanten Bänden eines Atlasses unter dem Titel „Atlas für Politik Wirtschaft Arbeiterbewegung“. Aus politischen Gründen blieb es jedoch bei diesem ersten Teil, der den Imperialismus zum Thema hat.26 Den Einband hatte John Heartfield gestaltet, und das Vorwort stammte aus der Feder des stellvertretenden Volkskommissars des Äußeren, Fjodor Rothstein, der auf den Zusammenhang von Geographie, Geschichte und Politik hinwies.27 Radó geht in seinen Memoiren und im Vorwort zum Reprint von 1980 auf die Entstehung des Atlasses ein; indem er ihn auf ein Gespräch mit Lenin zurückführt, stellt er sich und sein Werk in eine unmittelbare Traditionslinie zur Russischen Revolution. Diese Verbindung unterstreicht er zusätzlich durch den Hinweis, dass ihm Lenin bei der Kartensuche geholfen habe.28 |
|
Unterteilt in sechs Kapitel stellt der Atlas auf schwarz-weißen und farbigen Karten politische und wirtschaftliche Themen und Entwicklungen vor. Zahlreiche dynamische Karten markieren mit dicken roten und schwarzen Pfeilen unterschiedliche Beziehungen und Bewegungen zwischen einzelnen Staaten. Die Sowjetunion springt dem Betrachter auf vielen Karten förmlich entgegen, weil sie durch ein kräftiges Rot hervorgehoben wird. Rot ist nicht nur eine Signalfarbe, die Bedeutung markiert und hervorhebt, sondern auch die symbolische Farbe des Sozialismus und Kommunismus. |
|
Wie bereits erwähnt, war Rot bzw. Rosa außerdem die Farbe, die Großbritannien seit dem 19. Jahrhundert in der Kartographie zur Hervorhebung des British Empire nutzte. Radó war sich der Wirkung von Farben bewusst und kannte möglicherweise sogar die Karten des Empire; zudem hatte sich die Zuordnung von Rot und Empire nicht nur in Großbritannien durchgesetzt. Indem Radó die Sowjetunion in diesem grellen Rot und monochrom markierte, betonte er sie nicht nur, sondern zeigte den Betrachtern vielmehr, dass das neue Imperium seinen Raum und Platz in der Welt beanspruche und die Konkurrenz mit den alten Imperien aufnehme. Die farbliche Hervorhebung wurde durch die Wahl der Projektion verstärkt, denn die von Radó bevorzugte Mercatorprojektion begünstigte die Flächengröße der Sowjetunion. Die kartographischen Mittel und die Absicht, „plakatartig“ zu wirken, fielen den Rezensenten des Werkes auf, die teilweise äußerst detailliert auf inhaltliche und dar-stellerische Fehler im Atlas eingingen. Die Rezensenten waren sich einig, dass dieser Atlas als ein „hochinteressantes Dokument für die Art sowjetrussischer Propaganda in Deutschland zu werten“ sei.29
|
 „Die Einkreisung der Sowjetunion durch den Britischen Imperialismus“ (aus: Radó, Atlas [Anm. 26], S. 91) |
|
Zahlreiche Karten vermitteln auch das Bild einer isolierten Sowjetunion. Das gilt weniger für eine Karte, die explizit den Titel „Die Isolierung der Sowjetunion in Europa“ trägt, aber kaum mehr als die westlichen Nachbarn von Finnland bis zur Türkei zeigt,30 als vielmehr für solche Karten, die etwa „Das Rüsten zum nächsten Krieg“ zeigen. Eine geradezu „unbewaffnete“ Sowjetunion, die hauptsächlich ihre Grenzen verteidigt, wird dieser Karte zufolge von hochgerüsteten europäischen und asiatischen Staaten eingekreist und bedroht.31 Mit diesem Bild knüpfte Radó an ältere Wahrnehmungsmuster an, die auf Gefühlen von Bedrohung durch die Nachbarn Russlands basierten. Der Atlas, der sich heute in erstaunlich vielen Bibliotheken findet, war aber weit mehr als ein Propagandainstrument; er spiegelt auch die sowjetische Politik und ihre Konjunkturen in den ersten Jahren nach der Revolution wider. Beispiele dafür sind die Benennungen und der Umgang mit den zahlreichen Ethnien im Vielvölkerreich.
|
 „Die proletarische Großmacht - Die Sowjetunion“ (aus: Radó, Atlas [Anm. 26], S. 43) |
|
Während Radó auf allen Karten - mit Ausnahme derjenigen des Zarenreichs - die Benennung „Sowjetunion“ wählt (in unterschiedlichen Schreibweisen), spricht er auf dieser Karte von „Russland“. Hier spiegelt er die russische und städtische Dominanz in der bolschewistischen Partei.32 Sie führte mit dem Sieg und der Ausdehnung der Bolschewiki bis an die Peripherie zu erheblichen Problemen. Denn es stellte sich mit aller Vehemenz die Frage nach dem Umgang mit der multiethnischen Heterogenität. Während vor allem linke Intellektuelle gegen eine „Nationalisierung des sozialistischen Projekts“ votierten,33 sprach sich Lenin für das Prinzip der Ethnizität aus, und Stalin teilte die Sowjetunion in Republiken mit unterschiedlichem Autonomiestatus ein. Diese Politik der Regionalisierung ging mit statistischen Erhebungen und Untersuchungen einher. Das Ergebnis war eine Fokussierung auf die Minderheiten, ihre Klassifizierung und Zuweisung zu bestimmten Territorien, die schließlich auf Karten dokumentiert und mit Grenzen markiert wurden. Die an diesem Prozess beteiligten Experten - „Ethnologen, Orientalisten und Statistiker“ - entwickelten im wahrsten Sinne des Wortes „Kriterien, die es ihnen erlaubten, die ethnische Landkarte neu zu vermessen und das Imperium als Verbund von Nationen zu strukturieren“.34 Die Karten schließlich machten dies sichtbar und erleichterten den zweiten Schritt, eine brutale Sowjetisierungspolitik und die erzwungene Integration in die Union.35 7
|
 „Die Lösung der nationalen Frage in der Sowjetunion“ (aus Radó, Atlas [Anm. 26], S. 157) |
|
In Radós Atlas erscheinen Ethnien noch wenig relevant. Mit Ausnahme der Karte der „proletarischen Großmacht“, die auf die Republiken auch im begleitenden Text ausdrücklich hinweist, erwähnt Radó sie nicht und zeichnet vielmehr einen homogenen, nationalen Raum. Die Sowjetunion unterscheidet sich damit nicht von der Darstellung der anderen Staaten, die ebenfalls als homogene Blöcke markiert sind. Der Atlas verschweigt aber nicht generell die in der Zwischenkriegszeit virulente Nationalitätenfrage; er dokumentiert Minderheiten in zahlreichen europäischen Staaten und in Nordamerika. Dabei lässt Radó auch die Sowjetunion nicht aus.
|
 „Nationalitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika“ (aus: Radó, Atlas [Anm. 26], S. 145) |
|
Die beiden Karten unterscheiden sich jedoch grundlegend. Im Fall Nordamerikas präsentiert Radó keineswegs ein monochromes Bild, sondern ein Territorium, das von Reservaten der „Indianer“ - in roten Blöcken dargestellt - und Ansiedlungen der „Neger“ - in schwarzen Kreisen, die sich vor allem im Osten finden - wie ein Flickenteppich durchsetzt ist. Dass Radó sich für die Farben Rot und Schwarz entschieden hat, ist, auf einer symbolischen Ebene betrachtet, durchaus naheliegend und entspricht kartographischen Prinzipien. Auffällig ist aber, dass Rot auch die „weiße“ und asiatische Bevölkerung repräsentiert, obwohl die politische Sympathie Radós bei der „neu entstandenen schwarzen Arbeiterklasse“ lag, deren Aufgabe es sei, „nicht nur die Befreiungsbewegung der Neger in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch der kolonial versklavten Negermassen in Afrika und in Mittel- und Südamerika zu führen“.36 In der Gesamtschau werden die Vereinigten Staaten von Amerika von Radó als ein Territorium präsentiert, das in ethnische Gruppen zersplittert ist und sich nicht als homogener Staat entwickeln kann. |
|
Die Unterschiede zur Repräsentation der Sowjetunion könnten kaum größer sein. Hier zeigt Radó ausschließlich die politische Gliederung (Karte s.o., Abschnitt 7), während die „fast 200 Nationalitäten“, die er im Begleittext erwähnt, nicht differenziert und lokalisiert werden. Das entspricht der offiziellen Politik der Sowjetunion in den frühen 1920er-Jahren, die den „Gliedstaaten“ sehr unterschiedliche Formen von Autonomie gewährte, aber gerade erst mit der Erstellung differenzierter Karten der ethnischen Verteilung auf der Basis statistischer Erhebungen begann. Die Karte Radós dokumentiert gewissermaßen diesen Prozess der Regionalisierung, in dem sich die Sowjetunion befand. Sieht man einmal von den wenigen Karten zur Nationalitätenfrage ab, repräsentiert Radó die Sowjetunion als einen monochromen und damit homogenen politischen Raum. Indem der Atlas außerdem Bodenschätze und Industrie, Verkehrsverbindungen und militärisches Potenzial auf dem Territorium der Sowjetunion überwiegend verschweigt, erscheint diese rote Fläche ohne die Merkmale, mit denen Radó die „imperialistischen“ Staaten charakterisierte. Hier bot sich - so eine mögliche Lesart - dem „neuen Menschen“ ein breites Betätigungsfeld beim Aufbau einer kommunikativen Vernetzung, bei der Industrialisierung, kurz beim Aufbau eines Imperiums unter der Farbe und den Zeichen des Sozialismus. Erste Erfolge einer solchen Aufbauleistung konnten die Briten im Jahr 1938 zur Kenntnis nehmen, als Radó mit seinem „Atlas of To-day and To-morrow“ „a snapshot photograph of our rapidly changing world“ publizierte.37 8 |
|
|
|
2.2. „The Atlas of To-day and To-morrow“. Dieser im Format etwas kleinere Atlas enthält in den sechs Kapiteln deutlich mehr Karten, die außerdem in viel ausführlicheren Texten und durch zahlreiche Statistiken erläutert werden. Im Unterschied zum deutschen präsentiert der englische Atlas ausschließlich schwarz-weiße Karten, so dass die Sowjetunion dem Leser trotz der Mercatorprojektion nicht so dominant ins Auge springt. Zudem - hier spiegeln sich die politischen Veränderungen der 1930er-Jahre - vermittelt der Atlas ein anderes Bild der Sowjetunion und ihrer Stellung innerhalb der Staatengemeinschaft. Sie wird als gleichrangige politische, militärische und ökonomische Macht exponiert. Auf einer Karte zum weltweiten militärischen Potenzial erscheint die Sowjetunion längst nicht mehr als der bedrohte, eingekreiste und wehrlose Staat wie noch in der deutschen Ausgabe. Auch wenn sie im Vergleich zu den anderen Staaten nicht über eine umfangreiche Flotte verfügte, so stellte Radó sie hinsichtlich der aktiven Armee bereits als zweitstärkste militärische Macht nach China dar.38 |
|
Neben der Gleichrangigkeit betont der englische Atlas die Eingebundenheit und Vernetzung der Sowjetunion etwa durch mehrere Kommunikations- und Verkehrskarten, die Radó in diese Ausgabe aufnahm. Die Sowjetunion ist Bestandteil eines globalen Netzwerkes von Kommunikations-, Kapital- und Güterströmen. Dass diese Vernetzung, heute als Globalisierung bezeichnet, nicht nur ein Spezifikum der Sowjetunion war, brachten die Rezensenten zum Ausdruck. Ihr Urteil über den Wert der Karten und deren Informationsgehalt fiel positiver aus als beim deutschen Vorläufer. Zwar fanden die Rezensenten wieder kleinere Fehler, erachteten die Bezeichnungen als „Norwegian“ and „Danish Empire“ als weit herbeigeholt und wiesen auf die politischen Implikationen des Atlasses hin, betonten aber im Gegenzug die besondere Bedeutung des Kartenmaterials und des Atlasses insgesamt, zumal in einer Zeit, in der die Welt schrumpfe.39 Die andere Qualität der Karten, die auf statistischem Material beruhten und zudem durch umfangreiche Statistiken ergänzt wurden, hing einerseits mit den konzentrierten Bemühungen um statistische Erhebungen in der Sowjetunion zusammen, war andererseits aber auch eine Frage des Zugangs. Radó arbeitete seit 1936 in Genf und konnte hier zusätzlich zu dem sowjetischen Material die Bibliothek des Völkerbundes nutzen. Bei der Erstellung der Karten für den Atlas war ihm außerdem die Tochter eines hohen polnischen Beamten des Völkerbundes behilflich, die selbst Kartographin war.40 |
|
Mehr als eine veränderte kartographische Darstellungsform bietet Radó auch im Umgang mit der Nationalitätenfrage, der in diesem Atlas ebenfalls ein Kapitel gewidmet ist. Zum einen findet sich auch hier wieder eine Karte zur politischen Struktur, die allerdings im Gegensatz zur deutschen Ausgabe die einzelnen Republiken grafisch deutlich voneinander abgrenzt. Russland erscheint als monochromer Block, durchsetzt von einzelnen autonomen Territorien, während die Republiken der Föderation in der Schraffur deutlich hervorgehoben und unterschieden werden. Die zugehörige Statistik enthält zudem genaue Angaben zu den jeweiligen Bevölkerungszahlen. Die Karte gibt zwar auch die offizielle Politik der 1920er-Jahre wieder, zieht im Gegensatz zur deutschen Ausgabe aber klare Grenzen zwischen den Teilrepubliken und bildet damit, obgleich es um die politische Struktur geht, einen weiteren Schritt bei der Klassifikation von ethnischen Minderheiten ab. Der Prozess von nationalen Zuschreibungen und Zuordnungen war eine Folge der sowjetischen „Indigenisierung und Nationalisierung von Herrschaft“,41 die nicht selten zuerst auf Karten dokumentiert wurde. 9 |
 „Political Structure of the Soviet Union“ (aus: Radó, The Atlas [Anm. 37], S. 59) |
|
Nachdem unter Stalin die Politik der Sowjetisierung und eine gewaltsame Unterdrückung der Minderheiten einsetzte, zeigten diese Karten den „Feind“ im Innern; sie konnten zu seiner Verortung und zu gezielten politischen Maßnahmen genutzt werden. Aus Moskau berichten Zeitzeugen, dass es Ende der 1930er-Jahre dort geradezu eine Obsession war, Nachbarn und Kollegen nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu klassifizieren.42 Einer besonderen Gefahr waren gerade die Minoritäten ausgesetzt, die als eine Gefährdung der Homogenität des nationalen Territoriums betrachtet wurden. „Nur national homogene Landschaften waren auch moderne Landschaften“, schreibt Jörg Baberowski zu dieser Ausprägung des Stalinschen Terrors.43 Damit verweist Baberowski auf mentale Kartenbilder wie die von Radó produzierten, die die Sow-jetunion schon in den 1920er-Jahren als eine homogene, moderne Landschaft gezeigt hatten. Dieser Vorstellung folgen letztlich auch die anderen Karten des englischen Atlasses, der die politische Struktur nur auf dieser Karte wiedergibt und die Sowjetunion ansonsten als monochromes Territorium repräsentiert. |
|
Von den Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts unterschied sich die Sowjetunion unter Stalin wohl im Terror, nicht aber in der Vorstellung von „homogenen Landschaften“. Auch andere Staaten hatten umfangreiche Homogenisierungsprogramme in die Wege geleitet und nationale Minderheiten politisch ausgegrenzt, von ihren Karten ausgeschlossen oder „verortet“, um eine gezielte Politik etwa der Germanisierung durchsetzen zu können. Dass Radó sich dieser Parallelen bewusst war, zeigen seine Karten zu anderen europäischen Staaten, deren Nationalitäten er in sehr differenzierten Karten festhielt.44 Bei der Darstellung der gesamten Sowjetunion folgte Radó dagegen in der Regel dem Homogenisierungsmodell und zeichnete eine monochrome Landschaft herbei, ohne dass sie überhaupt existierte. Er nutzte den „Möglichkeitsraum“ der Karte, um Strukturen, Status und Ziele der Sowjetunion als einer politischen und ideologischen Gemeinschaft festzuhalten. Die Parallelen zum British Empire sind nicht zu übersehen, wo Verbund und Homogenität ebenfalls auf Karten projiziert und antizipiert worden waren. 10 |
3. Fazit: Überlegungen zur Rezeption und Bedeutung der Karten |
|
Da Radó seine Atlanten im Westen publizierte, stellt sich die Frage nach dem Stellenwert und der Wirkung seiner Karten in Europa und in der Sowjetunion. Wer hat sie überhaupt gesehen und benutzt? Im Hinblick auf Europa sprechen die zahlreichen Bibliotheksbestände und die Rezensionen für eine breitere Rezeption. Wer den Atlas letztlich kaufte und las, wissen wir aber nicht genau. Im Fall der Sowjetunion ist davon auszugehen, dass Radó über gute und intensive Kontakte verfügte; er wird für eine Verbreitung des Werks in den Kreisen seiner politischen und professionellen Freunde gesorgt haben. Dass Karten eine große allgemeine Bedeutung zukam, zeigt die Einrichtung einer Kommission zur Erfassung und Untersuchung der Ethnien (KIPS/IPIN), die ihre sozialstatistischen Erhebungen auch kartographisch veranschaulichte. Einen dieser statistischen Atlanten bekam Walter Benjamin in Moskau zu Gesicht, der überhaupt nach seinem Besuch prognostizierte, dass die Landkarte „nahe daran“ sei, „ein Zentrum neuen russischen Bilderkults zu werden wie Lenin Portraits“. Denn „auf der Straße, im Schnee, liegen Landkarten von SSSR, aufgestapelt von Straßenhändlern, die sie dem Publikum anbieten“.45 |
|
Wie bereits erwähnt, wurde 1934 in Moskau das „Institut des großen Sowjet-Atlas“ gegründet. Radó war an diesem Werk beteiligt, und zahlreiche der dort abgebildeten Karten weisen deutliche Parallelen zu seinen Karten aus den 1920er- und 1930er-Jahren auf. Auch dieser Atlas zeigt eine Karte zur „derzeitigen politischen Einteilung“. Die Republiken werden dort aber nicht als selbstständige politische Einheiten repräsentiert, sondern die gesamte Sowjetunion zeigt sich in monochromem Rot.46 Die rote Farbe wählten die Kartographen auch für eine vierteilige Karte, die die Kollektivierung zwischen 1928 und 1936 abbildet. Der historische Prozess wird farblich untermauert, indem sich die Sowjetunion in der Farbgebung von Gelb über Orange bis zu Rot im Jahre 1936 verändert. Andere Karten in diesem Atlas zeigen den Ausbau einer Infrastruktur in der Sowjetunion und die weltweite Vernetzung, die ihren Ausgangspunkt immer im Zentrum Moskau hat. Deutsche Kartographen, die diesen Atlas in umfassenden Besprechungen würdigten, betonten zwar die Modernität der Karten und die zahlreichen methodischen Anregungen, kritisierten aber auch die „agitatorischen Gesichtspunkte“, die bei zahlreichen Karten im Vordergrund stünden. |
 Kollektivierung der Bauernwirtschaften in der UdSSR 1928-1936 (aus: Gorkin, Bol’soj sovetskij atlas mira [Anm. 5], S. 159) |
|
Alle diese Karten bekamen die Menschen in der Sowjetunion in der einen oder anderen Form im Zuge der Regionalisierung und Sowjetisierung und den damit verbundenen Alphabetisierungskampagnen zu Gesicht. Dass die Karten langfristig ein Bild von der Sowjetunion und ihrer Rolle als einer der beiden Weltmächte mitprägten, zeigte sich nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Für viele Menschen innerhalb und vielmehr noch außerhalb der Sowjetunion gehörte das „Auftauchen“ zahlreicher Ethnien zu den überraschenden Erfahrungen, die mit ihrer Vorstellung vom einheitlichen Sowjet-menschen in einem homogenen Staat nicht zusammenpassten. Die jungen Staaten, die im Zuge dieser Auflösung entstanden, mussten und müssen zum Teil bis heute ihren Ort in der Welt noch finden. Relationen wie „Osten“ und „Westen“ haben sich förmlich verschoben, und ein Blick auf die aktuelle Karte lässt in vielen Staaten die Frage nach der Zugehörigkeit zu Europa in einem anderen Licht erscheinen. Im Verbund der alten Sowjetunion war dies ein selbstverständlicher Bestandteil sowjetischer Identität. Die hier vorgestellten Karten veranschaulichten das bis in die 1980er-Jahre vorherrschende Paradigma, das die Ideologie und die imperiale Macht der Sowjetunion mit dem Zentrum in Moskau betonte.47 Zu fragen wäre allerdings, inwieweit gerade die Diskrepanz zwischen „zukunftsorientierten“ und idealisierten Repräsentationen einerseits und alltäglichen Erfahrungen andererseits zur politischen Auflösung des Sowjetimperiums beigetragen hat. |
|
Als einziges Medium sind Karten geeignet, die räumliche Ausdehnung in ihren realen Bezügen und als Projektionsraum geopolitischer, zivilisatorischer oder anderer Ambitionen zu veranschaulichen. Das gilt gleichermaßen nach außen wie nach innen. Veranschaulichungen sind ein Bestandteil der „imagined communities“,48 eine Charakterisierung, die sicherlich auch für Imperien ihre Gültigkeit hat. Zu den Bausteinen dieser Gemeinschaften gehören spätestens seit dem 19. Jahrhundert der Raumbezug und die Raumvorstellung, die sowohl auf historische Wurzeln als auch in die Zukunft verweisen. |
| Anmerkungen: |
1 Victor Serge, Die große Ernüchterung. Der Fall Tulajew, Hamburg 1950, S. 116. 2 David Gugerli/Daniel Speich, Topografien der Nation. Politik, kartografische Ordnung und Landschaft im 19. Jahrhundert, Zürich 2002, S. 84. 3 Herfried Münkler, Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 2005, S. 11ff. Inzwischen liegen einige Arbeiten vor, die das Kartographieren von Imperien untersuchen - in vielen Fällen jedoch, ohne die Karten selbst als Quellen zu betrachten. Vgl. Matthew H. Edney, Mapping an Empire. The Geographical Construction of British India, 1765-1843, Chicago 1997; Francine Hirsch, Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union, Ithaca 2005. Im Vordergrund stehen die Karten bei Thomas J. Bassett, Cartography and Empire building in Nineteenth-Century West Africa, in: The Geographical Review 84 (1994), S. 316-335. 4 Ute Schneider, Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute, Darmstadt 2004, S. 120ff. Dazu demnächst Zoe Laidlaw, Das Empire in Rot. Karten als Ausdruck des britischen Imperialismus, in: Christof Dipper/Ute Schneider (Hg.), Kartenwelten. Der Raum und seine Repräsentation in der Neuzeit, Darmstadt 2006 (im Druck). Siehe auch William O’Reilly, Zivilisierungsmission und das Netz des British Empire. Sprache, Landvermessung und die Förderung des Wissens 1780 - 1820, in: Boris Barth/Jürgen Osterhammel (Hg.), Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert, Konstanz 2005, S. 101-124. 5 Aleksandr Fedoroviéc Gorkin (Hg.), Bol’soj sovetskij atlas mira, Moskva 1937; Bruno Krömke, Der Große Sowjet-Weltatlas, in: Zeitschrift für Geopolitik 19 (1942), S. 332-335; H.[ans] Spreitzer, Der Große Sowjet-Weltatlas, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1940, S. 69-74. 6 Sándor Radó, Dora meldet, Berlin (Ost) 1974, S. 89. 7 Jeremy Black sieht wegen des propagandistischen Charakters vor allem in Radós erstem Atlas aus dem Jahre 1930 ein marxistisches Pendant zu nationalsozialistischen geopolitischen Propagandakarten. Zu ihren Aussagen und ihrem Stellenwert bei der Ausbildung eines territorialen Konzeptes und kognitiver Karten ist damit nichts gesagt. Auf die Funktion von Propagandakarten bei der Ausbildung von „Territorialkonzepten“ und ihre prägende Kraft hinsichtlich räumlicher Vorstellungen hat Guntram Herb in verschiedenen Untersuchungen hingewiesen. Siehe auch Jeremy Black, Maps and History. Constructing Images of the Past, New Haven 1997, S. 125f.; Guntram Henrik Herb, Under the Map of Germany. Nationalism and Propaganda 1918-1945, London 1997; ders., Von der Grenzrevision zur Expansion: Territorialkonzepte in der Weimarer Republik, in: Iris Schröder/Sabine Höhler (Hg.), Welt-Räume. Geschichte, Geographie und Globalisierung seit 1900, Frankfurt a.M. 2005, S. 175-203. 8 Sándor Radó, Die Karte als Mittel der politischen Bildung, in: Petermanns Geographische Mitteilungen 118 (1974), S. 75ff., Zitat S. 76. 9 Louis Thomas, Alexander Rado, in: Studies in Intelligence 12 (1968), S. 41-61. Zu dem Bild des „Meisterspions“ hat nicht zuletzt Arthur Koestler beigetragen, der dem ehemaligen Parteigenossen und Kollegen in seiner Biographie ein Kapitel unter dem Titel „Einem Meisterspion zum Gedenken“ widmete. Das gesamte Kapitel steht unter der Vermutung Koestlers, dass Radó, der sich in einem sowjetischen Lager befand, nicht mehr am Leben sei (Arthur Koestler, Die Geheimschrift. Bericht eines Lebens 1932 bis 1940, Wien 1955, S. 318-326). 10 Sándor Radó, Deckname Dora, Stuttgart 1971; ders., Dora meldet (Anm. 6). 11 Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003, S. 230. 12 Radó, Dora meldet (Anm. 6), S. 28f. 13 Ebd., S. 36ff. 14 Alex Radó, Politische und Verkehrskarte der Sowjet-Republiken, Braunschweig 1924; ders., Dora meldet (Anm. 6), S. 88. 15 Ders., Dora meldet (Anm. 6), S. 90f., S. 100-109; ders., Führer durch die Sowjetunion, Moskau 1925; ders., Avio Führer: Führer für Luftreisende, Bd. I: Flugstrecke Berlin - Hannover, Berlin 1929. 16 Ders. , Dora meldet (Anm. 6), S. 17. 17 Ebd. , S. 514. 18 Ebd. , S. 76. 19 Zum „Nach-Krieg“ in der Sowjetunion siehe Jörg Baberowski, Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, München 2003, S. 240ff. 20 Thomas, Rado (Anm. 9), S. 48. 21 Ebd., S. 60; Pál Kaszai/Gábor Gercsák, Mass media maps in Hungary. National Report (1997), online unter URL: <http://lazarus.elte.hu/gb/hunkarta/press.htm>. 22 Siehe die Kartenbeispiele in: Radó, Die Karte (Anm. 8), Tafel 7-9. 23 Rudolf Habel, Professor Dr. Sándor Radó 70 Jahre, in: Petermanns Geographische Mitteilungen 113 (1969), S. 318f. 24 Kaszai/Gercsák, Mass media maps (Anm. 21), o.S. 25 György Konrád/Iván Szelényi, Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht, Frankfurt a.M. 1978, S. 292. Zu ähnlichen Karrieren in der DDR siehe Ute Schneider, Hausväteridylle oder sozialistische Utopie? Die Familie im Recht der DDR, Köln 2004, S. 49ff.; Ralph Jessen, Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft in der Ulbricht-Ära, Göttingen 1999, S. 316ff. 26 Alex Radó, Atlas für Politik Wirtschaft Arbeiterbewegung, Bd. 1: Imperialismus, Wien 1930. Die DDR publizierte 1980 ein Reprint des Werkes mit einem Vorwort von „Alex Radó (Prof. Dr. Sándor Radó)“. 27 Eine Abbildung des Atlasses und einzelner Karten findet sich online unter URL: <http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/RadoAtlasfurPolitik.html>. 28 Radó, Dora meldet (Anm. 6), S. 60f. 29 Hermann Lautensach, in: Petermanns Geographische Mitteilungen 77 (1931), S. 218 (Zitat); Herbert Rosinski, Das Fiasko des Wirtschaftsatlas I: Rado, in: Die Volkswirte 30 (1931), S. 23ff. 30 Radó, Atlas (Anm. 26), S. 93. 31 Ein Vergleich zwischen der bei Münkler abgebildeten Karte zur militärischen Präsenz Amerikas (Imperien [Anm. 3], S. 276f.) und der Radóschen Karte ergibt ein interessantes Bild der Bedeutung und Wahrnehmung militärischer Macht in imperialen Kontexten. Zur Karte siehe Radó, Atlas (Anm. 26), S. 29. Abbildung unter URL: <http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/RadoAtlasfurPolitik.html>. 32 Baberowski, Der rote Terror (Anm. 19), S. 73. 33 Ebd., S. 74. 34 Jörg Baberowski, Stalinismus und Nation: Die Sowjetunion als Vielvölkerreich 1917-1953, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 54 (2006), S. 199-213, Zitat S. 205. 35 Hirsch, Empire of Nations (Anm. 3), S. 21-62, S. 145-187. Zum Zusammenhang von Statistik und Kartographie siehe Ute Schneider, „Den Staat auf einem Kartenblatt übersehen!“ Die Visualisierung der Staatskräfte und des Nationalcharakters, in: Dipper/Schneider, Kartenwelten (Anm. 4), S. 11-25. 36 Radó, Atlas (Anm. 26), S. 144. 37 Ders., The Atlas of Today and Tomorrow, London 1938. 38 Ebd., S. 23. 39 Rezensionen ohne Autorenangaben in: Nature 143 (1939), S. 8; G.R.C., in: The Geographical Journal 93 (1939), S. 179. 40 Radó, Dora meldet (Anm. 6), S. 120. 41 Baberowski, Der rote Terror (Anm. 19), S. 75. 42 Ebd., S. 196. 43 Ebd., S. 195-198, hier 198. 44 Radó, The Atlas (Anm. 37), S. 162ff. 45 Walter Benjamin, Moskauer Tagebuch, Frankfurt a.M. 1980, S. 76, S. 135. 46 Gorkin, Bol’soj sovetskij atlas mira (Anm. 5), Karten 78-80. 47 Gertjan Dijkink, National Identity and Geopolitical Visions. Maps of Pride and Pain, London 1996. S. 95-108; Hannes Adomeit, Russia as a „great power“ in world affairs: images and reality, in: International Affairs 71 (1995), S. 35-68. Siehe dazu auch die Karte und den Artikel von Johannes Voswinkel, An Russlands Rändern bröckelt es, in: ZEIT, 25.5.2005, S. 11. 48 Interessanterweise hat Anderson erst die erweiterte Neuauflage seines grundlegenden Buchs um ein Kapitel zu „Zensus, Landkarte und Museum“ ergänzt: Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Berlin 1998, S. 163-187. |
| Angaben zur Autorin: |
 HD Dr. Ute Schneider
TU Darmstadt
Institut für Geschichte
Residenzschloss
D-64283 Darmstadt
E-Mail: schneider@pg.tu-darmstadt.de
Position/Tätigkeit: Hochschuldozentin für Neuere und Neueste Geschichte
Forschungs- und Interessengebiete: Sozial-, Geschlechter-, Rechts- und Kulturgeschichte Europas im 19. und 20. Jahrhundert; Methodologie der Geschichtswissenschaft
wichtigste Veröffentlichungen:
Hausväteridylle oder sozialistische Utopie? Die Familie im Recht der DDR, Köln 2004
Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute, Darmstadt 2004
(Hg., mit Christof Dipper), Kartenwelten. Der Raum und seine Repräsentation in der Neuzeit, Darmstadt 2006 (im Druck)
(Stand: Januar 2006)
|
| Zitierempfehlung: |
Ute Schneider, Kartographie als imperiale Raumgestaltung. Alexander (Sándor) Radós Karten und Atlanten, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 3 (2006), H. 1, URL: <http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Schneider-1-2006> |
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, théorie politique, sciences politiques, politologie, cartographie, géographie, communisme, union soviétique, années 30, sandor rados |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 février 2013
Il totalitarismo della “società aperta” antitradizionale
Il totalitarismo della “società aperta” antitradizionale

[1] “Riflessioni sulla cultura dei diritti dell’uomo”, Luigi Arnaboldi, http://www.interculture-italia.it.
[2] Antoine de Sainte-Exupery, Cittadella, ed. Borla, Roma, 1999, pg. 195-196.
[3] Il Mondo della Tradizione, centro studi Raido, Roma, pg. 23.
[4] Octavian Racu, www.octavianracu.wordpress.com.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, société ouverte, théorie politique, tradition, saint-exupéry |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



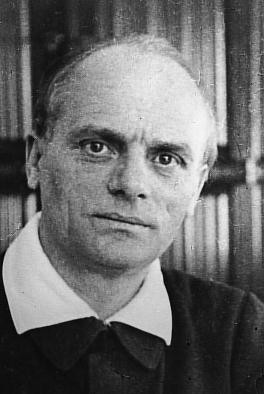 Einer wollte den Führer führen. Nein: Einige wollten den Führer führen und wirkten so im Zeichen des Führers. Ob Heidegger, Rosenberg oder Spann, die Qualität ihrer Beiträge bleibt in diesem Kontext sekundär, wenn auch im Sinne der üblichen Vorwegnahme bei Spann die Betonung auf der philosophischen Stupidität liegen kann. Ihm gelang jedoch die Formierung eines Kreises, der mehr als sechzig Jahre nach seiner eigenen Entfernung von der Universität, der heutigen WU-Wien, das Gewäsch von Ganzheit wiederholt und daneben peinlich bemüht wirkt, keinen runden Geburtstag des Meisters oder seines ersten Schülers, manchmal auch des zweiten oder folgender, zu vergessen und zumeist mit einem Presseartikel, besser mit einem Jubiläumsband zu bedenken.
Einer wollte den Führer führen. Nein: Einige wollten den Führer führen und wirkten so im Zeichen des Führers. Ob Heidegger, Rosenberg oder Spann, die Qualität ihrer Beiträge bleibt in diesem Kontext sekundär, wenn auch im Sinne der üblichen Vorwegnahme bei Spann die Betonung auf der philosophischen Stupidität liegen kann. Ihm gelang jedoch die Formierung eines Kreises, der mehr als sechzig Jahre nach seiner eigenen Entfernung von der Universität, der heutigen WU-Wien, das Gewäsch von Ganzheit wiederholt und daneben peinlich bemüht wirkt, keinen runden Geburtstag des Meisters oder seines ersten Schülers, manchmal auch des zweiten oder folgender, zu vergessen und zumeist mit einem Presseartikel, besser mit einem Jubiläumsband zu bedenken.






